Le sang de la jeunesse – sur House de Nabuhiko Obayashi
L’histoire commence à être connue. Suite au succès phénoménal des Dents de la mer (1975), la Tōhō, vénérable studio comptant dans son catalogue des titres d’Akira Kurosawa, Mikio Naruse, Kenji Mizoguchi ou Ishirô Honda (Godzilla et ses suites), propose à un réalisateur louvoyant entre l’expérimental et la publicité, de concevoir une réplique japonaise au film du tout jeune Steven Spielberg.
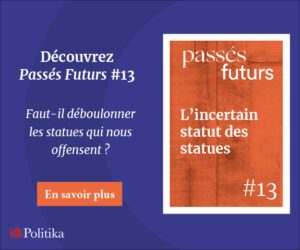
Plutôt que de décliner le concept du super-prédateur (réflexe d’adulte, pour ne pas dire de vieux), Nabuhiko Obayashi cherche l’inspiration auprès de sa fille, Chigumi, âgée d’une dizaine d’années. Celle-ci lui fait part de visions angoissantes surgies notamment lors de séjours à la campagne chez ses grands-parents – graines d’enfance que le scénariste Chiho Katsura fera germer dans le terreau d’une maison hantée.
House raconte-t-il autre chose que des relations à la fois intéressées et inquiètes entre générations ? L’analogie entre la fiction et sa production est tentante. La maison serait le studio – le tournage a eu lieu sur le plus grand plateau de la Tōhō – et sa mystérieuse propriétaire, Obayashi en personne. Lui qui approche de la quarantaine s’entoure de jeunes actrices inexpérimentées, comme si leur fraîcheur et leur enthousiasme devaient lui offrir la puissance nécessaire pour s’élancer dans ce premier long métrage. Sept comme les samouraïs, les filles forment une bande hétéroclite. Défini par sa silhouette et son nom (« Binocle » l’intello, « Mélodie » la musicienne, « Belle » la belle…), chaque personnage semble là pour représenter une sensibilité et un segment du marché – à la manière dont l’industrie musicale fabrique à la chaîne les girls et boys band. Opération cynique ? Non, ou pas seulement : si le cinéma suce le sang de la jeunesse, il lui donne en retour l’éternité.
On le devine, House est un film de vampire, comme l’était déjà Émotion, court avant-gardiste de 1966 qui contribua à la réputation d’Obayashi dans les milieux étudiants. Mieux : c’est un film sur le vampirisme du cinéma. Celui-ci tient, davantage encore qu’à l’économie, au rapport que l’humain noue avec les images dès lors qu’il voit en elles le support d’un transfert de vitalité et par conséquent un sursis, une grâce ou un piège, pour ceux qui ainsi se re-présentent. De cet étrange commerce, au moins aussi ancien que la peinture rupestre, le cinéma aura dès ses balbutiements semblé l’achèvement historique. Le 30 décembre 1895, un journaliste écrivait après sa découverte des premières vues Lumière : « [L]orsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers, non plus dans leur forme immobile, mais dans leur mouvement, dans leur action, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d’être absolue. » Sans doute aurait-il fallu ajouter que la vie deviendrait relative à sa captation.
Comme il se doit, House s’ouvre par une séance de photographie. Belle (Kimiko Ikagami), le visage ceint d’un voile blanc, fixe l’objectif. Des flammes vives l’entourent. Au moment où sa camarade Fanta (Kumiko Oba) presse le déclencheur, la lumière vire au rouge, et le cadre s’élargit, révélant fioles fumantes et alambics. Puis le décor ésotérique se fond dans celui d’une salle de classe, et Belle retrouve son uniforme de lycéenne. Mystère, technique, jeu, le film glisse d’un mode à l’autre, maintenant ouverte la question de ce qu’est et de ce que peut une image. Attachée aux images, l’adolescente l’est moins par narcissisme que par mélancolie. C’est à travers elles qu’elle maintient un contact avec sa mère décédée, dont les clichés, le temps d’une scène, envahissent le champ, se sur-impressionnent à son propre corps ou, sur leur envers, trouent le plan de leur blancheur sépulcrale.
Le père de Belle, célèbre compositeur de musique de films, vient de lui présenter sa nouvelle compagne. Séquence étonnante, moins pour ses cieux visiblement factices, saturés par les oranges et les rouges du crépuscule, que pour l’usage qu’Obayashi fait d’une imposante baie vitrée. La caméra ne s’aventure jamais sur le balcon, mais ne cesse, en se mouvant, de marquer via la multiplicité des carreaux la recomposition des rapports. Ce kaléidoscope, dont les découpes font songer à une série de photographies, figure le terme de l’enfance, ou du moins de la fusion avec le père. D’abord lovée dans les bras de celui-ci, Belle finit par avoir le visage brisé par le biseau du verre. Quant à la belle-mère, elle est un fantasme d’actrice, qui glisse plutôt qu’elle ne marche, et dont l’écharpe de soie ondule constamment dans le vent. Apparition terrassante, qui suscitera une vengeance indirecte et iconoclaste : le gribouillage des portraits du père.
Avec ses amies, l’adolescente décide alors de passer les vacances chez sa tante maternelle (Yōko Minamida). Le voyage a dans un premier temps l’allure d’un trip psychédélique entrecoupé de potacheries. La caméra pénètre les pages d’un livre d’enfant, la prise de vues réelles se mue en animation puis le paysage défile dans la vitre du train comme un ruban de celluloïd. Si un arc-en-ciel inonde le compartiment, les couleurs toutefois s’épuisent dans une évocation de la Seconde Guerre mondiale. Un petit film sépia raconte la légende familiale : la tante et son fiancé enrôlé dans l’armée, le vain espoir d’un retour, l’union enfin de la mère de Belle. Soudain, le récit, dramatique mais réaliste et linéaire, est fracassé par un raccord sidérant. Les deux femmes posent pour un photographe, l’une en tenue de mariée, l’autre en noir, quand au flash de l’appareil se substitue l’explosion des bombes atomiques.
Sous certains aspects, House paraît alors synthétiser une figure de la maternité impossible.
Le glissement insensible du burlesque à la tragédie pourrait signer le foudroyant retour de l’Histoire. Grandi près de Hiroshima, Nabuhiko Obayashi a perdu tous ses amis d’enfance le 6 août 1945. Les évènements demeurent cependant l’objet d’un commentaire enjoué – au point que les filles comparent la déflagration à une barbe à papa. Loin de les flétrir pour leur inconséquence, le cinéaste semble pointer le paradoxe d’une destruction facilement représentable (le champignon) et totalement inimaginable (le reste). Un gouffre sépare les générations, qui se retrouvent néanmoins dans un refus radical de la mort et de ses conséquences. De la même façon que Belle ne veut pas voir la place de sa mère occupée par une autre femme, la tante (ou son esprit) s’obstine à attendre son amour, éternelle fiancée se nourrissant des vierges qui la visitent. Le déni est l’énergie noire de la jeunesse – à moins qu’il ne soit le dernier moyen de résistance laissé aux femmes.
L’idée façonne la relation ambigüe entre Belle et sa parente. Leurs retrouvailles sont l’occasion d’une de ces excentricités formelles dont le film est prodigue. Au canonique champ-contrechamp, Obayashi préfère un plan unique au cours duquel le visage de l’une puis de l’autre se greffe au corps de la tante comme un médaillon disproportionné. L’effet annonce la possession de l’adolescente. Face à un miroir à trois faces, celle-ci appose sur ses lèvres un peu de rouge. Puis son reflet lui échappe, elle se dédouble et la tante surgit, canines pointées. Les deux visages se fondent, la glace se fracture. Une larme de sang coule du visage de la femme et se répand le long des brisures. Comme une porcelaine, le corps de Belle se craquelle à son tour, révélant une chair en fusion. La tante n’absorbe pas ce corps juvénile, mais s’y glisse. Pour autant, la volonté de la jeune fille n’est pas abolie, puisqu’elle aura l’occasion d’enflammer sa belle-mère dans un épilogue qui ajoute encore au trouble.
Sous certains aspects, House paraît alors synthétiser une figure de la maternité impossible. D’une part, donc, la tante qui dévore à défaut d’enfanter (une image de sa jeunesse, en noir et blanc, la montre devant la tombe de son fiancé serrant contre son ventre une rose rouge, seule tache de couleur avec le filet de sang qui coule de sa main entaillée par les épines, tandis qu’un cri de nourrisson retentit brièvement). D’autre part, Belle et sa mère, toutes deux incarnées par la même actrice comme pour rompre l’ordre des générations ou suggérer une genèse inachevée, sans distinction ni séparation.
Mais cette chimère marque aussi une rupture avec des stéréotypes de genre – le glamour de la belle-mère et l’admiration pour l’héroïsme supposé des hommes. Ces derniers sont d’ailleurs soumis à une satire constante. Le soupirant se fige dans une posture martiale dès son enrôlement, et périt sans la moindre émotion, héros stupide. Le professeur dont certaines des lycéennes sont amourachées, et qui passent pour un chevalier sauveur de jeunes filles en détresse, non seulement ne parvient pas jusqu’à la demeure de la tante, mais finit transformé en monticule de bananes.
À quoi bon les attendre ? Alors que la maison libère un monstrueux flot de sang après avoir attaqué les adolescentes de toutes les façons possibles (ahurissante séquence du piano, qui vient déchaîner et abroger le pouvoir enchanteur d’une ritournelle romantique), la créature recueille contre son sein nu la dernière survivante. Une mère est née. Elle n’est plus le fantôme de l’inaccomplissement, mais l’image souveraine du désir.
House, de Nabuhiko Obayashi, actuellement en salles.
