« You say you want a revolution… Well, you know… » – sur Jeudi d’Eden Levin
«On est partis sur un collectif pur jus. » Déjà, ils maîtrisent parfaitement le verbiage du moment, suavement culinaire ou œnophile (« on est sur du fruit rouge », « ça part en cuisson », etc). « Tout le monde fait tout, toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité.
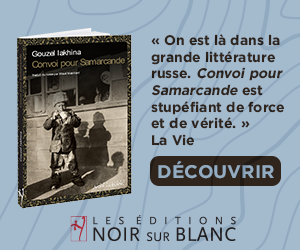
Après trois mois de délibérations, on a fini par se mettre d’accord sur un nom. » Le nom en question est Jeudi, d’où le titre de ce premier roman, joyeuse et rebelle salve d’un jeune écrivain formé au Master de Création littéraire de l’Université Paris VIII.
Il y a trois personnages, Alex, Elena et Valencia, étudiant·es en théâtre comme l’auteur le fut lui-même, puisque le théâtre, c’est le collectif, l’art c’est la vie et la façon de la changer. Alex est plus timoré ou cynique, Valencia plutôt care. Quant à Elena, elle est carrément pugnace : « Pour faire entendre notre message, il va falloir tuer. Non, non, c’est trop fort. Pour faire entendre notre message, nous sommes prêts à tuer. Non. Nous sommes prêts à mourir. Non, toujours pas, ça fait corporate. » Et voilà comment ce collectif théâtral devient politique. Elena écrit un manifeste révolutionnaire pour tout faire sauter, version indécise et explosive de l’Insurrection qui vient (La Fabrique, 2007), et dont les extraits rythment Jeudi.
Sauf qu’être artiviste est compliqué, être jeune est fatigant, être un collectif qu’est-ce que cela veut dire ? En passant la parole à chacun de ses personnages tour à tour, Eden Levin brosse les incohérences du désir de révolution au début du XXIe siècle, quand on a dix-sept ans et qu’on est mortellement sérieux. Le roman est composé selon un principe de collage (manifeste, journal d’écriture du manifeste, pièce de théâtre, fausses informations maquettées avec soin) qui accentue le sentiment de grotesque et de déflagration – sans toutefois obérer la lecture.
Côté dispersion et retombées, les forces vives de nos héro·ïnes sont hélas détournées par un conflit absurde et inutile : c’est qu’il existe
