La maison cinéma – sur Portraits Fantômes de Kleber Mendonça Filho
En France, Kleber Mendonça Filho a été découvert en 2014 avec la sortie des Bruits de Recife, film qui avait été présenté deux ans auparavant au festival de Rotterdam, et dont le tournage datait de l’été 2010.
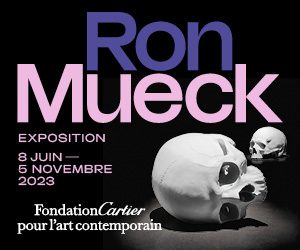
Si du strict point de vue du plaisir cinéphile, on peut regretter cet effet retard – car le cinéaste s’est immédiatement imposé comme une voix majeure du cinéma sud-américain contemporain – on peut aussi y voir un clin d’œil du destin tant la sédimentation temporelle est une composante essentielle de cette œuvre.
La preuve avec Portraits Fantômes, mix fascinant de documentaire à la première personne et d’essai réflexif sur le devenir du cinéma, film « fait main » sur lequel le cinéaste a commencé à travailler il y a sept ans.
En réalité, le film vient même de beaucoup plus loin tant il met en jeu l’épaisseur d’une vie de spectateur, qui est aussi un regard de citoyen qui observe depuis chez lui, les transformations de son logement, de sa rue, de son quartier, de sa ville et partant de la société dans laquelle il évolue.
Pour qui a vu Les Bruits de Recife – dont l’argument montrait comment le démarchage d’une société de sécurité privée reconfigurait les rapports sociaux du voisinage –, les lieux de Portraits Fantômes apparaîtront rapidement familiers. Il s’agit tout simplement du propre appartement du cinéaste, véritable personnage principal de la première partie du film. Un appartement déjà hanté à plusieurs titres. Au sein d’un îlot construit dans les années 70 et reconquis sur la mangrove, et hanté par le souvenir de la figure maternelle, puisque la propre mère du cinéaste, Joselice, historienne de métier, y a d’abord vécu après son divorce. Rien d’un schéma à la Psychose dans ce nœud entre mère, fils et foyer, quand bien même Kleber Mendonça Filho est un fervent amateur de thriller et de cinéma fantastique, (cf. ce joyau de court-métrage Vinil Verde réalisé en 2004).
Le lien avec la figure maternelle – serait-elle le premier fantôme qui a inspiré
