Soin intensif – sur Toucher l’insensé au Palais de Tokyo
«La prison, c’est dehors » clamaient joyeusement les animateur·ices et les jeunes du Centre Familial d’Ivry-sur-Seine dans les années 1970, des idées autogestionnaires, anticarcérales et libertaires plein les têtes.
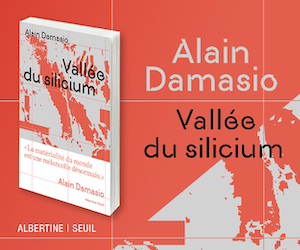
Cinquante ans plus tard, au Palais de Tokyo, l’exposition Toucher l’insensé rassemble sous le commissariat de François Piron une dizaine d’artistes et de collectifs autour des questions de santé mentale, et plus particulièrement de psychiatrie qui s’inspire de la psychothérapie institutionnelle, une pratique expérimentale de la psychiatrie née pendant la seconde guerre mondiale à travers plusieurs initiatives menées en périphérie des métropoles à l’initiative de psychiatriques dissidents.
Parmi eux, François Tosquelles, psychiatre catalan, militant antifasciste pendant la Guerre civile en Espagne, réfugié politique en France. Politiquement engagés, lecteurs attentifs de Freud comme de Marx – « Une jambe freudienne, l’autre marxiste » disait d’ailleurs Tosquelles – ces psychiatres s’opposent fermement à la dimension concentrationnaire des établissements psychiatriques, ces « asiles de fou », où la guerre n’avait fait que davantage dégrader des conditions de prise en charge des malades déjà extrêmement insuffisantes. Pour ces praticiens, il faut « soigner l’hôpital pour soigner le malade », autrement dit, il ne faut pas isoler et enfermer les personnes souffrant d’un trouble mental, mais repenser l’institution qui les accueille afin d’être en mesure de les soigner au mieux.
Portée par le courant des contre-cultures des années 1960 et 1970, la psychothérapie institutionnelle, pourtant mal considérée par une grande part du corps médical à l’époque, permit l’émergence de nouvelles manières de dispenser des soins psychiatriques. Ainsi, dans les Cévennes, Fernand Deligny a rassemblé enfants et adultes en pleine campagne où les patient·es sont en « cure libre » permettant aux délinquant·es, psychotiques, autistes de vivre selon leur « mode d’être » plu
