Soin intensif – sur Toucher l’insensé au Palais de Tokyo
«La prison, c’est dehors » clamaient joyeusement les animateur·ices et les jeunes du Centre Familial d’Ivry-sur-Seine dans les années 1970, des idées autogestionnaires, anticarcérales et libertaires plein les têtes.
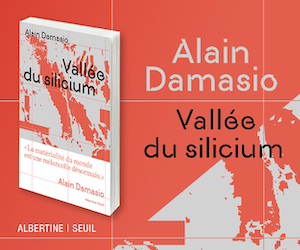
Cinquante ans plus tard, au Palais de Tokyo, l’exposition Toucher l’insensé rassemble sous le commissariat de François Piron une dizaine d’artistes et de collectifs autour des questions de santé mentale, et plus particulièrement de psychiatrie qui s’inspire de la psychothérapie institutionnelle, une pratique expérimentale de la psychiatrie née pendant la seconde guerre mondiale à travers plusieurs initiatives menées en périphérie des métropoles à l’initiative de psychiatriques dissidents.
Parmi eux, François Tosquelles, psychiatre catalan, militant antifasciste pendant la Guerre civile en Espagne, réfugié politique en France. Politiquement engagés, lecteurs attentifs de Freud comme de Marx – « Une jambe freudienne, l’autre marxiste » disait d’ailleurs Tosquelles – ces psychiatres s’opposent fermement à la dimension concentrationnaire des établissements psychiatriques, ces « asiles de fou », où la guerre n’avait fait que davantage dégrader des conditions de prise en charge des malades déjà extrêmement insuffisantes. Pour ces praticiens, il faut « soigner l’hôpital pour soigner le malade », autrement dit, il ne faut pas isoler et enfermer les personnes souffrant d’un trouble mental, mais repenser l’institution qui les accueille afin d’être en mesure de les soigner au mieux.
Portée par le courant des contre-cultures des années 1960 et 1970, la psychothérapie institutionnelle, pourtant mal considérée par une grande part du corps médical à l’époque, permit l’émergence de nouvelles manières de dispenser des soins psychiatriques. Ainsi, dans les Cévennes, Fernand Deligny a rassemblé enfants et adultes en pleine campagne où les patient·es sont en « cure libre » permettant aux délinquant·es, psychotiques, autistes de vivre selon leur « mode d’être » plutôt que selon les règles sociales d’un établissement psychiatrique : vivre sans contrainte, en collectif, se filmer, dessiner, discuter, inventer un territoire commun où chacun·e puisse s’épanouir qui qu’iel soit… L’hôpital est alors considéré comme un organisme vivant, pleinement intégré à la société, où il est nécessaire d’impliquer les malades dans la vie sociale en les intégrant à des circuits d’échanges hors les murs.
L’exposition Toucher l’insensé se veut une caisse de résonance pour ces pratiques révolutionnaires d’un autre temps, rassemblant « des pratiques artistiques qui ont lieu au sein d’institutions liées au soin psychique, ou sont inspirées par elles ». En effet, la part belle est également faite à des projets bien plus récents – qui prolongent et interrogent par la même occasion la « psychothérapie institutionnelle » telle qu’elle a été pensée dans les années 1970 – où de jeunes artistes et collectifs d’artistes interviennent dans des écoles, prisons, hôpitaux et autres « institutions disciplinaires » comme les qualifiait le philosophe Michel Foucault. À l’appui, un parti pris ambitieux qu’affiche le cartel dès l’entrée de l’exposition : il sera question de présenter des pratiques artistiques qui font de l’art « un outil d’émancipation, une forme active d’être ensemble et l’expression d’une poésie vitale », rien de moins.
Toucher l’archive ?
À travers une scénographie marquée, Toucher l’insensé ressemble à un dédale de couleurs, un espace labyrinthique où chaque pièce présentée prend la forme d’une restitution d’un projet passé – qui a eu lieu en dehors du champ de l’art contemporain, en dehors de l’institution muséale, en dehors de l’exposition. Toucher l’insensé s’appuie, avant tout, sur une multitude de documents d’archives – vidéos, publications, dépliants – qui témoignent de ce qu’ont été ces pratiques de soin expérimentales en faveur d’une psychiatrie désaliénante. Aussi, plusieurs films de François Pain sont présentés dans l’exposition. Réalisés alors qu’il était jeune étudiant en médecine, ces archives inédites témoignent des expérimentations radicales réalisées à la clinique de La Borde dans le Loir-et-Cher.
Fondée en 1953 par Jean Oury et où exerçaient notamment le philosophe et psychiatre Félix Guattari et le psychiatre François Tosquelles, cette clinique permettait la pratique active de l’autogestion : il est question de défaire les hiérarchies entre les soins, les animations et les tâches quotidiennes. Pour la première fois, Toucher l’insensé présente aussi les archives du Centre Familial de Jeunes (CFDJ), un lieu d’accueil et de soin pour adolescent•es qui exista en région parisienne pendant une quarantaine d’années et qui ferma définitivement ses portes en 1992. Alternative aux maisons de correction, le CFDJ prônait, dans un esprit anarchiste, « la prison c’est dehors » : improvisations théâtrales, concours de poésie, performances parodiques à l’instar de « Comment rater son enfant ? » en 1975, cérémonies cocasses, tracts virulents contre les établissements dits « concentrationnaires », livres rassemblant des dessins d’enfants… Tout dégageait un joyeux esprit libertaire, engagé où le foyer était conçu avant tout comme un endroit de protection pour ces enfants contre la violence de la société qui les considérait comme anormaux.
«Ressortir les choses de l’époque et les remettre dans un contexte d’installation aujourd’hui, c’est typiquement ce que j’appelle de la mise en scène documentaire », affirme François Piron pour expliquer ses choix curatoriaux dans une interview donnée aux équipes de médiation du centre d’art et disponible sur le site Internet. En effet, il est bien question « d’une mise en scène documentaire » qui accorde une place importante aux pratiques d’édition qui ont accompagné ces expérimentations psychiatriques comme le périodique L’oreille qui parle édité par le Centre familial des jeunes de Vitry pendant plusieurs décennies. Fidèle à ces questions de transmission, de réflexion et de compréhension autour de la maladie mentale dont témoigne cette riche activité éditoriale, l’artiste Tania Gheerbrant déploie une installation nommée Fleurs de l’histoire qui rassemble des livres, fanzines et tracts sur les collectifs de patient•es antipsychiatriques dans les années 1970 qui visaient à mettre en avant les systèmes d’oppression dans les institutions médicales et carcérales et qu’elle met également en relation avec un projet qu’elle mène depuis deux ans, Les Entendeurs de voix. Il s’agit, pour elle, de comprendre comment les groupes de parole fonctionnent, dispositifs de soutien permettant aux patient·es de partager leurs expériences.
Ainsi, la psychothérapie institutionnelle est avant tout un projet où le collectif – à la fois l’être ensemble et le faire ensemble – prédomine, car la maladie mentale est surtout une affaire politique.
L’artiste, un travailleur social ?
Avant tout, il faut rappeler que la psychothérapie institutionnelle s’est développée dans un contexte bien précis à la fois post-soixante-huitard et très intello – à cette époque Félix Guattari, figure majeure de la clinique de La Borde, rédigeait notamment les deux volumes de Capitalisme et schizophrénie avec Gilles Deleuze, s’attachant à penser l’inconscient depuis l’expérience du schizophrène, à l’aide de la philosophie, de la psychanalyse et de la psychiatrie, contribuant ainsi à défaire les oppositions entre le « normal » et le « pathologique ». La psychothérapie institutionnelle s’est, certes, positionnée comme un refus de pratiques délétères vis-à-vis des personnes atteintes de troubles psychiatriques qui avaient cours pendant et après la seconde guerre mondiale, mais s’est aussi développée à la faveur d’une époque qui a fait de ces questions une affaire philosophique essentielle.
Dans quelle mesure est-ce que ces expérimentations n’ont pas bénéficié d’un accueil favorable permis par l’époque ? Dans quelle mesure ce contexte est-il définitivement derrière nous ? Quelles places occupent aujourd’hui les artistes dans les soins psychiques ? Quelles places doivent-ils prendre ? Toucher l’insensé rassemble notamment plusieurs initiatives de jeunes artistes en milieu scolaire comme celle de l’artiste Carla Adra qui présente son projet Paroles chaudes – expression qu’elle emprunte d’ailleurs à François Tosquelles. Invitée en résidence à la Galerie, un centre d’art à Noisy-le-Sec en région parisienne en 2022, elle a accompagné un groupe de jeunes adultes de l’Institut médico-éducatif Henri Wallon à Noisy-le-Sec pendant six mois. Elle a conçu un dispositif où des encadrant·es de l’Institut et de l’équipe du centre d’art étaient conviés à s’entretenir avec un·e jeune adulte, suivant un protocole consistant à revêtir « une cape mentale » en velours à l’image de chacun·e d’entre elle·ux puis à répondre à un questionnaire tandis que le·a jeune adulte filmait l’interaction. Ainsi, à travers ce dispositif, Carla Adra crée une rencontre où il est possible de « rendre audible ce qui est disqualifié » en permettant l’émergence d’une discussion intime qui défait les hiérarchies créées par l’institution psychiatrique.
De même, l’artiste Jules Lagrange est intervenu dans une classe ULIS en région parisienne dans le cadre d’une résidence portée par l’association Orange Rouge qui agit en faveur de l’inclusion des adolescent·es en situation de handicap à travers la réalisation d’une œuvre collective. Ensemble, ils ont réalisé un film de marionnettes nommé Marianne et Robin où la classe fut invitée à rejouer l’histoire de Robin des Bois dont les dialogues ont été réécrits comme si l’histoire se déroulait actuellement en France intégrant des questions liées à l’immigration, aux violences policières, aux expulsions.
Si ces projets sont en partie réjouissants, car ils rassurent sur le fait que l’art puisse permettre, même marginalement, de faire un monde commun, peut-être ne faut-il pas se réjouir trop vite ? Car, vis-à-vis des expérimentations liées à la psychothérapie institutionnelle – dont les fondements comme les applications étaient véritablement anarchistes, autogestionnaires, révolutionnaires – les interventions d’artistes en milieu médical, social, carcéral sont aujourd’hui bien davantage le fait d’un manque de moyen généralisé : manque de moyen de l’hôpital pour permettre les interventions de personnes formées professionnellement à de telles activités ; manque de moyen de la culture qui ne permet pas, actuellement, à la plupart des artistes de vivre de leur pratique artistique, ce qui les pousse aussi à accepter ces missions rémunérées où la création plastique trouverait enfin une utilité, celle de retisser des liens sociaux, de faire société et monde-commun, de prendre soin des plus vulnérables quand l’État néolibéral ne le permet plus. Il n’est pas question de faire reposer une quelconque responsabilité sur les artistes qui font face, chacun·e à leur manière, à la précarité endémique du monde de l’art, cependant le souffle révolutionnaire de la psychothérapie institutionnelle ne semble plus vraiment dans l’air du temps.
Le Palais de Tokyo, en manque de care ?
Toucher l’insensé est une exposition qui interroge également, en creux, l’institution artistique. S’inspirant notamment de l’ouvrage Ce que Laurence Rassel nous fait faire co-écrit par Agathe Boulanger, Signe Frederiksen et Jules Lagrange et publié chez Paraguay Press en 2020, la maison d’édition dirigée par François Piron, l’exposition s’inscrit dans une réflexion plus générale au sein du Palais de Tokyo. En effet, depuis son arrivée en 2022 à la tête du centre d’art, Guillaume Désanges cherche à marquer de sa patte le Palais de Tokyo. Il a d’abord initié, en 2022, un premier volet d’expositions nommé Le Grand Désenvoûtement avec la commissaire Adélaïde Blanc où il avait invité plusieurs artistes, dont Carla Adra, à investir les sous-sols du Palais de Tokyo à l’occasion des vingt ans du centre d’art. Il était ainsi question d’« initier à l’aide d’artistes, de praticien·nes et de chercheur·euses un projet à long terme d’examen de l’institution », de prendre « le pouls du centre d’art et de son bâtiment, de sonder ses identités multiples, ses imaginaires, comme ses désirs refoulés et ses traumatismes ».
En parallèle de ce volet d’expositions qui s’inspirait de la « permaculture institutionnelle » pour exorciser l’histoire et les problèmes du centre d’art, Guillaume Désanges a souhaité également restructurer le Palais de Tokyo en créant divers espaces qui n’existaient pas auparavant tel que la Friche, « un lieu collectif de travail, de réflexion, de production, de rencontres et d’accalmie pour des artistes, des collectif·ves, des chercheur·euses, des revues » tentant de renouer avec les missions d’accompagnement et de production qui sont celles d’un centre d’art. Le Palais de Tokyo a également inauguré de nouveaux espaces de médiation baptisés Le Hamo dans le hall d’entrée du centre d’art et dont « le positionnement central traduit notre volonté de rapprocher les œuvres des publics dans une logique alliant permaculture institutionnelle et droits culturels » peut-on lire sur le site Internet du centre d’art du seizième arrondissement de Paris. Ainsi, il semblerait que le Palais de Tokyo veuille faire peau neuve en mettant à profit les outils de la psychiatrie institutionnelle. Le projet de la psychothérapie institutionnelle appliquée aux lieux d’art consisterait donc à considérer qu’il faille également soigner le centre d’art au même titre qu’il faut soigner l’hôpital, l’école, la prison. En quoi consisterait réellement le fait de soigner l’institution d’art ? Si le Palais de Tokyo se pose cette question, il n’est pas le seul.
En à peine trois ans, la psychothérapie institutionnelle fait l’objet de plusieurs expositions, dont notamment La Déconniatrie aux Abattoirs à Toulouse, en 2021, qui revenait sur le parcours de François Tosquelles à Saint-Alban en Haute-Garonne ou encore Fernand Deligny, légendes du radeau au CRAC Occitanie à Sète en 2023, première exposition présentant le travail de l’éducateur, écrivain et artiste Fernand Deligny. Qu’est-ce qui explique une telle actualité ? Dans un contexte où le monde de l’art et plus généralement de la culture prend progressivement conscience de ses problèmes majeurs de fonctionnement – harcèlement moral, harcèlement sexuel, précarité endémique, burn-out –, la psychothérapie institutionnelle est une perspective encourageante pour aider à poser des questions qu’il devient, presque, impossible de ne plus se poser en 2024.
L’éthique du care, définie par Carol Gilligan en 1982 dans une étude de psychologie comme cette « capacité à prendre soin d’autrui », est aujourd’hui un impératif dans le monde de la culture. Prendre soin, donner de l’attention, manifester de la sollicitude pour l’ensemble de ses collègues – qu’il s’agisse de la femme de ménage ou de la personne en service civique – sont de nouvelles pratiques qu’il est nécessaire de mettre en place avec les équipes et les publics. Repenser l’école d’art comme le fait la curatrice Laurence Rassel qui occupe la direction de l’ERG – École de recherche graphique à Bruxelles, repenser le centre d’art comme le fait Guillaume Désanges au Palais de Tokyo sont des missions ambitieuses, surtout si l’on souhaite qu’elles ne se limitent pas à de grandes directives et à de vertueuses feuilles de route. Puisse-t-on faire le vœu pieux qu’il n’en soit pas ainsi au Palais de Tokyo.
Toucher l’insensé, une exposition collective au Palais de Tokyo à Paris, du 16 février au 30 juin 2024.
