Foudroyante beauté politique – sur Bushman de David Schickele
Le type marche sur la grande route. Il est pieds nus. Il est noir. Ses chaussures sont en équilibre sur sa tête. Ce sont les toutes premières images, comiques et réalistes, sensuelles et intrigantes. Le paysage ne laisse guère de doute, on est aux États-Unis.
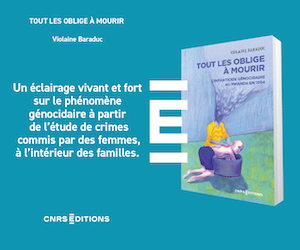
Mais cet homme noir convoque une autre image, venue d’Afrique. Il fait du stop. A l’écran, une inscription indique « 1968 : Martin Luther King, Bobby Kennedy, Bobby Hutton[1] ont été tués il y a peu ». Un autre plan montre des personnes en marche, en Afrique. Autre inscription : « Au Nigeria, la guerre civile vient d’entrer dans sa deuxième année, sans issue en vue. »
Retour sur la route américaine, contre tout attente un bizarre tricycle motorisé piloté par un homme blanc, très amical et tout à fait raciste, embarque le marcheur du début. Dans le véhicule qui fait des acrobaties, une bouteille de scotch à la main, l’homme noir prénommé Gabriel dit qu’il vient du Nigeria pour éduquer les Américains, continue à parler dans une langue de son pays. Apparait une cérémonie traditionnelle dans un village de la brousse, au Nigeria. Rien n’est prévisible, tout est vivant, et riche de complexité. Seulement trois minutes se sont écoulées et il est clair qu’on se trouve devant un objet cinématographique sidérant. La beauté et la liberté des plans en noir et blanc nourrissent un récit aux multiples rebondissements, travaillé par des enjeux politiques, historiques et intimes d’une incroyable richesse.
À elle seule, la remise en question du rapport aux Noirs au sein de la société raciste américaine par la présence d’un Noir non-américain, habité de projets et porteurs d’un regard singulier, en même temps que relié à une autre tragédie historique (ce qu’on nous appellerons la Guerre du Biafra, horreur entre les horreurs), tandis que prolifèrent les modes de contestations intérieures aux États-Unis de l’époque où révolte étudiante, mouvement hippie, refus de la guerre au Vietnam et insurrection Black Panther se côto
