Patchwork testament – sur le 77e Festival de Cannes à mi-parcours
«La vie est faite de bouts qui ne se joignent pas » avait coutume de répéter François Truffaut à son monteur Yann Dedet pour l’encourager à s’autoriser des hiatus dans ses films. Ce mantra pourrait s’appliquer à bien des films de cette première moitié de la 77ème édition du Festival de Cannes, sections officielles et parallèles confondues.
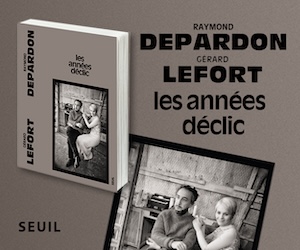
Le patchwork de formes, de genres, de temporalités s’affirme cette année comme le type de récit propice à des travaux d’inventaire, fragments éclatés d’histoire et de monde qui viennent désigner une réalité brisée. Mélange des formats, incursion d’images fixes, rushes tournés à des époques éloignées, mélange baroque de genres antagonistes : nombreux sont les récits hétérogènes qui nous parlent d’une réalité mouvante et complexe, et qui en font le récit testamentaire.
Autoportrait en vieil homme
Depuis 2018, Fabrice Aragno ramène sur la Croisette, depuis Rolle, les travaux de vieillesse de Jean-Luc Godard. Ce fut Le Livre d’image il y a six ans, puis Drôles de guerres l’an dernier et enfin, Exposé du Film annonce du film Scénario cette année. Dans un long plan séquence, le cinéaste y déplie pour ses collaborateurs Fabrice Aragno et Jean-Paul Battaglia, le petit carnet rempli d’images qui servira de document préparatoire à son ultime opus, Scénarios. Le making-of, projeté après le film lui-même, se présente comme l’atlas Mnémosyne du critique d’art Aby Warburg : un catalogue de formes qui se font écho à travers les pays et les âges. Film de collage, Scénarios croise et entrelace trois fils narratifs : les réflexions anciennes de Godard sur l’histoire politique de l’Europe (soit l’histoire de ses conflits, pour le dire vite, de Sarajevo 1914 à Sarajevo 1991 et de la Shoah aux territoires occupés de Palestine), le jeu qui sépare le réel et sa représentation tout en les tenant presque contigus et un autoportrait au grabat. « Le réel a disparu », ainsi que s’intitule la dernière partie de ce court métrage de 24 minutes, compile des plans de morts violentes tirées de Seuls les anges ont des ailes de Hawks, de Rome Ville ouverte ou de Bande à part ou Week-end de JLG. Après avoir filmé tant de fois non pas du sang, mais du rouge, non pas la mort mais sa mascarade, Godard tend sa caméra à Fabrice Aragno, pour nous offrir, comme un au revoir, un ultime autoportrait avant sa mort volontaire. En clair-obscur, semblable à un Rembrandt vieillissant, Godard assis sur son lit, torse nu, s’efforce de retranscrire un aphorisme absurde qui expose la différence entre les chevaux, les non chevaux et leur représentation. Rien, en effet, comme le confirme la pensée de Godard faite de syllogismes, ne ressemble moins à la mort que l’image d’un homme vivant, fut-il conscient qu’il se donnera la mort le lendemain.
Arrêter le temps
Arrêter le temps, c’est le pouvoir que s’est découvert César, le grand architecte interprété par Adam Driver dans Megalopolis de Francis Ford Coppola, autre film testamentaire qui brasse l’histoire du cinéma, des passions humaines héritées de la tragédie antique et une fable écologiste sur la fin du monde. C’est de fait l’apanage des urbanistes que de concevoir des lieux de vie figés, qui survivent aux hommes. César fantasme d’une ville futuriste, conçue d’un matériau virtuel de son invention, le mégalon, substance mouvante non organique aux nombreuses vertus qu’il mixe avec de la bonne vieille architecture en pierre. L’architecte longiligne est immortalisé de dos dans les maquettes de sa ville nouvelle, clin d’œil à la silhouette tout aussi filiforme de Gary Cooper dans The Fountainhead de King Vidor, adaptation du roman de la libertarienne Ayn Rand, russe blanche conquise en exil à la morgue de l’individualisme capitaliste. Il rêve une alternative à la fin du monde qui menace la cité de New Rome, panachage entre une architecture new-yorkaise en ruines et d’un mode de vie décadent et ultra hiérarchisé hérités de l’Antiquité romaine, dans mépris souverain des masses laborieuses dont il dénie le grondement.
Hallucinant d’inventivité dans les cadres, de foi dans la capacité du cinéma à faire monde, Megalopolis n’est jamais si beau que lorsqu’il est en roue libre visuellement. Il n’est jamais si plombé en revanche que lorsqu’il s’attache à sa naïve fable écologique, ou au destin de ses personnages. Il eut été bon de gommer la consternante romance aussi misogyne que mièvre entre le quadragénaire et la jeune fille du maire, exaspérante à force d’être lisse et dont l’unique trait de caractère est de le couvrir d’un amour si naïf qu’il renvoie à l’homme narcissique en middle life crisis une image positive de lui même, fut-il perclus d’addictions et eut il poussé par ses sautes d’humeur sa première femme au suicide. César improvise un discours prophétique pour les citoyens contraints par la destruction progressive de la ville à évoluer dans les airs sur des planches tenues en équilibre instable par des cordes dont les vibrations parasitent les dialogues. Dans une rime très marabout/ bout de ficelle, le motif de la corde réapparaît lorsque la femme du maire évoque la théorie physique du même nom, hypothèse qui permettrait de faire le lien impossible entre deux théories contradictoires, celle de la gravité et celle de la physique quantique.
Le film de Coppola se voudrait une théorie des cordes : réconciliation dans un grand barnum indigeste de formes du cinéma comme art forain, ce qu’il fut à ses débuts, avec son devenir immatériel, l’IA s’invitant au freak show gargantuesque et grotesque : grand chaudron shakespearien qui rassemble toutes les passions humaines. Comme un cinéaste débutant qui ne veut renoncer à aucune idée, Coppola jette dans son grand chaudron shakespearien toutes les passions de l’âme (la lutte pour le pouvoir politique, la soif d’argent, la pulsion de trahir les siens) et toutes les esthétiques. Faisant feu de tout bois, comme dans l’insert d’un clip enflammé d’une sorte de doule de Taylor Swift, il produit un testament bourratif et indigeste où cohabitent mal la tragédie, la dystopie et l’esthétique publicitaire.
Le fantasme du cinéma pris comme un spectacle vivant chatouillait Coppola depuis longtemps, on s’en souvient avec Coup de cœur (One From The Heart, 1982), qui cherchait à donner l’illusion du plan séquence et du direct. Film opéra, film tragédie, Megalopolis s’apprête, pour sa version festivalière, d’un truc en plus : aux deux tiers du film, un homme monte les marches micro à la main, s’installe face à l’image d’Adam Driver sur la scène, pose une question à César puis redescend dans l’obscurité par l’autre côté de la scène après sa réponse. L’utopie de César n’est que le reflet de celle de Coppola et de sa malle de magicien : bombarder le spectateur d’artifices pour mieux lui faire croire au réel.
Un monde de solitudes
Dans une tout autre économie, It Doesn’t Matter était présenté à l’ACID. Le deuxième long métrage de Josh Mond après James White en 2015 s’ouvre comme un film de confinement. Alvaro et son ami (interprété par Christopher Abbott qui jouait dans Martha Marcy May Marlene produit justement par Josh Mond) conversent via Skype, déplorant que le monde leur soit inaccessible depuis de trop longues semaines. Leur discussion amène à des flash-backs éclatés, tous convoqués par le truchement d’écrans, la plupart des images ayant été tournées au téléphone portable, dévoilant une dérive inexorable vers un monde où cohabitent des solitudes. Cette correspondance filmée ultra low-tech s’étend sur sept années, traversant la sortie erratique de l’adolescence de ces deux potes de toujours. Matinée de quelques incursions animées, elle dessine les contours d’une jeunesse en marge de tout. Même lorsque Alvaro entreprend un voyage à Hawaï, il n’en voit que des parkings, des zones périphériques, des mobiles home. Hormis l’échappée à Las Vegas qui embourgeoise le film le temps d’un week-end, ce sont surtout les galères financières, les conflits familiaux ou la drogue qui émaillent les monologues souvent drôles d’Alvaro en voix off, dont la mère après avoir émigré du Honduras, a trimé pour survivre. Portrait mal peigné d’une Amérique invisible, It Doesn’t Matter n’est jamais si beau que lorsque les lettres filmées analysent les vicissitudes de leur relation. Le dispositif de conversation susurrée à l’oreille d’un ami fidèle prévient cette confession de toute impudeur. La touchante amitié marquée par la dèche devient hilarante quand les deux jeunes hommes, ivres morts après une soirée à Las Vegas, se vocifèrent des reproches formulés dans le lexique de la communication non violente. La bromance accède là à une grâce certaine.
L’amitié du robot
Film-patchwork et film de confinement, c’est aussi ainsi que l’on peut définir le 10ème long métrage de fiction de Jia Zhang-ke qui s’est penché à l’orée de la pandémie sur des rushes de jeunesse non montés. Il tire de ces bouts de film tournés de manière spontanée un bilan des changements traversés par son pays ces vingt dernières années. Une femme (Zhao Tao) est abandonnée par son homme qui quitte soudainement leur campagne du Nord de la Chine pour tenter sa chance ailleurs. Elle finit par le retrouver, de longues années plus tard. Ce récit qui file droit, reconstitué à partir de bouts de tournage éparpillés sur 20 ans et à travers différentes provinces, sert de guide à un récit documentaire, celui d’une Chine rurale qui s’urbanise à grande vitesse, celui des cabarets de campagne qui laissent la place à des clips produits et diffusés sur les réseaux sociaux, celui de la disparition des relations de solidarité qui laissent place aux relations virtuelles. La valeur documentaire de ces documents et le sens du cadre fait de Caught By The Tides une curiosité à voir, même si l’argument narratif reste trop mince dans sa première partie. Après une première heure et demie erratique, on retrouve dans l’épilogue tournée en 2022, l’acuité du cinéma de Jia Zhang-ke, son intérêt pour la machine qui remplace le regard (le drone de sécurité qui zoome sur les étals de fruits et légumes d’un supermarché) et même, fait nouveau, la parole, dans une drôle de conversation entre le personnage de Zhao Tao et un robot serveur de restaurant qui, selon les émotions qu’il perçoit sur le visage de la femme, lui délivre des citations idoines, jusqu’à lui expliquer, dans une ironie désespérée, les bienfaits de l’amitié par le biais d’une citation de Mark Twain.
Le deuil d’une jeunesse perdue
Quatrième long métrage de Thierry de Peretti (avec qui nous nous étions entretenus juste avant le début du tournage), À son image remixe les primes années du Front de libération nationale corse (FLNC) à partir du décès d’Antonia, une jeune photographe qui en fut l’observatrice privilégiée. Récit qui rassemble lui aussi des flash-backs comme autant d’éclats d’un vase brisé, cette adaptation du roman éponyme de Jérôme Ferrari est l’histoire d’un deuil, celui d’une jeunesse perdue. Dans Une vie violente, Thierry de Peretti filmait la lutte politique en Corse dans les années 1990 essentiellement par des joutes oratoires masculines. Dans sa dernière scène, les mères des activistes, reléguées jusque là dans le hors champ de la lutte, donnaient, le temps d’un déjeuner dans un jardin, leur avis sur ces questions politiques dont elles étaient les victimes collatérales. À son image, à sa manière, continue cette scène en adoptant le point de vue d’une femme sur cette affaire d’homme qu’est la lutte indépendantiste armée en Corse dans les années 1980. Ce décadrage du regard ouvre l’espace à une pensée critique sur l’archéologie de cette histoire politique que la mort inaugurale voile d’une teinte funèbre.
Dans sa vingtaine, devenue photographe, Antonia quitte la publication locale où elle s’ennuie ferme à immortaliser des tournois de pétanque et entreprend un voyage dans une Yougoslavie alors en plein conflit. Elle rencontrera à Vukovar les questions identitaires dont elle a été bercée dans sa Corse natale, mais dans leur version déchainée et apocalyptique. La guerre de Yougoslavie est le miroir amplifié et déformant de la lutte pour l’indépendance, dont un combattant (le cinéaste yougoslave Vladimir Pericic dans un caméo fraternel), traduit les enjeux aux journalistes étrangers. Une lutte armée qui réussit, ce serait ça, ces tristes champs de ruines, cette désolation hivernale partout, la vie confinée aux hôtels internationaux fréquentés par les journalistes venus du monde entier pour filmer la fin de l’Europe (celle qui a obsédé Godard, on y revient toujours). L’objectif de son périple est un échec. Elle ne vendra à la presse aucune des photos prises sur place et les brûlera de dépit. L’organisation du FLNC tourne à la gabegie quand la vacuité du fantasme viriliste de guérilla dissout la légitimité de la lutte politique dans l’amateurisme de ses sbires et dans leur obstination à s’entretuer.
Mais À son image ne renie pas sa place, vissée aux yeux d’Antonia, et se fait aussi coming of age à travers les deux romances d’Antonia : elle commence par aimer Pascal, le héros de la lutte qu’elle aime regarder, comme dans la très belle scène où elle le photographie pendant qu’il lui tourne le dos, absorbé par une conversation téléphonique sur le rock-punk de Bérurier noir. Elle préférera ensuite l’amour plus discret de Simon, qui lui la regarde telle qu’elle aimerait se voir.
« Il faudrait les aimer malgré la noirceur de leurs âmes. Je n’y arrive plus » confesse l’oncle d’Antonia, à son directeur de conscience. Abattu par l’enterrement de sa nièce, le prêtre de la paroisse du village, interprété par le cinéaste lui même déporte encore le point de vue du récit sur les membres du FLNC. Le noir des âmes fait écho à celui de l’image. Après l’accident d’Antonia qui s’endort au volant dans un soleil irradiant, un carton noir offre un contraste saisissant entre la jeunesse radieuse et son funeste destin (porté par la somptueuse photographie de Josée Deshaies dont la lumière modèle les espaces avec un sens du volume inouï et varie comme dans un conte des quatre saisons). Ces cartons qui s’invitent à plusieurs reprises dans le défilement des images rappellent le procédé de l’obturateur, cette fermeture de l’iris qui permet de fixer l’image du réel.
Par instants, le cours d’À son image s’interrompt. Le mouvement des images se fige et cède la place à des photos qui immobilisent les corps, comme la fatalité annoncée que le présent n’est rien d’autre qu’un souvenir en devenir.
