Du Nouveau Printemps aux Ateliers des Arques – sur le tournant territorial des pratiques artistiques
Affaire de génération sans doute, quand il m’arrive de penser ou de me rendre à Toulouse, ce n’est pas l’hymne nostalgique de Nougaro que j’ai dans la tête, mais le chant sombre et entraînant des Stranglers, qu’aurait inspiré une prédiction de Nostradamus selon laquelle la ville rose serait rayée de la carte après une explosion : « Your streets were paved with love / Your skies were blue / Goodbye Toulouse / I walked your streets in fear / I washed your streets with tears / Toulouse ». Mais pas d’explosion ni de larmes pour l’inauguration du Nouveau Printemps ce jeudi 30 mai, plutôt un heureux bourgeonnement.
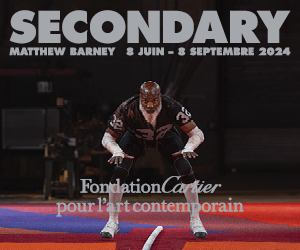
La nouvelle formule a deux ans et réunit, sous la présidence d’Eugénie Lefebvre, une direction artistique avisée – Anne-Laure Belloc jusqu’à fin 2023, Clément Postec depuis janvier 2024 – et un artiste associé à l’univers affirmé – la designer matali crasset l’année dernière, le cinéaste et écrivain Alain Guiraudie cette année. La manifestation repose sur un principe simple et efficace : la concentration des interventions artistiques sur un quartier spécifique, différent chaque année. Après Saint-Cyprien en 2023, c’est au tour du quartier historique des Carmes/Saint-Etienne d’accueillir la nouvelle édition, confirmant ainsi un fort parti pris territorial. Plus que sur la thématique retenue par Alain Guiraudie pour fédérer l’ensemble des propositions qu’il a réunies – pour dire vite : le rapport à l’avenir, avec toutes ses variantes possibles, entre promesse et inquiétude, utopie et dystopie – c’est à cette dimension territoriale que je voudrais ici m’intéresser, dans ses enjeux et ses modalités de mise en œuvre.
Il est clair qu’on assiste depuis quelques années à un tournant territorial des pratiques artistiques et des politiques culturelles. Sur le plan politique, on doit pouvoir dater le phénomène des années 1980, avec le mouvement de décentralisation, puis la création d’une politique de la ville qui venait cibler un certain type de territoire : moi
