Dans la maison vide – sur La fortune de Catherine Safonoff
Devenir vieille, devenir vieux. Voilà un projet raisonnable, facile et à la portée de chacun, mais auquel la plupart d’entre nous rechigne généralement. Ils ne sont pas si nombreux non plus, les écrivaines et écrivains à nous faire profiter de leur expérience du vieillir. En général, ils préfèrent continuer leurs petits tours poétiques, les concentrer, devenir toute littérature, même si y affleure in fine l’expérience du désassemblement. Par exemple Leiris, à 87 ans dans À cor et à cri (1988), réduit en éclats de lui-même, au milieu rumoral des « soubassements du monde » ; ou Duras signant un C’est tout (1995) en miettes où elle explique à Yann Andréa qui lui demande ce que « fait Duras » : « Elle fait la Littérature ».
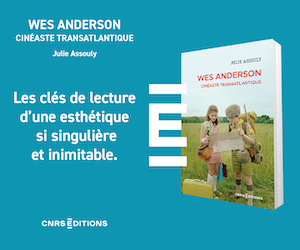
Une autre forme de livre de vieillard insiste sur la détresse et l’approche de la camuse, sans livrer toutefois la corde pour se pendre : La cérémonie des adieux (1981) de Simone de Beauvoir raconte les dernières années de Sartre, parfois atteint de délire et déclarant à une amie : « Toi aussi tu es morte, petite. Comment ça t’a fait d’être incinérée ? Enfin, nous voilà tous les deux morts, maintenant. » Le texte, perçu comme sacrilège, fit scandale en son temps. On pense aussi à la Lettre à D. (2006) d’André Gorz qui décrit la maladie de son épouse et s’achève sur ces mots : « Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l’autre. Nous nous sommes souvent dit que si, par impossible, nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble. » Ils se suicident l’année suivante.
Et puis il y a l’autobiographie stoïque, apaisée, du vieillissement. Cette fois, c’est plutôt Colette qu’on pourrait convoquer. On la trouve à la page 144 de la Fortune de Catherine Safonoff : « Je remontais vers la maison, me réjouissais de revoir Mélie ou de l’attendre. La plus haute des deux collines était devenue bleu noir, une masse de nuit surplombant la mer. Au-dessus, une seule étoile très brillante, l’étoile Vesper, disais-je à Mélie. En vé
