Möbius sentimental – sur Septembre sans attendre de Jonas Trueba
C’est un lever de rideau. Un matin d’été, Ale et Alex se lèvent, vaquent à leur routine matinale. Filmés à mi-distance, ils paraissent enserrés dans les embrasures de portes. Leur espace domestique crée des split-screens naturels. Rien que par leurs prénoms, ils ne font qu’un. Mais est-ce encore le cas ? Ne vivent-ils pas ensemble mais déjà séparément ? Et là l’étincelle. Ne serait-ce pas le moment idéal ? Pour se dire que c’est terminé, que leur amour a assez vécu ? Rien ni dans cette quiétude matinale, ni dans la lumière d’un mois d’août madrilène, ni surtout dans la confiance réciproque dont chacun de leurs regards est imprégné ne semblait avoir préparé à cela : c’est la fin (décrétée) de leur histoire d’amour. Il faut finir avant que cela ne devienne moche.
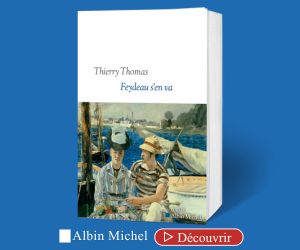
Paradoxalement, leur plénitude les a fait atteindre le point où ils peuvent accomplir le fantasme de tant de couples en crise : « réussir leur séparation » sans même passer par la case « sauver leur couple ». C’est fini, mais il n’y a pas d’abcès à crever, pas de vieux comptes à régler. Profitons-en ! Germe alors l’idée commune d’organiser, d’ici quelques semaines, une grande fête pour sceller la fin de l’union. On convie bien familles et amis pour les mariages. Quelle pudeur empêcherait la cérémonie inverse ? Et le voisin en vis-à-vis qui dit poliment bonjour de l’autre côté de la cour étroite ? On l’invite lui ? Après tout, il a toujours été le premier spectateur de ce théâtre intime.
Ce pitch peut laisser poindre une œuvre programmatique. Laquelle serait toute entière tendue vers la préparation de cette « divorce party », scandée par les réactions des ami.e.s (sur le mode « oh non, pas vous ! ») et possiblement conclue par une épiphanie durant ladite cérémonie (croiser son nouvel amour parmi les invités). Alors oui, il y a bien tous ces passages (obligés ?) dans le film, mais s’il fallait se contenter d’un tel déroulement, nous serions simplement face à l’œuvre d’un scénariste fatigué. Or, Septem
