Kafka punk – sur Dix versions de Kafka de Maïa Hruska
On a tant écrit sur Kafka. Tant commenté sa vie, son œuvre ; tant commenté les commentaires, tant critiqué, polémiqué, que la masse même des études kafkaïennes a repoussé Kafka loin de nous, sous des cieux où son œuvre n’est plus tout à faire sûre, un phénomène furtif sur lequel on accumule des conjectures fumeuses et des témoignages opposés, et que l’idée vous vient de fonder une science nouvelle capable de rendre compte d’une telle virtualisation des œuvres littéraires.
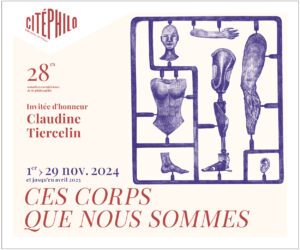
« Pour manquer fondamentalement les écrits de Kafka, on peut suivre deux voies, écrivait Walter Benjamin. L’une est l’interprétation naturelle, l’autre est l’interprétation surnaturelle ». Après un siècle d’exégèses, ces deux voies n’en font qu’une, l’interprétation totalisante.
L’œuvre de Kafka, brève et mate comme un silex, est aujourd’hui recouverte par le lichen de la kafkologie. « Kafka sera bientôt écrasé sous le fardeau des commentaires, et commentaires de commentaires, écrivait en 1953 Alexandre Vialatte son premier traducteur en français. On finirait par croire que Kafka est le nom savant d’une lèpre spéciale ou d’une religion compliquée (…) Kafka est d’abord un artiste. Et c’est l’artiste en lui dont on parle le moins. On l’étouffe au profit d’un penseur ténébreux. »
En employant ce mot « manquer » Walter Benjamin n’invitait pas seulement la critique à tourner le dos à l’interprétation, il lui confiait une tâche problématique : trouver Kafka. Mais où le chercher ? Dans son œuvre bien sûr. Mais quelle partie de son œuvre ? Dans les lettres privées ? Le Journal ? Les nouvelles qu’il a choisi de publier ? Les grands romans inachevés ?
« Quand on observe, écrivait Blanchot dès 1943, le désordre dans lequel nous est livrée cette œuvre, ce qu’on nous en fait connaître, ce qu’on en dissimule, la lumière partiale qu’on jette sur tel ou tel fragment, l’éparpillement de textes eux-mêmes déjà inachevés et qu’on divise toujours plus, qu’on réduit en poussières, comme s’il s’agissait de reli
