Nzambi, Zonbi et Zombi.e – sur « Zombis. La mort n’est pas une fin ? » au quai Branly
Le musée du quai Branly a l’âge de la maturité : 18 ans. Sa complexité constitutive ne s’est pas démentie. C’est une des institutions patrimoniales parisiennes les plus observées : par un public avide, qui n’a fait que croître et même se diversifier compte tenu d’une programmation culturelle ambitieuse, tant sur plan des expositions que sous l’angle des arts vivants.
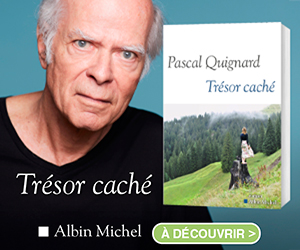
C’est aussi un point de mire de la critique internationale, qui avait repéré, dès son ouverture, à l’occasion du grand colloque sur les liens entretenus par l’histoire de l’art et l’anthropologie, le terrain miné, et alors impensé, sur lequel avait été fondé le musée.
En 2006, s’était posée – notamment par la voix retentissante d’une grande anthropologue et historienne de l’art des communautés noires de la Grande Caraïbe, Sally Price – la question de l’histoire de la colonisation au fondement des collections, avec laquelle l’architecture du bâtiment n’actait aucune rupture, en surjouant son caractère prétendu sauvage par les couleurs, les formes et la végétation. Depuis, s’est immiscée, dans le travail patrimonial de conservation et d’exposition, la question brûlante et concrète de la restitution des pièces spoliées dont le musée du quai Branly a la charge.
Le musée ouvrait donc sur une ambition compliquée qui, pour la résumer trop directement, tenait dans le fait d’exposer l’œuvre des Autres – on se rappelle l’exposition inaugurale : D’un regard, l’Autre – autrement dit : les arts non européens. Cette appellation avait d’abord laissé croire que la liquidation de la phraséologie primitiviste – en renonçant au terme « arts premiers » – suffirait à doter le musée d’une catégorie d’analyse plus conséquente, plus scientifique, alors même que la définition par la négative n’est pas exactement le produit de l’aboutissement d’une réflexion, mais bien le reflet de la crainte de ce qui pourrait surgir si on allait au bout de la pensée. Ainsi, la vie quotidienne du musée, son existence, son avenir, ses
