Hors d’état de nuire – sur Le Côté obscur de la Reine de Marie Nimier
Il y a juste vingt ans, Marie Nimier publiait un roman, La Reine du silence, très beau et fort remarqué, qui avait pour héros ambigu son père, l’écrivain Roger Nimier, mort dans un accident de voiture en 1962, quand elle avait cinq ans. Le livre qu’elle fait paraître aujourd’hui est son pendant maternel, si l’on peut dire, qui répond au roman antérieur jusque dans son titre : Le Côté obscur de la Reine.
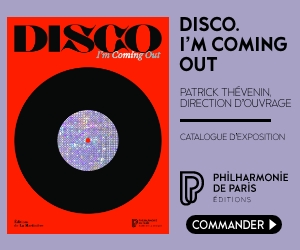
Mais il s’agit cette fois de la reine mère, quand celle du silence désignait la petite fille mutique, ou plutôt interdite de parole : d’une reine à l’autre, de la fille à la mère, il y a une longue histoire que nous raconte l’écrivaine dans ce qui n’est plus une fiction mais un récit autobiographique, conforme à la collection « Traits et portraits » qui l’accueille au Mercure de France. Ce sont des histoires plutôt qu’une seule, du reste, car le livre se construit dans le vrac apparent des scènes et des souvenirs, comme une sorte de puzzle impossible à achever et que la mort – puisque la mère, aujourd’hui, n’est plus – n’a pas tout à fait réussi à ordonner selon l’ordinaire chronologie des destins.
Il en va ainsi du livre comme d’une escalade à rebours, où il s’agirait d’atteindre le sommet des souvenirs, sans qu’on sache exactement ce qu’il peut bien être (n’est-ce pas plutôt le fond d’un gouffre ?) et quel secret s’y dissimule, peut-être, à l’ombre de l’oubli… Par quel côté y accéder ? La mère est un pic vers soi, d’une certaine façon, et les nombreuses images reproduites, photos de famille, dessins d’enfants, lettres à l’orthographe incertaine, interrogent la poésie possible des archives, à la recherche du sens perdu.
Cette mère, c’est Nadine, « Madame veuve Roger Nimier », comme on l’appelle, un personnage qui appartient par son mariage à l’histoire littéraire dorée des années cinquante… Les milieux parisiens que fréquentait le couple ont pu ainsi vanter sa beauté, sa blondeur, son port parfait, une présence et une prestance que tout le monde remarquait
