L’écriture flottante – sur Carnet de Londres de Lorenza Mazzetti
C’est à plus de quatre-vingts ans que l’artiste, cinéaste et écrivaine Lorenza Mazzetti (1927-2020) a publié Carnet de Londres, en 2014, quelques années après la réédition et la redécouverte en Italie de Le Ciel tombe, initialement paru en 1961, soit seize ans après la tragédie qu’il rapporte à hauteur d’enfant : le massacre de la famille adoptive de l’autrice par les nazis. Touche-à-tout de génie, Lorenza Mazzetti s’était entretemps reconvertie dans le théâtre de marionnettes – après tout, c’est toujours l’Histoire qui tire les fils de nos vies.
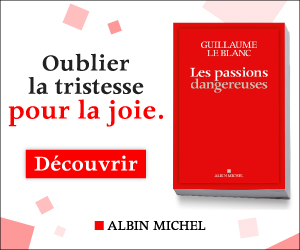
C’est donc à plus d’un demi-siècle de distance que Carnet de Londres (Diario londinese) raconte un long séjour à Londres au début des années 50, séjour durant lequel elle a tourné deux films expérimentaux qui ont fait date tout en participant activement à la naissance du mouvement « Free Cinema » avec Lindsay Anderson (futur auteur de If…, palme d’or à Cannes en 1969), Karel Reisz et Tony Richardson. Il s’agissait de libérer les réalisateurs du joug de l’industrie cinématographique, et le manifeste qui en a résulté annonce en bien des points le cinéma d’auteur et donc la Nouvelle Vague française ; surtout, il a ouvert la voie aux « Angry Young Men » qui devaient renouveler la scène dramatique et romanesque anglaise dès la deuxième moitié des années 50 avec Kingsley Amis, Edward Bond ou encore Harold Pinter.
Le matériau historique et biographique que restitue Carnet de Londres est donc en soi tout à fait passionnant : on y assiste au présent de la narration, dans l’émulation d’un joyeux bricolage dépourvu de financement, à l’émergence d’un mouvement esthétique qui s’est révélé déterminant.
Là n’est pas le plus important, pourtant, ni l’objet de cette critique.
Dès les premières pages, et jusque dans la remarquable traduction qu’en donne Lise Chapuis, sans esbroufe aucune, c’est d’abord et avant tout l’étrange facture de Carnet de Londres qui provoque une forme de fascination sinon de sidération, suspendant aussitôt
