Bourgeoisement et en bon père de famille – sur Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon
Il y a longtemps, les dépressif·ves chroniques, accablé·es de lucidité intellectuelle et donc de pessimisme, aux idées gigotant comme des ludions en tous sens, fatigué·es d’elle·ux-mêmes, disaient par manière de plaisanterie : « Je vais aller me faire lobotomiser. » À la page 271 de sa première non-fiction narrative, Adèle Yon cite le témoignage d’une vraie lobotomisée des années 1950 : « Depuis l’opération c’est bizarre il faut que je raisonne pour avoir du chagrin. (…) je pense que je suis plus indifférente, plus près des animaux. (…) Je suis aussi malheureuse qu’avant mais je suis moins sensible. »
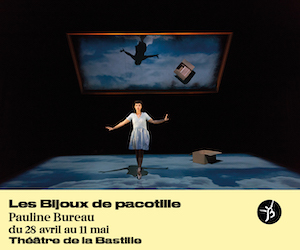
Certains antidépresseurs des années 1990 produisaient un effet similaire, sans doute moins puissant : l’impression de glisser une armure de plomb entre le monde et nos émotions – mais c’était réversible. Et la lobotomisée citée ici est en outre une sorte de rescapée, car les effets de cette mutilation mentale étaient généralement bien plus dévastateurs.
Avec Mon vrai nom est Elisabeth, Adèle Yon, trente ans, normalienne et cheffe de cuisine (c’est écrit dans le rabat du livre), part du cas de son arrière-grand-mère, « Betsy », lobotomisée en 1950 et éloignée de son foyer, pour développer une enquête passionnante sur cette opération monstrueuse, avant de revenir à l’histoire de sa famille. C’est non sans mal : la plupart des archives médicales sont en effet manquantes ou détruites et, note l’autrice avec humour, « les habitués des centres d’archives ne sont pas loin de ce que je me figure être les pèlerins de Lourdes, exhibant leurs moignons devant des représentations de la Sainte Vierge en priant pour un miracle ». Heureusement, « les archivistes font des miracles ». Mais comme dans tout bon polar, ces preuves thaumaturges ne seront produites qu’à la fin.
Avant ça, l’autrice dispose d’une vaste famille qu’elle part interviewer membre par membre et dont elle restitue les paroles dans un dispositif remarquable, en verbatim (et dans une typo de machine à écrire)
