La possibilité d’un écrivain – sur L’impassible de Frédéric Berthet
L’histoire littéraire s’est toujours nourrie dans ses marges, larges ou étroites, d’écrivains « cultes » dont on ignorait en leur temps le devenir. Souvent, ils appartiennent à une époque précédant plus ou moins lointainement leur consécration, que l’on juge presque par principe moins terne, mais qui, si on l’avait vécue, peut-être nous aurait semblé également désespérante. C’est Frédéric Berthet qui nous fait venir de telles pensées, lui qui est l’objet aujourd’hui d’une espèce de petite « mythologisation » : son destin, plutôt bref, qui s’arrête à peu près avec le siècle précédent, s’y prête assez bien.
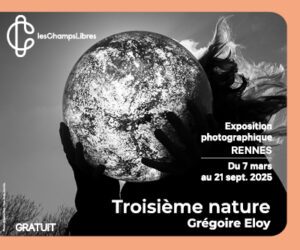
Rappelons-le. Normalien doué et jeune bourgeois à l’aise dans le monde autant que dans les livres, Berthet est un astre monté de sa province pour en découdre avec les early eighties auxquelles il est difficile de ne pas l’associer. Féru de Kafka et jet-setter sollersien, il incarne le brio que ne réussissent pas forcément à avoir les « néo-hussards », ses contemporains : il écrit à l’économie, connaît un certain succès avec une sorte de roman « Minuit » de droite, Daimler s’en va, et livre des textes par-ci, par-là. Il boit. Il se retire tôt comme un vieil écrivain dans un manoir du Berry, mais il n’a pas 50 ans et au fond il n’a pas écrit grand-chose. Est-il vraiment de droite ? Il est l’ami de Jean Echenoz et a été le coturne à la rue d’Ulm du facétieux psychanalyste et essayiste à succès (ou presque), Pierre Bayard, qui partage avec lui quelque chose qu’on appellera, faute de mieux, l’humour : un humour désabusé, ou plutôt un désabusement drôle qui peut virer sans prévenir au désespoir. On le retrouve mort dans son appartement parisien, à la Noël 2003.
Tout cela, ce sont de petits biographèmes faciles, presque des éléments de folklore, auxquels il faudrait ajouter encore son rapport singulier à l’Amérique et son expérience d’Attaché culturel à New York, son amour des jeunes filles et son goût des Bentley, mais ils ne disent rien au fond de la possibili
