Jusqu’où perdre – sur Arles 2025, les rencontres de la photographie
Le jour où l’on arrive, François Bayrou vient d’être dissous, tandis qu’à l’étranger les chefs illibéraux bandent tout leur soûl. Avant de venir, on avait repéré dans le catalogue des Rencontres quatre photos d’hommes acéphales : peut-être cela avait-il un rapport ?
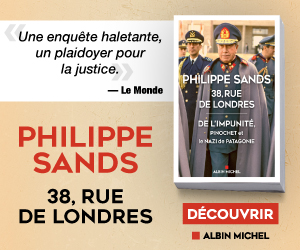
Le non dupe erre
Des pères étêtés chez Camille Lévêque (« À la recherche du père ») et Diana Markosian (« Père »). Le visage effacé d’un assassin de son père pour Jean-Michel André (« Chambre 207 ») : Inculpé Gouttenoire (2023). Des trois, seule Camille Lévêque fait un lien politique direct en montrant un portrait de Staline lacéré. Son installation (comme assez souvent celles présentées à Ground Control, à côté de la gare) fait la part belle aux images trouvées, photos publicitaires, objets kitsch (mugs et statuettes à la gloire du « meilleur papa du monde »). Qu’est-ce qu’être un bon père ? Quels clichés genrés s’attachent à cette figure, qu’elle soit considérée comme absente ou présente ? Il y a des archives de famille, une vitrine consacrée au fantasme incestuel avec petites culottes roses marquées « J’appartiens à papa ».
Après deux jours de déambulation, c’est une des expositions qui restent en mémoire – parce que c’est la première qu’on visite en sortant du train – et que s’y pose la question photographique de base : qu’est-ce que je regarde ? Le contenu dénotatif de l’image ? Le regard de cellui qui l’a prise ? Une captation du supposé réel ? Sa construction ? Questions d’échelle et de distance aussi : scopophilie empêchée / reflétée / favorisée. Peut-être la distance intellectuelle est-elle ici maximale. Cinq cent mètres plus loin, dans les combles du Monoprix, la Russo-Américaine Diana Markosian construit une sorte d’espace mémorial (obscurité, meubles, papier peint vintage et musique mélancolique) pour parler des retrouvailles avec un père séparé : toutes les photos sont dédoublement, reflet, difficulté à percevoir, culminant dans l’image d’une chemise sur un cintre, emballée dans s
