Un rêve de miroir – sur Quelqu’un, tout le monde et puis personne de Philippe Forest
Dans le texte intitulé « Sur les classiques » et repris quelques années plus tard dans le volume Autres inquisitions (1952), Borges proposait cette définition à laquelle aucune œuvre ne saurait mieux correspondre que celles de Shakespeare ou de Dante : « Est classique le livre qu’une nation ou un groupe de nations ou les siècles ont décidé de lire comme si tout dans ses pages était délibéré, fatal, profond comme le cosmos et susceptible d’interprétations sans fin. […] N’est pas classique (je le répète) un livre qui nécessairement possède tel ou tel mérite ; c’est un livre que les générations humaines, pressées par des raisons différentes, lisent avec une ferveur préalable et une mystérieuse loyauté. » C’est dans le même volume que Borges a écrit ce bref apologue que Philippe Forest a placé en exergue de son Shakespeare et dont il tire le leitmotiv de toute sa première partie : « Shakespeare ressemblait à tous les hommes, sauf en ceci, qu’il ressemblait à tous les hommes. Au fond de lui-même il n’était rien, mais il était tout ce que sont les autres, ou tout ce qu’ils peuvent être. »
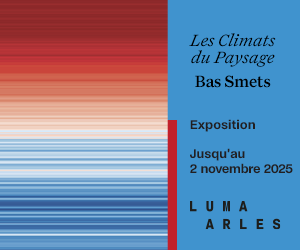
C’est tout le paradoxe qu’affronte Philippe Forest en ces pages, et sur lequel il insiste longuement dans le premier tiers du livre avant d’y revenir en conclusion : comment, sauf à chercher dans l’œuvre matière à inventer un ersatz de vie légendaire, peindre un homme qui ressemble comme personne à tout le monde et d’autant plus aisément qu’il n’a pas laissé davantage de traces matérielles que les plébéiens de son époque, une époque où s’inventait si joyeusement le théâtre moderne à la marge des villes et durant laquelle nul ne se souciait encore d’accorder valeur sociale aux faiseurs de comédie ?
À poser d’emblée un refus de la solution de facilité qui consiste à passer incessamment du contexte historique à l’œuvre pour combler le vide laissé par la vie du dramaturge, se lancer dans un essai biographique à propos de Shakespeare et prétendre s’y tenir, ce n’est pas rien – et si
