Jézabel Couppey-Soubeyran : « Les autorités publiques voient toujours la finance comme un moteur inépuisable de la croissance »
Dix ans après la crise financière qui a fait trembler l’économie mondiale à la fin de l’été 2008, l’heure est au bilan. Il faut se souvenir de l’impact de la nationalisation de Fannie Mae le 6 septembre, ou de la chute de Lehman Brothers la semaine suivante. Face au cataclysme et à la découverte par le public de la folie qui s’était emparée de l’économie financière – et dont le krach a bien failli entrainer toute l’économie – les pouvoirs publics du monde entier, dirigeants politiques et banquiers centraux, ont défilé pour jurer qu’ils allaient y mettre bon ordre. La suite de l’histoire a montré que derrière les déclarations d’intention, la réalité a été bien timide. Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences en économie à l’université Paris 1, spécialiste des banques, de l’instabilité et de la régulation financière, revient pour AOC sur ces dix ans qui auraient pu changer les choses. RB
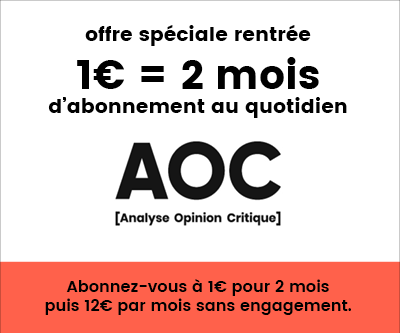
Dix ans après, peut-on dire qu’on est passé très près du gouffre au moment de la crise financière de 2008 ?
Ce fut un véritable cataclysme, et le gouffre ne fut évité que grâce à des interventions plus promptes et plus massives qu’en 1929. C’est un narratif sur lequel on pourrait toutefois revenir. Les banques centrales avaient tiré de 29 la leçon qu’elles n’étaient pas intervenues suffisamment vite et suffisamment fort pour rétablir la liquidité des banques et des marchés. Elles ont depuis appris à le faire. Le fait est que les interventions de la Fed, de la BCE et des autres banques centrales – interventions assez promptes même si la Fed a été plus rapide que la BCE – ont été salutaires. Mais l’on peut aussi mettre en avant des aspects paradoxaux. Par exemple, ces banques centrales qui nous ont évité de tomber dans le gouffre, en intervenant rapidement pour fournir toutes les liquidités aux banques, pour acheter massivement des titres sur les marchés qui sinon auraient sombré, ont elles-mêmes leur part de responsabilité dans le déclenchement de la crise. Surtout, peut-être préparent-elles aujourd’hui la crise de demain en continuant de mener des politiques monétaires très accommodantes. C’est très ambivalent tout ça. Il faut tout de même se rappeler qu’au début des années 2000, les taux des crédits étaient bas, le coût de l’argent était bas, et c’est ce qui a favorisé la constitution d’une formidable bulle de crédit. C’est l’un des pans importants de l’explication de la crise. Or, depuis dix ans, les politiques monétaires qui sont menées pour gérer les conséquences de la crise sont toujours très accommodantes et ça a alimenté de nouvelles bulles de prix d’actif comme par exemple sur les marchés obligataires. La normalisation des politiques monétaires qui se profile et la remontée des taux d’intérêt qui en découlera menace de faire exploser ces bulles.
L’analyse que vous faites aujourd’hui s’appuie-t-elle sur une meilleure connaissance des mécanismes financiers ? Comme ce fut le cas pour la crise de 1929, celle de 2008 a-t-elle permis une avancé dans la compréhension de ces phénomènes ?
Disons qu’on commence à avoir une vision plus claire de ce qu’on appelle le « cycle financier ». D’abord, la phase d’expansion financière qui se caractérise par un emballement des crédits et des prix d’actif, amène les investisseurs sur les marchés à être très optimistes, ils s’endettent massivement, achètent des titres et donc mécaniquement ils font monter les prix. Ensuite, le fait de voir monter les prix favorise la possibilité de contracter de nouvelles dettes, parce que les actifs dont les prix montent constituent des collatéraux, des éléments de garantie qui sont apportés par les emprunteurs quand ils contractent un nouveau prêt. Vous avez donc des sortes de boucles : les agents s’endettent, ils achètent des actifs, ces achats font monter les prix d’actifs, cette augmentation des prix d’actif augmentent les garanties pour contracter de nouvelles dettes… Cette boucle entre crédits et prix d’actifs, on commence à bien la comprendre. Sur cet aspect, la crise a permis de redécouvrir des travaux anciens, comme ceux d’Hyman Minsky qui met très bien en évidence ce cycle. On retient de cet économiste américain ce qu’on appelle rétrospectivement le « moment Minsky », ce point de retournement avant la phase de repli brutal. La leçon qu’on devrait avoir tiré de tout ça, c’est qu’il faut tempérer ce cycle financier, le réguler. Est-ce qu’on y parviendra ? Pas sûr. Car si l’on regarde les politiques mises en œuvre depuis la crise, hors intervention des banques centrales, que ce soit en matière de régulation financière ou de politiques prudentielles, on reste à un niveau très « micro ». Le moins qu’on puisse dire c’est qu’on ne s’est pas placé dans une perspective globale de régulation du système ou du cycle financier, on a plutôt cherché à s’assurer que chaque banque gère correctement ses risques et son activité de manière prudente. De ce point de vue là, il y a eu des choses de faites. Dans la perspective globale pas encore, du moins c’est loin d’être suffisant.
Pourquoi et comment ces mesures « contracycliques » que vous appelez de vos vœux permettraient-elles, si elles étaient mises en œuvre par les responsables politiques, d’éviter de nouvelles crises ?
On a bien compris les dangers qu’il peut y avoir à mener des politiques qui accentuent le mouvement du cycle économique et du cycle financier. Il ne faut pas mettre de l’huile sur le feu dans les périodes ascendantes, et il ne faut pas prendre des mesures trop austères dans les périodes descendantes. Ce qui signifie notamment que nos dirigeants doivent s’efforcer de calmer les ardeurs quand l’économie marche bien. Politiquement, c’est évidemment très compliqué et cela suppose beaucoup de pédagogie car c’est contre-intuitif de ralentir volontairement la croissance des marchés, et les bénéfices ne s’en font sentir que sur le moyen-long terme. Il faudrait pourtant qu’on soit capable de détecter plus rapidement les emballements du crédit, de prix d’actif, et qu’on les restreigne. On le sait, et la crise de 2008 nous renseigne de manière très claire à ce propos, quand on est déjà bien avancés dans la phase ascendante, il faut limiter l’endettement des emprunteurs et exiger plus de prudence de la part des prêteurs. C’est ce qu’on a commencé à faire, à travers des mesures qu’on appelle « macroprudentielles ». Malheureusement, ces initiatives restent encore assez dispersées, que ce soit dans la mise en place de nouveaux instruments comme dans la création d’institutions capables de les mobiliser. Il y a tout de même quelques dispositions dans les accords de Bâle III sur lesquels il faudra revenir. Mais cela reste des microtouches de macroprudentiel, alors qu’il faudrait que ces dispositions macroprudentielles, visant à réguler le cycle financier et à rendre plus résilients les grands acteurs financiers systémiques, aient autant d’importance que celles dites microprudentielles, axées sur la prévention des risques individuels. On en est loin.
Rétrospectivement, on peut avoir le sentiment que les conséquences de la crise ont été tirées très vites par les décideurs, qui se sont rencontrés à Washington pour le G20 de 2008, et par la mise en branle du processus qui aboutira aux accords de Bâle III visant à mettre en place des dispositifs prudentiels, et à limiter les risques financiers. Au plan national, on a alors entendu évoquer l’idée d’une séparation entre les banques de détail et les banques d’affaires. Qu’a-t-il manqué pour que cette apparente prise de conscience se traduise réellement dans les actes ?
Effectivement, au moment de la crise, il y a eu une prise de conscience, mais qui s’apparentait plutôt à une peur. La crise est un moment effrayant mais qui pousse à l’action. La prise de conscience s’opère aussi bien du côté politique que du côté des instances de régulation monétaires et financières. Et des réformes assez importantes sont prises pour rendre les banques plus solides, comme Bâle III dont il faut rappeler les axes principaux. D’abord, exiger des banques qu’elles aient davantage de fonds propres. Mais ce n’est pas forcément suffisant pour leur permettre de résister à une crise de liquidité. Elles doivent donc aussi, en cas d’incapacité à se refinancer sur les marchés interbancaires, avoir la possibilité de revendre des actifs sans trop de pertes. Cela suppose d’avoir suffisamment d’actifs liquides de qualité, et de ne pas être trop dépendantes de ressources de très court terme, d’où l’introduction d’exigences de liquidité. Bâle III introduit aussi une petite disposition qui fait encore débat entre les anglo-saxons et les autres : le ratio de levier, qui simplifie les exigences de fonds propres. Telle qu’elle a été introduite, cette disposition n’est toutefois pas très contraignante. Il y a enfin ces quelques microtouches macroprudentielles que j’ai déjà évoquées : une surcharge de fonds propres pour les établissements systémiques – ces établissements qui, par leur taille, leurs interconnexions, la complexité de leurs activités, le caractère indispensable de certaines de leurs activités, font peser un risque d’effet domino en cas de chute. L’autre microtouche, c’est un coussin de fonds propres contra-cyclique : un instrument de régulation du cycle mais qui reste très mineur, entre 0 et 2,5% de fonds propres supplémentaires en fonction de la position dans le cycle déterminée par l’autorité prudentielle compétente. Bâle III c’est ça : plus de fonds propres en quantité et en qualité, plus de liquidité, un ratio de levier et deux micro touches macroprudentielles.
Qu’est-ce qui a manqué alors ?
Ce qui a manqué, c’est que tout ça se cantonne au niveau micro, et surtout que ça ne reste que prudentiel. C’est une grande différence avec ce qui s’est passé en 1929 : à l’époque les Américains étaient allés jusqu’à faire une véritable réforme de structure du secteur bancaire, avec la mise en place du Glass Steagall Act. Même si je ne suis pas absolument convaincue qu’une séparation des activités (prêt et dépôt) soit une bonne façon de réformer la structure bancaire. Ce dont je suis convaincue en revanche, c’est qu’il y a des problèmes très importants concernant cette structure bancaire, des problèmes qui ont leur part de responsabilité dans la crise et auxquels on n’a absolument pas remédié. C’est, par exemple, la taille excessive de certains établissements. Le Financial Stability Board, un organisme qui établit depuis quelques années une liste de ces établissements faisant peser un risque systémique, en recense 30 dans le monde. 30 établissements qui sont en position de domination sur les marchés bancaires, mais aussi sur l’ensemble des autres marchés de capitaux : changes, dérivés, obligataires… ils sont en position de domination absolument partout. Au niveau mondial, ça se traduit par un véritable oligopole bancaire. Or, dans tous les manuels standards d’économie industrielle on sait que là où il y a un oligopole, il y a des possibilités d’entente, de fraude… Et ce n’est pas que théorique, ces fraudes ont été manifestes dans le secteur : on se souvient du scandale du Libor – la manipulation du taux international des prêts interbancaires – mais il y a eu aussi des manipulations sur les marchés des changes, sur les marchés de produits dérivés. Beaucoup de ces grandes banques ont été sanctionnées, essentiellement aux États-Unis, mais l’Europe pourrait très bien en faire autant. Donc ça, ce sont des problèmes de structure, de taille excessive des établissements bancaires.
Et il y a aussi le problème de la concentration
Oui cela va de pair, ces mastodontes systémiques ont un énorme pouvoir de marché ! Le secteur bancaire est incroyablement concentré au niveau mondial, européen et dans un certain nombre de pays dominés par un petit nombre de très gros établissements. C’est une situation préjudiciable tant pour le consommateur de services bancaires et financiers, qui paie plus cher les services, que du point de vue de la stabilité financière puisque cela fait peser un risque systémique. Et qu’a-t-on fait contre ça ? Rien. Au contraire on continue d’encourager la consolidation des établissements bancaires et donc la formation de très grands établissements. On observe à chaque crise la concentration naturelle du secteur : les établissements qui restent solides absorbent les plus fragiles. Les autorités financières devraient être vigilantes face à ça, mais ça suppose encore une vision globale et de long terme.
Il y a tout de même eu quelques mesures structurelles de séparation.
Je ne dis pas qu’il n’y a rien eu. Mais d’une part les mesures de séparation qui ont été prises n’en sont pas vraiment, en rien comparables en tout cas à celle de 1933 aux États-Unis. D’autre part, je ne suis pas sure que les mesures de séparation soient les plus efficaces pour réduire la taille et la concentration excessive du secteur bancaire. En France, on peut citer la loi de séparation et de régulation de l’activité bancaire. Mais, de l’avis des grandes banques elles-mêmes lorsque leurs dirigeants ont été auditionnés par nos parlementaires, elle ne sépare vraiment pas grand-chose. Au Royaume-Uni, il y a eu le rapport Vickers, mais qui n’est pas encore entré en application, et aux États-Unis, les règles Volcker dans le cadre du Dodd-Franck Act, que Donald Trump entend défaire. Et enfin, au niveau européen, on peut citer ce rapport commandé par la Commission, le rapport Liikanen, qui avait inspiré une réforme proposée par Michel Barnier, mais elle a été depuis largement mise sous le tapis. Donc, si on fait le bilan, aucune action structurelle d’envergure n’a été menée. En résumé, on aurait eu besoin, au niveau instrumental, de renforcer le microprudentiel, ce qui a été un peu fait avec Bâle III, mais aussi de faire macroprudentiel et du structurel, et là il n’y a pour ainsi dire rien eu.
Vous avez co-signé avec Laurence Scialom et Vincent Bignon un rapport pour Terra Nova qui doit être rendu public lundi 3 septembre et qui fait le « Bilan des réformes bancaires et financières depuis 2008 ». Vous y abordez la question des fonds propres et des problèmes de structure qu’on a déjà évoqué, mais aussi un troisième point, les dispositifs de résolution en cas de crise. On se souvient qu’en 2008 ce sont les États et donc les contribuables qui ont renfloué les banques par les mécanismes du Bail out. Est-ce que les mesures prises depuis vous apparaissent satisfaisantes ?
Oui on disait, et on dit toujours d’ailleurs, que certains établissements étaient Too Big To Fail, trop gros pour faire faillite. C’est une contrainte très forte, cela veut dire que pour éviter un effet d’entraînement, certains établissements doivent absolument être sauvés. Et on ne s’est pas encore affranchis de cette contrainte. S’ajoute à ce problème, celui du Too Big (or too complex) To Manage, des établissements tellement gros ou si complexes dans leur modèle d’activité qu’ils sont devenus ingérables. Donc on a mis en place des dispositifs de résolution indispensables qui auraient par exemple, s’ils avaient existé en 2007-2008, sans doute permis de mieux organiser la faillite de Lehmann Brother avec potentiellement moins de conséquences systémiques. Je pense notamment aux mécanismes de résolutions mis en place dans le cadre de l’Union bancaire européenne, qui consistent à mobiliser davantage les créanciers des établissements bancaires en cas de problème. Auparavant, c’était toujours pile la Banque gagne et face l’État perd. Là, il s’agit de faire en sorte que les créanciers mettent la main à la poche. Évidemment il ne s’agit pas de mobiliser les petits déposants, qui sont protégés par la garantie des dépôts, mais bien les détenteurs de titres obligataires ou de titres subordonnés émis par les banques. Titres qui peuvent en cas de problèmes être transformés en actions, et devenir ainsi des titres non remboursables, des obligations dont on va reporter le remboursement ou encore dont on va limiter le remboursement. Le Bail in, c’est-à-dire le renflouement interne par la mobilisation des créanciers, c’est une partie importante de ces dispositifs de résolution. Ça passe également par l’établissement de plans et la mise en place d’un fonds de résolution.
C’est au moins un point sur lequel on a tiré les enseignements de la crise.
Oui, tout ça va dans le bon sens, mais on n’est pas encore sûr que cela puisse bien fonctionner. Notamment en Europe, on a eu quelques doutes concernant les banques italiennes. Lorsqu’il a fallu mobiliser ces dispositifs pour des banques importantes sur le plan domestique mais pas énormes pour autant, comme la Monte dei Paschi, ils ont montré leurs insuffisances. Pour une raison assez simple, les banques italiennes avaient vendu les titres obligataires qu’elles avaient émis à leurs propres clients. Ce qui veut dire que les créanciers mobilisables dans le cadre du Bail In pour les banques italiennes sont en partie les déposants. Et ça, ça pose un problème évidemment parce qu’on ne peut pas faire fonctionner le Bail in dans ces conditions, en mobilisant les déposants. On ne peut pas le faire fonctionner non plus d’ailleurs en mobilisant d’autres établissements systémiques, au risque de créer un effet domino. Ça montre qu’on a peut-être négligé un aspect dans la mise en place du Bail in, c’est la question de savoir qui sont les créanciers mobilisables, autorisés à détenir des titres mobilisables. Il y a des choses à améliorer pour s’assurer que ce ne soit plus aux États de renflouer les banques. De la même façon, au niveau de l’Union Européenne, le fonds de résolution qui a été mis en place fonctionnera à plein régime d’ici plusieurs années avec 55 milliards d’euros… ce n’est pas énorme, 55 milliards d’euros, comparé aux aides et garanties qu’il a fallu apporter en Europe pendant la crise. Donc, il y a quelques doutes sur ces dispositifs dont pour autant on a grand besoin. Il faut le reconnaitre, sans non plus tomber dans le panneau du discours du lobby bancaire qui à propos des dispositifs de résolution parlaient d’une spoliation des déposants afin de discréditer ces dispositifs et en empêcher la mise en place.
Dans le rapport Terra Nova, vous avez à ce propos une expression intéressante, vous évoquez une gouvernance qui doit repenser « l’écologie des échanges ». Qu’entendez-vous par là ?
C’est en effet un point complémentaire dans le rapport. On entend par là qu’il fallait aussi changer l’environnement des transactions financières, rendre cet environnement moins opaque et limiter les risques de contagions. On a parlé des réformes prudentielles, on a évoqué la dimension macro et la dimension micro, on a vu qu’on avait fait du prudentiel mais qu’on n’avait pas fait de structurel, on a évoqué les dispositifs de résolution… Il y a un autre pan qui concerne plus l’organisation des marchés et des dispositifs de surveillance des banques. C’est là qu’intervient un autre acteur qui a pris de l’importance après la crise de 2008 : les chambres de compensation. Elles interviennent au niveau de l’organisation des marchés, et en particulier de celle des marchés de produits dérivés qui sont des instruments de transferts de risques. Si la crise des subprime a pu dégénérer en crise systémique c’est en partie du fait de la multiplication des instruments de transfert des risques qui ont disséminé le risque subprime partout dans le système financier. Dans une opacité totale. Si l’on veut faire ressortir les éléments clés de la crise, il y a la fragilité des agents financiers qui étaient très peu capitalisés et donc incapables d’assumer leurs pertes ; il y a l’interconnexion des acteurs du fait de la globalisation financière et donc un phénomène de contagion inévitable ; et puis le troisième élément clé, qui a un rapport avec la mise en place des chambres de compensation, c’est l’opacité des transactions. Une opacité particulièrement importante sur les marchés de produits dérivés puisque les transactions sur ces produits se faisaient pour les quatre cinquièmes d’entre elles sur des marchés dits de gré à gré, qui sont non centralisés et non réglementés. Donc une des actions menées pour réformer l’organisation des marchés de produits dérivés a été de généraliser le principe des chambres de compensation, qui étaient déjà présentes sur les marchés dits « organisés ». C’était une évolution nécessaire, mais ce faisant on a mis en place de nouveaux intermédiaires qui concentrent sur eux la prise en charge de risques. Et donc potentiellement la généralisation des chambres de compensations fait apparaitre de nouveaux acteurs systémiques. Si on ne contrebalance pas ça par une action macroprudentielle plus forte, et bien ça pourra avoir un effet déstabilisant. C’est pour ça qu’il faut absolument que les réformes soient menées dans les différentes dimensions nécessaires pour appréhender les risques, à la fois individuels et systémiques. Si on ne fait que des réformes par petites touches, si on ne va pas au bout le remède peut s’avérer pire que le mal. Et les lobbys, qui sont très malins, l’ont bien compris. C’est là qu’ils peuvent imposer leur rhétorique qui consiste à insister sur les effets pervers des réglementations. Donc dès qu’on essaie de conduire des réformes, leur stratégie consiste à essayer de freiner la mise en place des dispositions voulues par le régulateur, d’en réduire la portée, de mettre en place des exceptions… de faire en sorte en somme que ça n’aille pas jusqu’au bout. Comme ça ne va pas jusqu’au bout, ça perd en efficacité, et donc effectivement le remède peut se révéler pire que le mal, et ils peuvent alors affirmer que leur prophétie s’est réalisée.
Un autre facteur de l’opacité que vous évoquez, c’est la question de la complexité. Mais la finance n’est-elle pas toujours apparue comme une chose complexe ?
Oui mais aujourd’hui, même pour les spécialistes, cela dépasse tout ce qu’on a pu connaitre. Quand vous prenez des produits sur les marchés dérivés, ou des produits structurés issus des opérations de titrisation, vous êtes dans quelque chose de difficile à appréhender et donc nécessairement à contrôler. Il y a aussi les structures capitalistiques, qui comptent des centaines de filiales, dont certaines dans les paradis fiscaux. Donc absolument tout le monde reconnait aujourd’hui que la finance est devenue extraordinairement complexe. Le régulateur a malheureusement plutôt cherché à épouser cette complexité, et y a répondu par des règles elles-mêmes extraordinairement complexes pour certaines. Si vous entrez dans les détails de Bâle III, par exemple dans les ratios de fonds propres pondérés par les risques, avec la possibilité pour les banques d’utiliser des modèles internes d’évaluation, le moins qu’on puisse dire c’est que ça ne respire pas la simplicité. Ce qu’on démontre dans le rapport c’est qu’au final les régulateurs ont épousé le mouvement à travers les réformes mises en place, et ce faisant surenchérissent la complexité, plutôt que de prendre des mesures pour simplifier les structures ou les produits. Nous soutenons qu’il y aurait la possibilité de simplifier grandement par exemple les exigences de fonds propres en s’appuyant sur une disposition qui existe dans Bale III, mais qui en l’état est très peu contraignante, c’est le ratio de levier. Comme je l’évoquais, il y a un grand débat entre banques américaines et européenne à ce propos, parce que les Européens estiment qu’il est plus facile pour les Américains de respecter ce type de dispositions pour des raisons de normes comptables qui réduisent mécaniquement la taille des bilans des banques américaines. Le ratio de levier consiste simplement à rapporter les fonds propres au total du bilan, et éventuellement quelques éléments hors bilan. Le vérifier est très simple en consultant le bilan d’une banque dans son rapport annuel. Allez vérifier le ratio pondéré par les risques, c’est une autre paire de manches. Ce qu’on met également en avant à propos de la complexité c’est que c’est une erreur de continuer d’épouser la complexité du système à travers des règles qui sont elles-mêmes extraordinairement complexes car c’est nécessairement un facteur d’inefficacité. Plus c’est complexe, plus le contournement, plus l’optimisation des règles seront aisés. C’est aussi un extraordinaire facteur de capture. Lorsque le régulateur cherche à épouser cette complexité, il est nécessairement amené à consulter beaucoup les acteurs du secteur bancaire. Au point parfois que le secteur bancaire en arrive à rédiger lui-même la loi censée le réglementer.
Vous avez évoqué les lobbys à plusieurs reprises. C’est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques jours à propos de l’environnement, suite à la démission de Nicolas Hulot. La situation dénoncée par l’ancien ministre de l’écologie est exactement la même dans le secteur financier ?
Exactement, le diagnostic est le même, on peut déplorer la mainmise du lobby bancaire sur la politique de régulation financière, comme Nicolas Hulot l’a fait sur la politique environnementale. Il y a vraiment un parallèle évident. Le plus désolant dans tout ça, c’est que progressivement les autorités de supervision, les banques centrales se laissent imprégnées par les valeurs et du secteur bancaire et financier, fonctionnent en recrutant essentiellement leur personnel dans ce secteur en justifiant cela par un besoin d’expertise et en considérant que c’est un gage d’efficacité. Alors que plus ces acteurs prennent une part importante dans le fonctionnement des dispositifs de régulation, plus celle-ci est élaborée en tenant compte de l’intérêt des banques plutôt que de l’intérêt général.
Quel est le rôle joué aujourd’hui par la politique ? Est-ce que vous avez le sentiment que 2008 a marqué un tournant dans la confiance, ou l’ignorance, de nos représentants vis-à- vis de l’économie financière ?
J’ai le sentiment que la philosophie, la perception des autorités publiques n’a pas changé. Même après la crise de 2008, elles voient toujours le développement de la finance comme un moteur inépuisable de la croissance. Ils n’ont pas pris conscience de l’hypertrophie du secteur bancaire et financier et du préjudice que ça cause à l’économie réelle. Cela a pour effet d’encourager continuellement l’endettement du secteur privé. Il y a une schizophrénie incroyable dans la mesure où vous trouverez beaucoup d’observateurs pour vilipender la dette publique. En revanche, quand il s’agit de réaliser l’excès de la dette privée et sa dynamique continuellement ascendante, il n’y a plus grand monde. Nos gouvernants eux-mêmes encouragent la dette privée. En Europe, les réformes n’ont plus actuellement le vent en poupe, mais il y en a une qui se poursuit c’est la réforme d’union des marchés de capitaux. Il s’agit de faciliter l’accès à la dette des entreprises de taille moyenne et intermédiaire. Il y a toujours cette confiance aveugle des autorités publiques, de nos gouvernements, dans le développement du secteur financier, dans le développement de la dette, alors que c’est précisément une source d’instabilité financière qui porte préjudice à la croissance. Parmi nos propositions, on insiste sur cette nécessité de changer le regard des autorités publiques sur la finance en reconnaissant que son hypertrophie, que l’on peut mesurer en rapportant la taille de la dette privée au PIB, en observant la taille excessive des établissements bancaires, que cette hypertrophie pèse donc sur la croissance tout en exposant nos économies à l’instabilité financière. Donc on a besoin de changer ce regard, de cette prise de conscience. On n’est plus dans un moment où il faut encourager le développement du secteur bancaire et financier. Quand on voit l’opération séduction en France pour faire venir les financiers londoniens, après le Brexit, on se dit qu’on est très loin de cette prise de conscience.
Vous parlez de dette privée mais le discours majoritaire depuis 2008 a plutôt insisté sur le problème de la dette publique…
On a tendance à oublier que la dette publique est une conséquence et pas la cause de la crise. L’excès de dettes qui cause la crise, ce sont bien les dettes privées. Ensuite, une fois que la crise est enclenchée, qu’il faut aider le secteur bancaire, cela se traduit par plus de dépenses publiques. Celles-ci augmentent aussi à causes des conséquences économiques et sociales de la crise : des entreprises font faillite, il y a plus de chômage, l’impact récessif diminue les recettes, les déficits se creusent, la dette augmente… tout ça est purement mécanique. Insister sur la dette publique c’est faire un diagnostic erroné. On s’est attaqué à la dette publique, mais pas du tout à l’excès de dette privée qui a causé la crise. Le désendettement des agents ne s’est du reste pas produit, du fait de l’impact déflationniste de la crise, qui rend le désendettement plus difficile, et des politiques monétaires accommodantes qui ont favorisé les taux bas qui facilitent les nouveaux crédits. Il faut ajouter pour terminer que l’endettement a aussi continué d’augmenter dans des pays qui n’ont pas été touchés par la crise de 2008, et qui sont aujourd’hui très exposés à la remontée des taux d’intérêt américains. Or cette remontée est inévitable, et on a donc des catalyseurs de la prochaine crise aussi bien dans les pays dit « avancés » que dans les pays émergents.
