Pierre Dardot et Michele Spano : « Les communs désignent une institution du collectif ni étatique ni privée »
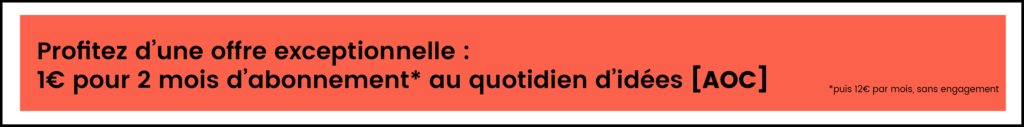
Les communs occupent depuis plusieurs années une place importante dans la pensée critique, surtout depuis la publication en 2014 du livre important de Pierre Dardot et Christian Laval Commun : Essai sur la révolution au XXIe siècle. Le commun y est pensé non pas seulement en termes de biens communs mais comme un processus politique qui permet de s’affranchir de la dichotomie entre public et privé. Pour approfondir cette réflexion, un détour par l’histoire du droit que pratique Michele Spano s’avère particulièrement intéressant. La distinction récente entre droit public et droit privé se trouve en effet bousculée par cette notion de commun, qui offre, par ailleurs, des alternatives à la délégation politique en permettant certaines modalités de démocratie plus directe. La discussion entre le philosophe et le juriste donne ici corps au concept de communs, une idée difficile à saisir tant elle remet en cause nombre de catégories bien établies. RB
Le terme « communs » a émergé ces dernières années dans le débat politique. Mais peut-être convient-il d’abord de le préciser : Pierre Dardot, qu’entendez-vous par ce terme ?
Pierre Dardot — Avec Christian Laval, nous sommes tout simplement partis du mouvement qu’on voyait émerger dans différents pays et qui posait cette question des communs, au pluriel puisque c’est ainsi que le mot est employé par les militants. Ce mouvement regroupait des choses extrêmement diverses, comme par exemple la défense des services publics contre les attaques sournoises qui se menaient de l’intérieur même de l’Etat, pour y intégrer les logiques du privé. Nous nous sommes également penchés sur les luttes autour de questions élémentaires, comme la « guerre de l’eau » de Cochabamba (Bolivie) en 2003. La multinationale américaine Bechtel essayait de faire payer aux paysans l’accès à l’eau, en leur interdisant de continuer – comme ils le faisaient traditionnellement – à récolter la pluie. Cela a donné lieu à un affrontement assez violent, mais surtout ce qui nous intéressait c’est de voir que cette lutte se référait beaucoup au droit coutumier, à la façon dont les paysans étaient habitués à recueillir l’eau de pluie dans les villages tout en proposant une construction juridique. Élaboré avec des avocats, ce travail sur le droit positif a contribué à donner une colonne vertébrale à l’affaire. Le terme de « communs » inclut aussi la question d’Internet, avec l’émergence de ce qu’on a appelé les communs de connaissances ou les communs d’informations, dont certains ont pu penser naïvement au début qu’ils allaient s’imposer, se diffuser irrésistiblement. On voit aujourd’hui, avec la fin de la neutralité du net par exemple, que c’était une illusion. Nous sommes donc partis de l’idée que les communs devaient être construits, qu’ils n’étaient pas donnés. Partant de cette idée, nous étions assez réticents face à l’utilisation d’expressions comme « communs naturels », qui circulaient beaucoup dans les milieux écologistes, comme si la nature donnait un certain nombre de choses qu’il nous fallait partager et qui ne devaient donc pas être appropriés de façon privée. Pour penser les communs, il est essentiel de considérer les pratiques sociales, la façon dont ces communs sont institués, construits.
Cela pose évidemment la question de l’État, la question du public et du privé. Comment cette question du commun se pose dans l’histoire du droit et en quoi elle permet notamment de revisiter cette division entre le droit public et le droit privé ?
Michele Spano — Il faut commencer par rappeler un fait qui peut paraître surprenant tant cette distinction semble naturelle aujourd’hui : la dichotomie entre droit public et droit privé est récente. C’est contre-intuitif car on a spontanément cette vision d’un monde divisé entre ce qui concerne nos manières de faire ou de nous organiser collectivement, et qui relève donc du public, et ce qui ne concernerait que les individus, les particuliers, et serait de l’ordre du privé. Au plan juridique, cette dichotomie est pourtant une invention récente puisqu’elle se produit au XIXe siècle. En France, elle est instituée en 1804 par le code civil de Napoléon, le souverain par excellence. C’est-à-dire que c’est l’État en personne qui dit que certaines parties de notre expérience en tant qu’individus, par exemple notre statut d’homme ou de femme et les droit afférents, les relations interpersonnelles, par exemple les règles qui régissent l’héritage, relèvent du privé. Notre intuition du politique en est restée très marquée, et on a projeté cette distinction public-privé sur la longue durée, pour penser quelque chose comme les communs qui ne relèvent ni du public ni du privé. Pour faire une contre-histoire de cette dichotomie, lorsque le thème des biens communs s’est imposé dans les mouvements sociaux, on s’est tout de suite plongé dans la longue histoire des pratiques juridiques, le droit des biens ou le droit d’usage, pour tenter d’y trouver des reliques de ce qui ne relève ni du public ni du privé. On est tombé sur des exemples médiévaux en Europe, comme le droit d’usage, la coutume qui échappe à l’État, sans être purement d’ordre privé. Sans pour autant, comme on l’entend parfois, estimer que le Moyen-Âge constituait un « âge d’or » des communs comme le montre toute une littérature critique qui a révélé que ces droits communaux prévoyaient une très forte exclusion. On imagine comment un droit communautaire d’accès à un bien peut exclure toute personne n’appartenant pas à la communauté de la jouissance de ce bien. Le Moyen-Âge n’a donc rien de ce paradis de l’usage et de l’accès que certains ont voulu voir.
Pierre Dardot — Je suis tout à fait d’accord avec la présentation de Michele, ce n’est pas un âge d’or. On a l’habitude de parler en France des communaux – aussi bien que des biens communaux – quand on évoque le Moyen-Âge, et ça concerne des choses qui peuvent être extrêmement diverses : des bois, des forêts, des cours d’eau… Les pauvres pouvaient ainsi ramasser le bois mort qui était tombé des arbres. L’enjeu est assez important même si on peine à s’imaginer aujourd’hui ce que ça représentait pour la subsistance alimentaire. En France et en Allemagne, en particulier au début du XIXe siècle vers 1820-1830, ces gens se sont heurtés à une interdiction de plus en plus sévère décidée par la Chambre des députés, leurs représentants donc. Il y a eu, notamment dans les pays rhénans, une loi sur le vol de bois qui décrétait que le ramassage des brindilles tombées des arbres était considéré comme un délit. Des sanctions ont été inscrites dans le droit pénal, des sanctions qui allaient très loin et qui visaient, par la crainte du châtiment, à dissuader les pauvres de continuer à recourir aux pratiques qui avaient été les leurs pendant des siècles. Il s’agit de se représenter ce que ça signifiait comme choc, comme rupture. En Angleterre, il y a eu évidemment le mouvement des enclosures qui commence au XVIe siècle et dure jusqu’au début du XIXe, au moment où les derniers communs sont liquidés en 1820. Il s’agissait de mettre en clôture des terres au profit des éleveurs de moutons afin de faciliter la tonte de la laine qui était vendue à très haut prix sur le marché européen. Ce qui a fait dire à l’époque que la vie d’un homme valait moins que celle d’un mouton. C’est une période, en Angleterre, où des centaines de milliers de pauvres se retrouvent sur la route, plongés dans la mendicité. Mais les gens ne se laissent pas faire, résistent physiquement et investissent – ce qui est remarquable – le terrain du droit coutumier. Il y a bien sûr des épisodes d’affrontements violents, comme en Angleterre la « guerre des forêts », décrite par E.P Thompson, suite au Black Act adopté en 1723 par le Parlement anglais et qui prévoit la peine capitale pour tout acte de braconnage de cerfs dans les forêts royales. Les gardes forestiers affrontaient alors les Blacks, appelés ainsi parce qu’ils se noircissaient le village au charbon pour continuer leur activité de collecte la nuit. C’est une lutte sociale de grande ampleur.
Si l’on revient à notre époque, vous vous êtes tous les deux intéressés à un référendum organisé en Italie en 2011 à propos de l’eau…
Michele Spano — Cette question de l’eau, avec aqua bene comune, fut vraiment le déclencheur du mouvement pour les biens communs en Italie. C’est une histoire très intéressante qui fait la synthèse de tout ce qu’on vient de dire puisqu’elle met en présence un bien « naturel » l’eau, puis le droit puisque la voie choisie a été celle d’un référendum, le public, le privé et bien sûr le droit comme outil pour essayer de dire le commun. L’enjeu, c’était de rendre au public l’accès à l’eau après les privatisations des années 90 qui avaient retiré aux villes le contrôle des services hydriques. Mais comme c’était l’État qui avait décidé de privatiser ce bien public, qui avait transformé les régies des eaux en entreprises, il ne suffisait pas de renationaliser. Il s’agissait de trouver des moyens, des arrangements, des ruses et on a opté pour le référendum pour faire valoir que l’eau était un bien indisponible alors même qu’il s’agit d’un bien naturel : qui peut décider que quelque chose est indisponible à un public ? Nous avons commencé à penser par le droit et non par les canaux traditionnels de la politique. C’est ainsi qu’à Naples fut refondée la régie des eaux, en s’appuyant sur un principe de gestion des biens communs de notre droit public qui insiste sur la participation des citoyens. Les décisions qui concernent le budget et la gestion sont désormais prises par la collectivité toute entière notamment pour empêcher qu’un nouveau conseil municipal puisse décider une nouvelle privatisation de ce bien.
Cela fait écho à l’actualité immédiate en France, aux revendications de démocratie directe : l’État n’est plus considéré comme le garant du bien commun. C’est pourtant une idée qui ne va pas de soi, surtout en France…
Pierre Dardot — Oui l’idée est très ancrée en France que seul l’État est à même de garantir le bien commun. Il y a une histoire du rôle de l’État comme défenseur face aux offensives extérieures du marché. Or, non seulement cette offensive du marché est parfois relayée à l’intérieur même de l’État mais elle lui arrive aussi d’être initiée par l’État, comme nous le montrions déjà avec Christian Laval dans La nouvelle raison du monde. Et ça se vérifie largement aujourd’hui, encore récemment avec le projet de privatisation d’Aéroport de Paris. Il faut se garder de jeter l’idée du public avec celle de l’étatique, mais plutôt œuvrer pour soustraire le public à l’étatique. Le commun donne au public une existence autonome par rapport à l’État, par rapport au pouvoir discrétionnaire qui lui permet de décider du jour au lendemain de privatiser ce qu’il considère lui appartenir. Il peut y avoir des protestations, mais d’un point de vue du droit l’État est fondé à se revendiquer de l’élection, à dire qu’il ne fait qu’appliquer un programme qui a reçu le suffrage des citoyens. Quand on parle de droit civil, personne ne fait attention au fait que dans civil il y a civest, civitas, des mots latins qui signifient citoyens, cité, ce sont des termes qu’on ne peut pas assimiler au privé. Ce qui regarde le citoyen n’est pas privé, c’est au contraire une chose qui devrait relever de l’intérêt collectif.
Michele Spano — Cette confusion entre l’histoire du droit civil et l’histoire du droit privé moderne est cruciale, même si c’est peut-être l’un des éléments les plus difficiles à saisir. Le droit privé moderne, c’est le droit que nous considérons comme le droit de l’économie, le droit qui concerne l’articulation des patrimoines, la gestion des biens, leur production, leurs échanges. Mais le droit civil parle une langue différente, qui s’adresse à un « public » qui n’est pas de l’ordre de l’État, et de l’autre côté à un « privé » qui n’est pas de l’ordre du patrimoine. Le commun est un nom qui permet de penser cette double disjonction : d’un côté un public non souverain, de l’autre un privé non patrimonial. Le commun nous concerne ni comme individu particulier, ni comme somme d’individus représentés par un super-sujet qui serait l’État par exemple. C’est précisément l’enjeu, difficile, de penser cet entre-deux, cette collectivité qui ne se sublime pas, qui ne se synthétise pas dans l’État et qui ne s’éparpille pas dans l’intérêt privé particulier, etc. Les communs désignent ce type de lien, de nouage du collectif, d’institution du collectif, qui n’est ni étatique ni privé.
Pour préciser votre pensée, il faut introduire la notion de souveraineté que vous associez habituellement au droit public, ce qui nous ramène à la politique.
Michele Spano — La souveraineté est fondamentalement liée à l’État, seul à pouvoir dire le droit sur un territoire donné. Cette exclusivité sur la production normative est inséparable de la souveraineté. Ce qui nous permet de penser une homologie presque parfaite entre la souveraineté comme caractère de l’Etat et la propriété comme caractère typique de l’individu privé, du particulier. En fait les deux termes, souveraineté et propriété, veulent dire la même chose : ce caractère d’autonomie, de chez soi, d’une obligation qui ne permet pas à un collectif d’entrer dans le cadre. L’idée même de souveraineté prévoit à travers les techniques juridiques la synthèse du multiple dans la forme de l’unité : de l’unité de la représentation, de la loi, de la décision, etc. De l’autre côté, toutes les techniques du droit privé moderne comme le contrat, la responsabilité civile, la propriété excluent la multiplicité, le collectif en tant que tel. La souveraineté pourrait donc par glissement être considéré comme le nom de l’ennemi des biens communs par excellence.
Le commun tracerait donc une troisième voie entre le public et le privé, et entre leur traduction politique que sont communisme et néolibéralisme ? Pourtant Pierre Dardot, dans communisme, il y a commun non ?
Pierre Dardot — Oui il y a la même racine qui signifie co-obligation. Sauf que ce qui s’est appelé communisme dans l’histoire, fin XIXe et XXe siècle, désigne une doctrine qui prétendait légitimer l’appartenance de toute chose, et en particulier les moyens de production de la terre et de l’activité de travail elle-même, à l’État. C’est donc la propriété d’État elle-même qui se retrouvait instituée, consacrée. C’est très important à faire remarquer, parce qu’il y a avait des communs en Russie, bien avant la révolution de 1917. Or, ça a été capturé puis détruit par l’État soviétique, à certains égards les bolchéviques eux-mêmes ont été des représentants de la doctrine de la souveraineté de l’État. Ils ont poussé la souveraineté étatique très loin en liquidant les soviets, c’est-à-dire les conseils ouvriers et paysans très présents dès 1905. Si on regarde ce qui s’est appelé la révolution d’octobre, de 1917 à 1921, on voit à l’œuvre la liquidation des soviets qui constituaient l’armature des communs au sens politique. Il est important de comprendre, encore une fois, que nous parlons encore ici de la souveraineté de l’État, pas de la souveraineté en général car cela ne veut rien dire. C’est un enjeu considérable aujourd’hui, car tout le monde a ce terme de souveraineté à la bouche, tout le monde ne parle que de ça : Emmanuel Macron parle de la souveraineté de l’Europe, qu’il oppose à la souveraineté des nations défendue par Marine Le Pen. Mais la question est très mal posée. Si c’est de la même souveraineté qu’il s’agit, la déplacer aux frontières de l’Europe ne change rien. La souveraineté, c’est la consécration de l’exclusivité. Michele disait très justement qu’il y a quelque chose de commun entre souveraineté et propriété telle qu’elle a été consacrée dans le droit occidental, et c’est précisément que la souveraineté comme la propriété sont exclusives. Ce qui signifie qu’on prive les gens qui n’en font pas partie, on considère que seuls les gens à l’intérieur d’un périmètre artificiellement constitué peuvent bénéficier d’un certain nombre de droits. C’est fondamental, la logique reste la même à l’échelle de l’Europe ou d’une nation, et à mon avis c’est une logique dangereuse.
Où placer alors la démocratie ? Comment chercher une gestion démocratique des communs ?
Michele Spano — Ce que disait à l’instant Pierre Dardot sur la citoyenneté et la souveraineté, en adoptant un biais critique, est très important. Amener de la démocratie dans le cadre du commun c’est sortir de cette idée de la citoyenneté liée à la souveraineté. Or, l’extension de la souveraineté, qui est un discours purement et simplement réactionnaire, est détournée au nom d’une prétendue redémocratisation de notre société. Alors, que seraient des institutions du commun, des nouvelles institutions politiques, comment organiser, forger, instituer un collectif en dehors de ces principes de l’exclusivité et de l’unité, de la propriété et de la souveraineté ? C’est un pari politique, mais c’est un pari nécessaire au vu des symptômes de la crise du système politique moderne, dont nous faisons l’expérience tous les jours, de la privatisation des aéroports aux Gilets jaunes. Il ne s’agit pas ici d’une critique, mais d’une analyse de ce qui est en train de se passer, et qui remet très fortement en cause l’idée de représentation. Il faut sans doute le repenser la structuration du collectif politique et pour ce faire il y a déjà des pistes, juridiques qui existent.
Pierre Dardot — La question qui se pose c’est celle de la transformation de ce qui existe. C’est très intéressant d’ailleurs parce que c’est une transformation assez radicale qui signifie qu’on libère toutes les potentialités qui relèvent du commun dans les institutions de la démocratie sociale ou dans les institutions que sont les services publics. Mais cela signifie aussi une refonte complète des principes de la gestion de ces services ou de ces institutions : État providence, sécurité sociale. C’est pour cela qu’il est important de bien distinguer le public et l’étatique. Il y a des choses qui relèvent potentiellement d’un public qui ne demanderait qu’à être libéré de l’étatique. Il faut alors accepter que dans la gestion des services publics par exemple s’opère une démocratisation assez radicale. Que ce ne soit plus le monopole de l’administration étatique qui décide de façon discrétionnaire, alors que l’ensemble des citoyens est concerné au premier chef. Les usagers ne doivent pas être ravalés au rang de clients, mais avoir leur mot à dire dans les décisions collectives concernant l’orientation des chemins de fer, de l’éducation. Cela ne suppose pas de consulter simplement les citoyens, qui ne sont pas des fonctionnaires chargés de gérer ces services, mais qu’on puisse avoir un mécanisme de co-participation. Que vont devenir les services publics ? comment ils sont gérés ? comment on les finance ? qu’est-ce qu’« on » ? Ce sont des choses tout à fait fondamentales. Il y a des pays comme la Suisse par exemple – même si la Suisse ne constitue pas, par ailleurs, pour moi un modèle – où l’on consulte les citoyens par référendum, sur un certain nombre de choix d’orientation concernant par exemple les chemins de fer. On ne considère pas que l’État puisse disposer des services publics de manière discrétionnaire et par exemple les vendre pour renflouer ses caisses. Il s’agit là de problèmes de démocratie au sens profond. J’en ai d’ailleurs un peu assez qu’on parle de crise de la démocratie représentative, car en réalité on fait face à un rejet profond. Crise c’est le langage des politologues, qui se concentrent sur le fonctionnement. Non, il y a un rejet, de plus en plus de gens considèrent qu’il n’est pas normal qu’une petite oligarchie, un petit nombre de dirigeants, s’arrogent le droit d’agir et de parler pour les autres. Ceux qui sont représentés sont relégués dans une position de passivité. Ce qu’on appelle démocratie représentative n’est pas pour moi une démocratie, je serais plutôt d’accord avec les gens du 15-M en Espagne qui appelaient en 2011 à une « démocratie réelle ». Ça veut dire une démocratie dans laquelle le grand nombre intervient concernant la délibération et donc la décision, la démocratie au sens de la participation du plus grand nombre. On peut s’entendre sur les formes, on peut considérer que le référendum n’est pas satisfaisant, ce n’est pas parce qu’on vote tous les jours qu’on est en démocratie. Mais il faut revenir aux fondements de la représentation politique qui suppose qu’il y a des gens qui agissent à la place des autres.
Est-ce qu’il faut comprendre que pour vous une démocratie des communs exclue la représentation ?
Michele Spano — Les succès qu’ont connus les communs reposent précisément sur ce rejet de la représentation, ça a été le drapeau sous lequel se sont ralliées toute une série de luttes, de mouvements qui se situaient à des échelles très différentes. Au niveau de questions universelles comme les frontières de la démocratie ou de l’État-nation ; mais aussi des questions très locales, très délimitées et qui concernent un groupe qui n’est ni l’individu privé, ni un corps étatique. Les communs peuvent concerner un groupe limité, et donc à cette échelle évidemment la représentation n’est plus le dispositif idéal. On le constate dans l’histoire des biens communs. D’un point de vue théorique on pourrait insister sur le fait que les deux grandes tendances, l’une incarnée par Pierre Dardot et Christian Laval, l’autre par Toni Negri, insistent de manière différente sur l’idiosyncrasie entre communs et représentation. Chez Dardot et Laval, le commun est considéré comme un principe politique qui relève de l’autogestion, la capacité à décider ensemble, de manière réflexive. Chez Negri, « commun » décrit un mode de production et interroge la façon dont est produite la richesse : grâce à la coopération et pas en dépit de la coopération, le problème étant que cette richesse est ensuite confisquée par les entreprises. Mais les deux théories, complexes et différentes, sont intrinsèquement opposées au principe de la représentation qui prévoit une distance, une transcendance et donc toute une série de synthèses pour aller de la multiplicité à l’unité, d’un groupe innombrable à un individu qui prend des décisions.
Pierre Dardot — Je parlerais plus volontiers d’autogouvernement que d’autogestion, parce que c’est une notion qui a une histoire particulière en France liée aux reprises d’entreprises dans les années 70, aux expériences comme les usines Lip. Ça reste donc à l’échelle microéconomique, quand il me semble nécessaire d’élargir, de se placer au niveau du principe d’autogouvernement et donc de l’idée qu’il ne peut y avoir de représentation consacrée ou constituée. On est amené éventuellement à déléguer un certain nombre de tâches, car tout le monde ne peut pas tout faire, mais cela se fait sous le contrôle de l’ensemble. C’est la différence que montre bien Castoriadis entre un délégué et un représentant. Un représentant a la main sur les conditions de son élection, il peut combiner pour se maintenir quel que soit son bilan. L’autogouvernement empêche cela, car si un délégué ne fait pas, ou fait mal, ce qu’on lui a demandé, il suffit de le remplacer. C’est le contrôle collectif qui se joue là, et ça nous ramène encore une fois à la question de la souveraineté. Derrière ce terme, on confond souvent deux choses : la souveraineté de l’État dont on a parlé, et les pratiques souveraines de contrôle démocratiques des gouvernants. Je ne suis pas contre les représentants en tant que tel, on peut dire que certains représentants sont utiles au sens où ils font voir ce qu’on ne voit pas d’habitude. Mais ça ne doit pas être des représentants au sens politique du terme, c’est-à-dire qui agissent à la place des autres, sinon encore une fois c’est la relégation du citoyen au rang de pure passivité alors qu’il doit être un acteur.
