Thyago Nogueira : « Claudia Andujar mène plus qu’un projet artistique, un combat éthique »
Le travail de Claudia Andujar, tant artistique que politique, frappe non seulement par sa force et son audace, mais aussi par la rigueur morale et l’engagement éthique qui lui ont servi de boussole durant toute son existence. Cette femme intrépide, surnommée la napëyoma, « la femme blanche », a en effet dédié la seconde partie de son existence à la défense et la protection d’un peuple indigène d’Amazonie, les Yanomami, contre la conquête de leur territoire menée au nom d’un prétendu « développement » pour s’emparer notamment de ses richesses minières, à partir des années 70.
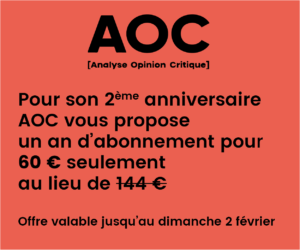
Née dans la paisible ville de Neuchâtel en 1931, Claudia Andujar passe son enfance en Transylvanie, et rien ne l’aurait probablement mené au cœur de la forêt amazonienne sans la Seconde guerre mondiale : ses origines juives la poussent en effet à quitter l’Europe, alors que son père et la plupart des membres de sa famille sont exterminés dans les camps. Ce traumatisme initial, allié à une forme de « complexe du survivant », n’est sans doute pas sans lien avec son désir de lutter aux côtés d’un autre peuple dont on organisait la disparition. Arrivée au Brésil à vingt-cinq ans, après une adolescence solitaire à New York, elle se prend de passion bien des années plus tard pour les Yanomami, passion qui deviendra le combat d’une vie.
Alors que les équipes s’activent pour le montage, je circule dans la forêt de ses images, suspendues sous les verrières modernes de la Fondation Cartier, pour retrouver Thyago Nogueira, commissaire de l’exposition. Les photographies, puissantes, oniriques, immersives d’une part, et cliniques, utilitaires, documentaires d’autre part, se chargent de gravité dans le contexte brésilien actuel. Contre la dictature militaire d’hier et les provocations de Jair Bolsonaro d’aujourd’hui, contre l’uniformisation des façons d’habiter et d’être au monde et l’appétit insatiable des capitalistes du « Peuple de la marchandise », la lutte Yanomami se poursuit. Y.S.
Pourriez-vous tout d’abord revenir sur la genèse de cette exposition et la maturation du projet ?
Je connaissais le travail de Claudia Andujar depuis longtemps, j’avais déjà pu voir certaines de ses expositions au Brésil, où je vis. Je l’ai rencontrée pour la première fois en 2012, car je suis un éditeur de magazines de photographie, je travaille également au département de photographie contemporaine du musée Instituto Moreira Salles à São Paulo, et je souhaitais publier ses photographies. Je voulais mieux comprendre ses œuvres, alors nous avons entamé un dialogue, et j’ai pu présenter son travail dans le magazine. Mais je ne voulais pas en rester là, je voulais me plonger dans son œuvre sur les Yanomami. À cette époque, elle se dédiait au pavillon permanent qu’elle consacrait dans le parc de l’Institut Inhotim, le musée d’Art contemporain de l’État du Minas Gerais, aux Yanomami. Elle ne pouvait donc pas se charger d’autre chose, disait-elle, et cette situation m’a un peu frustré, je dois l’avouer… Après réflexion, j’ai songé qu’il serait peut-être intéressant de fouiller dans un moment complètement oblitéré de sa carrière, avant les Yanomami. Après tout, elle avait 40 ans quand elle a commencé ses séjours chez eux ! Au départ, elle a refusé, jugeant tout cela peu important, mais j’ai insisté, affirmant que cela – et j’en suis convaincu – allait apporter un éclairage sur toutes ces œuvres suivantes : nous aider à comprendre comment fonctionne son laboratoire, sa manière de travailler… Et nous avons alors réalisé une grande exposition au Brésil avec ces travaux-là, ce qui nous a donné l’occasion de nous voir régulièrement, lors de mes visites pour étudier les archives, et nous sommes devenus amis à mesure que je plongeais dans sa vie. Elle était contente de cette première exposition ensemble, et plus disponible du fait de l’ouverture du pavillon, alors je lui ai proposé de nouveau mon projet initial. Un autre élément majeur fut la publication du livre de l’anthropologue Bruce Albert et du chaman Davi Kopenawa, La Chute du ciel. Paroles d’un chaman Yanomami, qui apportait des informations essentielles pour comprendre cette culture, à travers leurs discours. Mises en regard avec ce que les Yonamami disaient eux-mêmes, les photographies prenaient une nouvelle dimension.
Une autre raison pour moi de faire cette exposition, c’était que Claudia Andujar commençait à être oubliée dans les années 90, parce que le combat pour la protection des Yanomami n’était alors plus aussi urgent qu’il avait pu l’être. Elle a bien commencé à exposer, mais de façon mineure. En 2000, elle a eu sa première galerie – à plus de 70 ans ! –, et elle s’est donc mise à vendre, à revenir dans le marché de l’art… Mais je trouvais qu’on présentait son travail de façon très romantique et idéalisée, très exotique aussi, ce qui ne rendait pas justice à son caractère militant. Cette dernière dimension me paraissait encore floue, et je n’arrivais toujours pas à comprendre ce qui se passait sur ces images. Qui étaient ces gens ? Que faisaient-ils ? J’avais l’intuition qu’il y avait encore beaucoup de choses à dire à partir – et sur – ces photographies. Disons que le projet s’est clarifié avec cet objectif : essayer de relier les différents fils de son travail, les expérimentations esthétiques avec l’expérience culturelle et spirituelle. Je voulais que l’on regarde ces images comme des photographies de rue : de « vrais » gens, faisant des choses très précises, ayant leur propre routine, leur vie ordinaire, en les replaçant dans un contexte, et non pas les réduire à des matrices à fantasmes. À cela s’ajoute aussi la volonté de montrer aussi son engagement politique, afin d’écrire une histoire plus cohérente de sa vie.
Les photos témoignent de cette multiplicité des facettes de son existence. On perçoit une évolution dans sa pratique photographique à mesure qu’elle approfondit ses liens avec les Yanomami. Peut-on dire qu’elle passe d’un regard ethnographique à une véritable interprétation de leur culture, et qu’en cherchant à la « traduire » dans le médium photographique, elle trouve elle-même son propre langage artistique ?
Claudia Andujar est toujours allée vers plus de complexité, de réflexion, de critique. Dans les années 60, elle avait déjà commencé sa carrière comme photographe professionnelle. Elle travaillait pour un magazine illustré important au Brésil, l’équivalent de l’américain Look, intitulé Realidade, qui donnait l’opportunité aux photographes d’expérimenter et de faire des sortes d’essais, plus narratifs que de la simple illustration. Dès cette époque, elle montrait un intérêt pour les groupes discriminés, les marginaux, les exclus. Même dans le photojournalisme, elle trouvait déjà une certaine liberté. Mais elle était devenue de plus en plus frustrée par la durée très courte de ces reportages, qui duraient un à deux mois. Elle souhaitait faire un projet long, et ainsi vraiment réaliser une étude plus approfondie de son sujet, en immersion. Elle a donc postulé pour une bourse de la Fondation Guggenheim, qu’elle a obtenue, grâce au projet de photographier les Xikrin, qu’elle avait déjà approchés. Mais elle a alors entendu parler d’une communauté encore plus inaccessible et isolée, les Yanomami. Grâce à la bourse, elle a pu quitter le magazine et multiplier des séjours de plus en plus longs là-bas. Au départ, il est vrai que les images témoignent d’une certaine distance : elles sont très directes, en noir et blanc, documentaires. Il faut se dire qu’elle débarquait, elle prenait ses marques : on perçoit qu’elle aborde avec curiosité, et un peu de timidité, ce qui se présente à ses yeux. Mais elle ressent immédiatement un profond intérêt, et très rapidement elle a essayé des expérimentations, malgré les conditions difficiles dans l’environnement humide et sombre de la forêt.
Ces expérimentations rendent plus difficile l’appréhension des photographies de Claudia Andujar, que par exemple celles de Sebastião Salgado, qui a récemment fait une série de photos sur les Yanomami, publiée dans un journal brésilien. À l’opposé des images claires, nettes de ce dernier, qui reprennent parfois des codes de la photographie ethnographique du XIXe siècle, avec des poses très formelles et des fonds unis, Claudia Andujar nous « embarque » avec elle dans cette communauté, dans une forme de « surréalité », ou d’infra-réalité.
Salgado maintient toujours une forme de distance ; Claudia Andujar, elle, est allée dans une autre direction : elle a une relation organique, très sensible, avec les Yanomami. Elle a tout incorporé, et a pu transmettre cela dans ces photos, grâce à l’intimité et la confiance qui s’étaient installées entre elle et les Yanomami au cours des années passées à leur contact. Plus elle comprend leurs façons d’être, plus la complexité et la singularité de son travail augmentent. En utilisant différents moyens, comme la vaseline, les grands angles pour faire des portraits, les flashs, les filtres, ou en secouant l’appareil, elle cherche de nouvelles manières de photographier afin de matérialiser cette connaissance abstraite. Elle est en quête d’autres représentations, pour rendre visible l’invisible, et elle invente une forme de photographie spirituelle, avec des distorsions visuelles. Elle essaie vraiment de nous faire prendre conscience de choses que l’on ne peut pas voir. Pour moi, cette réflexion mature en particulier lors du reahu, les cérémonies mortuaires. À cette occasion, elle a apporté des éclairages spéciaux, et mélangé un temps de pose long avec des flashs. Par ce dispositif, elle a brillamment réussi à rendre compte de ces célébrations, et à nous donner une idée des rituels chamaniques. Lorsque l’on voit ces images, on imagine la musique, les rythmes, les danses, l’atmosphère où l’on perd tout repère… La scénographie de l’exposition tente de rendre compte de cette démarche, en proposant une plongée ludique, propice à la rêverie, dans cette culture.
La photographe assume alors l’artificialité pour mieux rendre compte de la « vérité » de son expérience immersive au sein de cette communauté, de la transmettre. Mais se pose tout de même la question du point de vue des Yanomami eux-mêmes : comment percevaient-ils tout cela ?
Au début, ils ne comprenaient pas en quoi consistait la photographie… Puisque c’était alors de la photographie argentique, il n’y avait aucun résultat immédiat à montrer. Je ne sais pas jusqu’à quel point ils ont eu une conversation à ce sujet, mais quand les photos ont commencé à être montrées à un public, je crois qu’au départ ils ne s’y sont pas vraiment intéressés. Ils voyaient bien les appareils, le matériel circuler, mais ne saisissaient pas ce que cela signifiait. Pourtant, ils communiquaient beaucoup : à cette période, Claudia était aidée par un missionnaire italien, Carlo Zacquini, qui parlait leur langue. Il vivait dans cette communauté depuis les années 60, et s’occupait d’eux, leur apportant notamment des médicaments. Mais jusqu’à la fin des années 70, la question de leur accord ou non pour présenter les photos ne se posait pas vraiment : Claudia Andujar n’était pas préoccupée par l’argent grâce aux bourses qu’elle avait reçues, elle n’avait pas besoin de vendre ses images. Elle était concentrée sur l’idée de créer, d’inventer, de trouver son chemin artistique, à travers une construction collaborative – plus ou moins consciente – avec eux.
Mais à cette première période, où dans la confrontation à l’autre elle part en quête d’elle-même, où elle écrit que « ce monde l’aide à comprendre et à accepter l’autre monde dans lequel elle a grandi », va succéder une période où elle va mettre de côté sa vocation artistique et ses questionnements existentiels pour une lutte qui la dépasse, un projet plus grand.
Le tournant, c’est son expulsion et son interdiction de revenir sur le territoire indigène en 1977, sur ordre de la dictature militaire qui a pris le pouvoir en 1964. Elle est toujours considérée comme étrangère, et elle décide à ce moment-là de se faire naturaliser, pour éviter les problèmes. Mais elle n’arrive toujours pas à avoir les autorisations nécessaires, et c’est alors qu’elle décide d’éditer les images qu’elle a déjà produites. En un an, elle publie ainsi trois livres coup sur coup en 1978 : Yanomami : Frente ao eterno, dédié à son père mort à Dachau, qui réunit des portraits avec de très beaux chiaroscuro, déjà accompagnés de textes explicatifs sur la culture de la communauté ; Amazônia, qui est comme un déroulé cinématique d’un film, qui part de la création du monde jusqu’à son enterrement. Elle a pour ce livre photographié ses images de nouveau pour en accentuer l’aspect spirituel et poétique, ce qu’elle fera à plusieurs reprises. Enfin, le troisième livre est un livre de dessins, Mitopoemas Yãnomam, faits par des artistes Yanomami. Pour souligner cette rupture, j’ai pris le parti assez didactique de diviser l’exposition en deux parties.
Dès cette période, Claudia Andujar consacre toute son énergie à la défense des Yanomami menacés : le gouvernement brésilien décide en effet d’un développement forcé sur cette soi-disant « terre vierge », pour extraire des minerais et favoriser l’agriculture intensive. C’est le début de la construction de la route transamazonienne, dans le sud du territoire yanomami. Évidemment, tout cela provoque un immense désordre, détruisant non seulement un environnement mais des structures sociales, apportant les fléaux de l’Occident : des armes, l’alcool, le sucre et des maladies comme la rougeole qui déciment les populations… Claudia Andujar, après une marche de cinq jours, était ainsi tombée au cœur de la forêt sur un village où s’accumulaient les cadavres. Elle créé alors, en 1978, une ONG, la Commission pour la création du parc Yanomami (CCPY) avec le missionnaire Carlo Zacquini et l’anthropologue Bruce Albert, afin de démarquer un territoire à protéger. Sa priorité est alors de trouver de l’argent, des soutiens, de sensibiliser, de rendre visible autrement ce peuple invisible… La figure juridique du Parc indigène, issue du Statut de l’Indien de 1973, apparaît comme le seul moyen de protéger le peuple Yanomami et l’intégrité de son territoire. Grâce aux fonds récoltés, elle découvre toute l’étendue des terres yanomami, la complexité de leur organisation sociale, des différentes communautés qu’elles abritent, certaines déjà plus « occidentalisées » que d’autres, ce dont les vêtements témoignent sur les photos. Elle n’était en effet jusque-là restée que dans les environs de la base, à Catrimani. La photographie est utilisée, mais uniquement comme instrument pour la lutte, elle ne se justifie que par son rôle politique : Claudia Andujar adopte de nouveau l’esthétique du photojournalisme, pour les pamphlets, les brochures, les manifestes qu’elle rédige, ou bien les carnets médicaux. Elle accompagne deux docteurs en tant qu’assistante, et réalise le trombinoscope pour tenir à jour les vaccins.
Durant toute cette période, Claudia Andujar a cependant peu photographié directement les morts, ni même la lutte ou les conséquences de la « conquête » de l’Amazonie par les intérêts économiques. Les images produites avant cet engagement politique peuvent d’ailleurs être relues comme faisant partie d’une stratégie jouant plutôt sur l’empathie, pour dénoncer en creux. En laissant la destruction et la violence hors-champ, les photos semblent dire : regardez, approchez cette façon de vivre si différente de la nôtre, mais dont on peut reconnaître la beauté, nous Occidentaux qui subissons le contrecoup d’une rationalité et du néolibéralisme féroces. Et d’ajouter : c’est cette beauté-là qu’il faut préserver, c’est celle-ci qui risque de disparaître.
Un tel sentiment n’a probablement pu être produit que grâce à la proximité de la photographe avec les personnes photographiées. Claudia Andujar a eu conscience de cette lecture possible de ces images dans les années 90, dans une œuvre qui allie une recherche artistique à un combat politique, tout en brassant et en résumant tout son travail. À cette époque, en 1989, le gouvernement démocratique nouvellement élu souhaitait en effet voter des décrets pour transformer la zone démarquée en 19 îlots, séparés les uns des autres, et les terres entre ceux-ci étaient donc disponibles pour l’exploitation. Or, c’était clairement un moyen d’asphyxier les peuples indigènes, car ils ont un fonctionnement semi-nomade et doivent se déplacer pour permettre à l’écosystème de se renouveler. C’était leur planter un couteau dans le dos, d’autant plus que les différentes communautés n’auraient plus eu les moyens de communiquer entre elles. Les ONG se sont alors rassemblées pour protester, et ont obtenu gain de cause. L’une de ses protestations a pris la forme d’une exposition, à laquelle Claudia a participé : elle a repris toutes ses archives pour fabriquer une vidéo de 25 minutes, qui clôture l’exposition, intitulée Genocide of Yanomami : Death of Brazil. C’est une sorte de manifeste audiovisuel qui montre le bouleversement du monde amérindien, dévasté par la prédation de la civilisation occidentale. Elle a photographié de nouveau ses images, avec des filtres et des éclairages différents, et sur fond de chants traditionnels yanomami et de musiques expérimentales japonaises et espagnoles, elle déploie le récit de ses amis, en partant de leur mode de vie originel, puis de l’arrivée progressive de la civilisation occidentale, et le déclin, les maladies, la mort qui suivent… Son travail agit alors politiquement comme un tout, et non plus seulement une photo, ce qui donne le ton à ce qu’elle fait désormais : utiliser son œuvre comme un moyen de prise de conscience et de combat contre l’oppression, en liant la production esthétique et la puissance transgressive et politique des images.
Quel autre éclairage cette redécouverte, cette réutilisation constante de ses images tout au long de sa carrière, dans des contextes différents, lui a-t-elle donné ?
L’une de ses séries les plus célèbres, celle des photos d’identité, avec les indigènes qui portent autour du cou un numéro, est un bon exemple. Ce n’est que vingt ans après les avoir prises, lorsqu’elle regarde ses archives, qu’elle prit conscience de la ressemblance de ces images avec celles des Juifs marqués aussi par des chiffres comme du bétail, ce qui ne pouvait évidemment que lui rappeler de mauvais souvenirs, vu son histoire personnelle. Cela donna l’ouvrage Marcados, publié en 2009. La tête baissée, plongée dans la lutte, elle n’avait considéré tout cela que dans l’objectif de les protéger : elle les marquait pour vivre, dans l’idée de les sauver de sa propre civilisation. Je me souviens aussi d’un rouleau de films, où elle ne s’était pas rendue compte que le soleil avait tourné : on voit au départ parfaitement les visages, mais au fur et à mesure des clichés, l’image s’assombrit, et tout disparaît dans le noir. Lorsque l’on a découvert ce film, elle s’est exclamée : « Oh, ils sont en train de mourir… ». Voilà ce que montre l’image : à mesure qu’on s’en approche, on tue l’autre…
Cela reprend un problème classique de l’anthropologie : en m’intéressant, en rencontrant l’autre, je suis déjà en train de le changer. À notre époque où l’on se pose à raison les manières d’aborder d’autres cultures sans tomber ni dans l’appropriation culturelle, ni l’exoticisation, en mettant en évidence notamment les liens de domination qui sous-tendent ce rapport, mais où l’on risque aussi de tomber dans une forme de réductionnisme identitaire, quelle voie Claudia Andujar propose-t-elle ?
Même si à l’époque où elle exerçait, les problématiques étaient différentes, je dirais que sa démarche se caractérisait par un processus constant d’apprentissage et de réflexion, notamment sur sa capacité à représenter l’autre, et sur les pouvoirs de la photographie pour décrire une société et une cosmogonie aussi complexe et différente de la nôtre, qui englobe les êtres vivants et les esprits de la forêt. Après l’envoi de ses premiers clichés, elle écrit à la Fondation Guggenheim : « Dans quelle mesure avez-vous la sensation de mieux connaître les Yanomami à travers mon appareil ? ». Et c’est parce qu’elle-même doute qu’elle s’est mise en route, avec sa coccinelle Volkswagen noire chargée de matériel, de médicaments, mais aussi de feutres et de feuilles, pour commencer alors un autre projet où elle demandait aux indigènes volontaires de dessiner et de se représenter eux-mêmes. Ce qui est frappant, c’est que l’on remarque des similarités formelles entre les dessins et certaines de ses photos les plus « spirituelles ».
Plus généralement, dans l’exposition, je me suis attaché à montrer la complexité de cette situation, l’ambiguïté de cette relation d’humain à humain, du travail de Claudia Andujar. Je voulais montrer son évolution, et les différents éclairages qu’on peut en faire : sa propre compréhension de son travail, notre réception de son œuvre, et enfin celle des Yanomami. C’est très dynamique ! Pour moi, si je résume, c’est l’histoire d’une femme qui commence par être photographe, et qui est si fascinée par cette culture qu’elle crée quelque chose différent du photojournalisme ou du documentaire traditionnel, pour renouveler le langage photographique, et qui, voyant que cette même culture est menacée d’extermination, décide de mettre ses préoccupations artistiques de côté pour se consacrer entièrement à sa défense. Plus qu’un projet artistique, c’était un engagement éthique profond.
Je songe à cette phrase que Davi Kopenawa dit à son propos : « Elle n’est pas Yanomami, mais c’est une véritable amie. » La vision de la photographie des Yanomami a-t-elle changé avec le temps, avec la construction de cette amitié ? Comment Claudia Andujar les a-t-elle associés à la lutte pour leur survie, pour ne pas parler « à leur place » ?
Au départ, comme je l’ai dit, ils étaient assez indifférents à la photographie, et ensuite quand ils ont mieux saisi en quoi cela consistait, ils l’ont peu appréciée. Leur tradition, contrairement aux Occidentaux, est de détruire toute trace de la personne décédée dans le monde des vivants, afin de souligner la séparation d’avec le monde des morts, et d’éviter au spectre de revenir… La photo posait alors un problème. Mais ils ont pris conscience que les images, ou du moins celles de Claudia Andujar, puisqu’elles étaient nourries d’une conviction politique en leur faveur, pouvaient aussi être utiles pour eux et pour leur combat, afin de montrer leur mode de vie, leur façon d’être, et pourquoi ils devaient être protégés. Claudia Acunjar a aussi compris que les Blancs, elle et Bruce Albert, ne pouvaient pas se battre pour les Yanomami sans eux : Davi Kopenawa, le chaman qui est désormais le plus important porte-parole de la communauté, les a alors rejoints et a ainsi donné une plus grande légitimité à leur combat. C’est lui qui a notamment aidé à l’acceptation de la photographie et à sa diffusion.
D’ailleurs, lors de l’exposition au Brésil, il a rappelé que cela n’était pas si facile, que c’était un rapport complexe, qu’il fallait être sûr que le travail de Claudia Andujar soit toujours utilisé comme un instrument politique et jamais décoratif ou seulement esthétique. Les Yanomami ne doivent être visibles que sur des images qui concourent à leur défense, et non pas pour notre plaisir ou pour flatter notre désir d’exotisme. C’est aussi pour cela que dans l’exposition, beaucoup de textes, très denses, accompagnent les images, afin de documenter ce qu’il y a à préserver, d’expliquer ce qui est présenté. Enfin, j’ajouterais que Claudia, au cours des années, a changé de rêves, de préoccupations, de désirs, mais a toujours été fidèle à son engagement éthique. Ce fut vraiment la boussole qui la guidait… Et en 1992, ce groupe de gens a réussi à faire reconnaître légalement un territoire grand comme deux fois la Suisse… Je ne sais pas s’il y a un autre parallèle en photographie, mais c’est tout de même louable !
Mais n’a-t-on pas l’impression d’avoir affaire à une désespérante répétition de l’histoire, alors que le gouvernement de Jair Bolsonaro fait écho à la dictature militaire, et qu’il répète à l’envi que l’Amazonie est un territoire à conquérir – la déforestation, en juillet 2019, était 4 fois plus intense qu’en juillet 2018 – et qu’il multiplie les menaces et les insultes contre les peuples indigènes ?
Je me souviens d’un appel de Claudia, qui me disait « Thyago, aide-moi, cela va se répéter, je n’y crois pas… ». C’est terrible. Quand nous avons travaillé sur l’exposition, depuis 2015, je pensais raconter l’histoire de Claudia, la faire connaître hors du Brésil, rappeler son militantisme, et aussi la replacer dans l’histoire de l’art et de la photographie. On ne pouvait pas imaginer, même dans nos pires cauchemars, que Bolsonaro serait élu. Quand nous avons ouvert l’exposition au Brésil, il commençait à monter dans les sondages… Je voulais faire une exposition hommage, et c’est devenu un travail urgent, cruellement nécessaire, pour rassembler les gens et comprendre pourquoi on devait protéger les Yanomami, créer des alliances. J’ai donc ajouté une vidéo, présentée à la Fondation Cartier, où on entend celui qui allait devenir président du Brésil prononcer des paroles très dures, très provocantes envers les peuples indigènes, disant que ce territoire est bien trop grand pour eux, se moquant d’eux. Je sens que la société brésilienne est encore généralement très ignorante au sujet des indigènes. Ce sont les invisibles que personnes ne voient, et donc très faibles. Et c’est très dur de lutter contre une puissance qui entend réécrire une histoire déjà biaisée, et proclame que la dictature militaire était un gouvernement révolutionnaire pour contester les communistes… Difficile aussi, pour l’opposition, de combattre le pouvoir institutionnel, qui maîtrise les médias et a été élu pour faire des réformes soutenues par les magnats capitalistes, prêts à débourser l’argent nécessaire pour favoriser leurs intérêts, et qui ne se préoccupent pas du tout de la multiplicité des cultures et des paysages du Brésil.
Mais durant les années 90, la pression internationale a été très importante pour réussir cette protection pour la démarcation, grâce à des sanctions économiques de la part de la Banque internationale, un plaidoyer au Congrès américain, etc. Cette prise de conscience à l’échelle mondiale a beaucoup aidé pour la sauvegarde des Yanomami, et j’espère que cette exposition, qui voyagera en Italie et en Espagne, permettra aussi de donner une visibilité et une chambre d’écho à leur lutte. Car la police, qui devait renforcer la protection et la démarcation, est complètement soumise au gouvernement, et les intrusions nocives sur le territoire se multiplient, notamment pour l’extraction minière, ce qui provoque la pollution des rivières et des violences… Des chefs indigènes ont été assassinés, Davi Kopenawa lui-même a été menacé de mort. C’est partout dans le pays qu’ils sont en danger. La différence, cependant, est que maintenant, contrairement aux années 90, les indigènes ont des meneurs et défenseurs sur la scène politique pour les représenter. Beaucoup s’élèvent, s’organisent, réfléchissent à leurs propres moyens de défense : nous avons une femme indigène députée au Congrès, par exemple, Joênia Wapichana. C’est la seule solution : nous pouvons les soutenir, mais ils doivent se battre par eux-mêmes.
Exposition La Lutte Yanomami, de Claudia Andujar, du au
