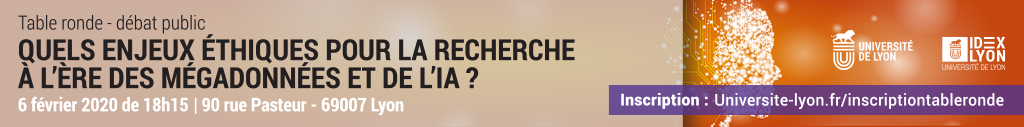Michael Sfard : « La société israélienne souffre d’un syndrome de dédoublement de la personnalité »
C’est un livre important et qui tombe à pic. Le mur et la porte de l’avocat israélien Michael Sfard, qui paraît le 6 février prochain (éditions Zulma), propose pour la première fois le récit des batailles judiciaires menées depuis cinquante ans en Israël pour la défense des droits de l’homme. L’auteur – petit-fils du sociologue Zygmunt Bauman – y raconte son travail d’avocat, depuis près de vingt ans qu’il a installé son cabinet à Tel Aviv et défend des personnes vivant sous occupation et dont les droits civiques sont suspendus. Il y mène aussi une réflexion sur son action, et s’interroge sur la possibilité réelle d’améliorer la société israélienne en passant par les tribunaux. Pour y répondre, il chronique les combats menés par les avocats et les organisations humanitaires devant la Cour suprême d’Israël autour de huit thématiques fondamentales : déportation, colonies, torture, mur de séparation, avant-postes non autorisés, détention administrative, démolition punitive et assassinat ciblé. Alors qu’Israël s’apprête à voter pour la troisième fois en moins d’un an dans un contexte politique très tendu, et que le « plan de paix » annoncé par les États-Unis est enfin sur la table, cette réflexion sur la défense des droits de l’homme apparaît plus que salutaire. RB
Les États-Unis ont présenté cette semaine le « Deal du siècle » promis depuis des mois par Donald Trump pour régler le conflit israélo-palestinien. Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou n’a pas caché sa satisfaction devant un « plan de paix » qui entérine notamment la politique de colonisation en Cisjordanie, le non retour des réfugiés palestinien ou la souveraineté exclusive d’Israël sur Jérusalem. Sans surprise, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a déclaré que « le plan Trump ne passerait pas ». Quel regard portez-vous sur cette initiative du président américain ?
Il faudrait d’abord se mettre d’accord sur les termes, ce qui a été présenté cette semaine n’est pas u