Benoît Peeters : « Le droit d’auteur est devenu un simple principe et non une réalité tangible »
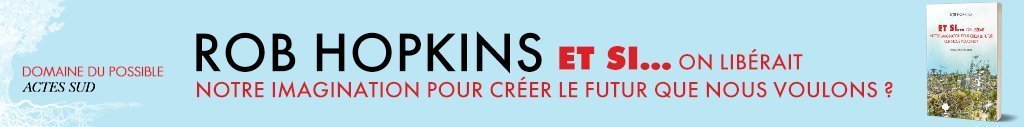
Remis officiellement fin janvier au ministre de la Culture, le rapport de Bruno Racine sur « L’auteur et l’acte de création » a jeté un pavé dans la mare. Il était très attendu, car aussi étonnant que cela puisse paraître, les évolutions majeures des secteurs de la création, sous l’impulsion notamment de la numérisation, n’avaient pas jusque-là entraîné de réflexion majeure sur la situation de celles et ceux sans qui ces industries n’auraient tout simplement rien à proposer : les artistes-auteurs. Or, ce qu’a montré le document remis par l’ancien président du Centre Pompidou et de la Bibliothèque nationale de France, c’est que leur condition s’est considérablement dégradée. En cause, un partage de la valeur de plus en plus en défaveur d’auteurs qui, par ailleurs, ne sont pas ou mal représentés. Franck Riester, le ministre de la Culture, a annoncé le 18 février dernier les mesures proposées pour y remédier, et le moins qu’on puisse dire c’est que ces annonces ont déçu ceux qui comme Benoît Peeters militent pour une professionnalisation des auteurs susceptible de renforcer leur place au sein des industries culturelles. L’évolution nécessaire pour s’adapter aux transformations radicales n’est pas au rendez-vous. En cause, une vision désuète des droits d’auteurs et une instrumentalisation par ceux qui sont pourtant censés les défendre. RB
Vous avez salué la publication du rapport Racine, mais été plus critique sur les propositions qu’en a tiré le ministre de la Culture Franck Riester. Avez-vous le sentiment qu’on est aujourd’hui à un tournant en ce qui concerne le statut et la reconnaissance des auteurs ?
Avant de vous répondre sur l’actualité, j’aimerais rappeler quelques éléments importants. D’abord, que les avancées historiques sur ces questions ont toujours été portées par les auteurs eux-mêmes. Quand Beaumarchais et d’autres auteurs de théâtre ont voulu obtenir la reconnaissance de leurs droits, ils se sont battus en première ligne et ont créé la Société
