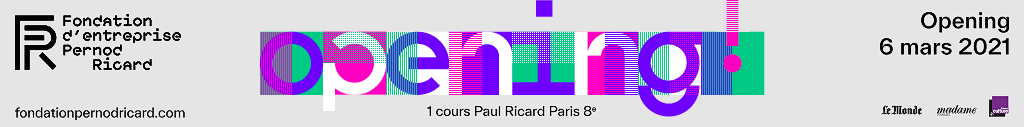Nathalie Quintane :
« La démocratie niche parfois dans la poésie, à défaut d’être ailleurs. »
Une prof vous dit tout. Elle vit en collège et enseigne en province ou vice-versa, elle est agrégée. Parfois, d’aimables collègues déposent une brochure dans son casier sur le cumul d’activités, vu qu’elle est aussi écrivaine, auteure de textes (roman, poésie, essai) faussement idiots et véritablement politiques. Comme c’est Nathalie Quintane, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle éponge les ressacs fanés du ressentiment ou pleure sur la « grande misère » de l’enseignement. Dans Un hamster à l’École (à paraître le 14 janvier), ce qu’elle a à dire est beaucoup plus simple et plus vaste à la fois : « si je compte la fac, 5 ans de plus… et le secondaire, 7 ans… et l’école, 5 ans… et la maternelle : + 2… 53 ans que, élève, étudiante, enseignante, je suis dans l’Éducation nationale. » On pourrait faire une variation : « pendant que nous on vit, de gré ou de force, dans BFM Bizness, [les élèves] vivent dans Tolkien » (p. 75).
Nous sommes tous dans quelque chose, comme des hamsters, à pédaler en rond. Quintane creuse ainsi le sillon sociohistorique de ses Années 10 (La Fabrique, 2014) ou de Que faire des classes moyennes ? (P.O.L., 2016) en racontant les cinquante dernières années de la France, certes au prisme de l’institution éducative, mais en tant que ce qui s’y joue ne fait que refléter un mouvement politique général : ségrégation sociale, névroses autoritaires, mesquineries, innocences, réformes ubuesques, intimidation intellectuelle… Reste la création : « Considérant que tous les poèmes (et toute littérature) sont d’intervention – ce que je considère – leur importance se mesure à ce qu’ils firent des circonstances, s’ils les nommèrent, s’ils y mordent encore. » (p. 97)
Un hamster à l’école pourrait aussi être le livre le plus autobiographique de l’auteure (piscine, sandwich, tutos pour éviter de parler de la mort quand un parent d’élève est mort) si la narratrice n’était toujours, comme dans chacun des livres de Quintane, sur le fil de l’ironie, de l’observation de soi, totalement désespérée et totalement vénère à la fois, et si le texte, précisément, ne « mordait » pas autant dans les « circonstances » de notre temps. EL
Qui dit « je » dans Un hamster à l’école ? Et est-ce que la question importe ?
Comme très souvent, voire comme d’habitude, ce « je » n’est pas tout à fait moi, ce qui n’a rien d’innovant depuis au moins Jean-Jacques Rousseau… S’il était en position de cobaye actif dans les Remarques (éd. Cheyne, 1997), où il faisait des « expériences », il est dans ce Hamster plutôt rétrospectivement cobaye, quand il n’est pas tout simplement en commun avec d’autres « je », pas mal d’autres : l’adolescente que j’ai été, la jeune prof, la prof moins jeune, mais aussi les voix restaurées de certains élèves, celles de mes collègues, celles de ceux qui m’ont raconté leur école, leur passé scolaire, et sans doute celle de l’institution qui parle à travers moi… puisqu’un écrivain qui écrit ne se possède pas. La question est importante parce que la « position » énonciative est trouble, ou en tout cas doublée ; elle se fait doubler par le gosse qui parle encore dans l’adulte, et inversement. La dimension orale du texte vient de là aussi, je crois, de ce désir que tout le monde parle un peu en même temps et tour à tour, comme dans une classe où y a le bordel ! Sauf que là, comme c’est écrit, si on écoute bien, on entend tout le monde.
Ce principe d’écoute ou de « voix » est là depuis le début de votre œuvre. On pense à la figure de Jeanne dans Jeanne Darc (P.O.L., 1998)… Est-ce que cette écoute est une façon de raconter ou faire « l’histoire de France », tantôt de façon synchronique (Les enfants vont bien, P.O.L., 2019) et tantôt diachronique (Un hamster à l’école) ?
Ce qui m’intéresse depuis toujours, c’est la puissance du déni dans ce pays. Je ne crois pas que la multiplication des euphémismes soit seulement une affaire de diplomatie ou de communication. Elle mine le langage, elle le brutalise en pensant l’atténuer, tout en le plaçant en orbite – et donc en nous plaçant en orbite, nous, en nous faisant flotter ; nous flottons politiquement, et puis quelquefois on tombe, et alors ça fait mal, mais nous sommes heureux de retrouver le sol pendant une manifestation ou une occupation, par exemple. Je me demande si une partie de la polémique autour du mot « racisé » ne vient pas de là, de ce que, pour une fois, ce n’est pas un euphémisme et on n’essaye pas de se cacher derrière son petit doigt. Bref, le travail dans Les enfants vont bien (P.O.L., 2019) se plaçait précisément là : exposer les discours, avec un découpage et un éclairage ad hoc, de manière à ce que le lecteur/spectateur se dise : oh là ! c’était donc ça ! Avant Jeanne Darc, par pudeur ou par timidité, j’avais pris Christophe Colomb… Et puis je me suis dit : après tout, vas-y ! Les fous français se prennent soit pour Napoléon, soit pour Jeanne d’Arc… Et donc, Jeanne Darc, c’est moi… Au sens où, dans ce texte, elle essaye d’y voir clair en luttant contre le déni (le sien, celui des autres). Je me souviens que l’âge de Jeanne m’avait frappée : elle était vraiment jeune… une ado… et je m’étais dit que ce serait un bon filtre… ou canal… pour parler de l’adolescence et des guerres qu’on mène à cet âge-là. Il n’y a pas de séparation franche entre guerres intimes et guerres officielles (ce que dit, par exemple, la lutte contre le patriarcat) ; je crois que c’est ce que ce texte fouillait, tentait d’excaver.
Cependant, il y a une forme d’ironie, parce que Jeanne d’Arc était déjà à l’époque récupérée par le Front National…
Jeanne d’Arc est une construction bien rance du XIXe siècle… Et bien sûr le Front National a pris le relai… Le personnage était tellement encroûté (même si Delteil l’avait sérieusement décrassé) que c’était un pari excitant que de tenter de le reprendre, de lui donner une innocence et une détermination pour aujourd’hui… Pour vous dire ma naïveté, je pensais que peut-être, si le livre circulait, ça embêterait le F.N., et qu’on lui reprendrait Jeanne… parce qu’il faut tout reprendre… Je me souviens qu’on en avait parlé avec Paul Otchakovsky-Laurens, de cette idée de reprise. Puisqu’ils récupèrent (Mondzain dit : « confisquent ») les mots de la gauche, les personnages, les écrivains, etc., on doit s’atteler à la tâche infinie de les reprendre, par exemple.
Finalement, ce n’est pas le F.N. qui a tout récupéré et opéré des renversements infinis… ça a empiré largement avec Sarkozy et l’époque de ce que vous avez appelé la « brouillasse », peut-être, qui est encore la nôtre, une incapacité à penser clair…
C’est sûr que je ne voudrais pas visiter le cerveau de Darmanin… Après, « penser clair », c’est un peu une illusion française… Cela dit, c’est un peu comme si chaque phrase dite était « pensée » comme super-claire mais sans raccord avec la phrase précédente… Chacune posée comme un isolat, en fonction de son efficacité supposée dans la situation immédiate. Sans mémoire et sans perspective, donc, ou factices (tel parachutage de Maurras par-ci ou de Gaulle par-là).
Le premier gros travail (et passionnant), quand on en a le temps, c’est de replacer les formules et les citations dans leur contexte… Et sans les tronquer… Après, du côté de la base, il me semble que les choses ont changé depuis 4 ou 5 ans… Les manifs ballons-saucisses en ont pris un sacré coup derrière la casquette… La pertinence, l’inventivité, l’humour des banderoles et des tags ont changé la rue… Je ne dis pas que cela n’a pas été le cas avant (merveille des affiches de mai 68), mais la diffusion des phrases et mots d’ordre me paraît plus large, plus accessible – on reprend les punchlines du rap, des jeux de mots, des phrases en latin… ça vit ! Les gens qui écrivent, poètes, écrivains, artistes, fournissent du matériel… Un énoncé comme « changer la vie », repris au bon moment, au bon endroit, par la bonne personne et à destination des bonnes personnes (ça fait beaucoup de critères mais ils sont tous nécessaires) devient un mot d’ordre. Rimbaud n’a pas pondu de « formules »… Mais ses phrases, reprises, deviennent des formules. Je dois vous paraître trop optimiste, dans la mesure où ça ne cesse d’insister en sens contraire, celui de plus de « brouillage »…
Pas nécessairement « trop ». Mais on dirait que vous êtes de plus en plus optimiste avec le temps…
Je suppose que c’est une affaire de vases communicants… Plus on désespère (à raison) autour de moi, plus je compense ! Mais… Comment dire… J’en ai discuté récemment avec un jeune ami, qui me disait qu’il en avait assez des luttes défensives (on manifeste pour sauver ceci ou cela) et des défaites du mouvement social. D’abord, je ne vois pas pourquoi on devrait venir en soutien de tous ceux dont la tâche est de minimiser le mouvement, de relativiser le courage qu’il faut pour aller maintenant en manif… Ensuite, je suppose que c’est le fait d’écrire qui te place d’emblée du côté de l’attaque, et donc d’une forme d’élan… Je ne vais pas citer Kafka… qui est très clair, là-dessus. La littérature (ou la poésie) ne sont jamais défensives – ou alors, c’est que quelque chose cloche – ; Beckett, Bessette… même les plus désespérés des désespérés ont fabriqué une littérature terriblement offensive, efficacement offensive… La littérature est du côté des « défaits », certes, du côté des fragiles et des dominés, mais ce n’est pas une défaite ; elle contribue à nourrir… une « ambiance », un air du temps, pas forcément plus « pur » mais qui se coltine la pollution générale. Ensuite, et pour revenir à mon jeune ami, au point où nous en sommes, un mouvement aussi intéressant que Nuit debout et un soulèvement populaire aussi complexe et fort que les Gilets jaunes ne peuvent pas être unilatéralement et brutalement considérés comme des défaites… Même s’ils ont été écrasés (et s’ils n’avaient pas été aussi menaçants, il n’y aurait pas eu besoin de les écraser).
Est-ce Nuit debout et les Gilets jaunes, justement, qui vous ont poussée à radicaliser l’écoute avec Les enfants vont bien, un livre entièrement composé d’énoncés qui ne vous « appartiennent pas » ?
Je me demande si ce n’est pas aussi 30 ans d’enseignement !… Quand on est prof, on débarque avec cette idée qu’il faut, coûte que coûte (comme on dit aujourd’hui) faire passer le « programme », qu’on a très peu de temps pour le faire… Et donc qu’il reste très peu de temps pour écouter les élèves… On les entend, mais je crains qu’on les écoute assez peu… Cela dit, l’attention aux mots des autres s’est portée dans Les enfants vont bien sur les mots du pouvoir, essentiellement. C’est un livre de montage, qui coupe et colle des extraits de discours politiques, de décrets et lois récents sur l’immigration, des titres de presse, des bouts de boucles de mails d’associations qui « gèrent » des centres d’accueil, et puis, en tout petit, tout en bas, des messages du Réseau Éducation Sans Frontières, qui essaye de sauver ce qui peut l’être de toutes ces familles déboutées et gosses à la rue… C’est la juxtaposition de ces phrases qui rend le livre violent. On m’a reproché un procédé un peu « daté »… comme on avait reproché à Varda les procédés datés de Sans toit ni loi, à l’époque… Pour moi, le montage n’est pas une propriété privée de l’avant-garde… Et tant mieux si Sophie Divry l’a utilisé dans Cinq mains coupées…
Tout à l’heure, vous parliez de « mot d’ordre ». On connaît tous cette vidéo de Deleuze à la Fémis parlant de la com et du journalisme comme « mots d’ordre », le contraire de la création… Mais pour vous, c’est un terme positif…
C’est nous, l’ordre, et c’est eux, le désordre ! Ok, ça va paraître provoquant… mais si vous venez dans la petite ville où je vis, vous verrez à quel point le démantèlement des services publics crée un désordre insupportable et invivable. La Commune de Paris, pour ne citer qu’elle, a su organiser et inventer des services… Les Gilets jaunes avaient commencé de s’organiser… Et puis Jack London était journaliste, non ? Je réagis parce que j’aurais bien aimé être journaliste mais malheureusement ça bricole tellement dans ma tête que je n’ai pu faire qu’écrivain.
Concernant l’ordre, en lisant Un hamster à l’école, quand « je » parle de son enseignement et de sa façon de mener la classe, on dirait que ça ne rigole pas trop et qu’on file droit. Madame la professeure n’a pas l’air à la coule…
Ah ah ! Je tente de rendre compte d’un cours dans le livre, un cours assez spécial puisque c’était un retour de confinement pour une classe de cinquième, en mai dernier. Le déroulement en est assez classique, au fond… Ça commence par une reprise du « programme » (Yvain ou Le chevalier au lion), pour vérifier ce qu’ils ont compris ou pas… et puis je m’arrange, à un moment, pour essayer de les « dégeler » (le masque, ça n’aide pas)… et la deuxième partie du cours est… plus cool… plus improvisée et, j’espère, plus à leur écoute… ce qui était très important, en l’occurrence. Une fois que j’ai dit ça, ceci (que je raconte dans le livre, d’ailleurs) : le lieu gagne toujours… L’institution l’emporte – ses bâtiments, ses horaires, son administration, etc. Les enseignants qui, au lendemain de 68, ont débarqué avec l’intention de changer les choses ont en général été révoqués ou suspendus assez vite… Je raconte l’une de ces histoires dans un livre à paraître chez P.O.L. l’automne prochain, La cavalière. La répression a été terrible, au début des années 70 ; quand le mouvement lycéen est retombé, autour de 73, des classes entières se sont fait virer… On passait en conseil de discipline pour un tag… Ce livre revient sur cette période par les témoignages de personnes qui avaient la vingtaine à l’époque et qui en ont vécu pleinement les expériences (communauté, luttes, redescente…) tout en essayant de réfléchir à ce que ça nous dit encore aujourd’hui, à ce qu’on peut en faire. Il ne faut pas oublier que je suis (aussi) le hamster qui tourne dans sa roue, dans sa routine, en prof-animal qui n’a pas quitté l’Éducation nationale, qui s’en est arrangé… qui n’est pas quelqu’un d’exceptionnel mais un prof comme un autre.
Malgré le fait que vous ne soyez ni septuagénaire ni académicienne, vous sentez-vous mûre pour écrire un Dictionnaire amoureux de l’enseignement ?
Hum hum… Précisons : je n’avais pas la vocation (premier point). Je ne l’ai toujours pas, mais : les enfants d’abord, d’une certaine manière. Des fois, ça me botte de faire cours, parce que c’est vivant et que je peux bosser avec des ados et pas avec des adultes. Parce que je ne m’ennuie pas, en cours, et que l’ennui ou sa simple perspective me tuent. Très égoïste, donc. Ensuite : je n’ai fondamentalement rien à dire à une institution dont le fondement est l’évaluation. Le malentendu est trop important. Je ne cause pas avec des gens qui t’évaluent, qui portent plus haut que tout l’évaluation de toutes et tous y compris eux-mêmes, c’est-à-dire qui portent la défiance, la surveillance, le contrôle, et des critères passablement arbitraires comme si c’était l’alpha et l’oméga d’une vie en société. Là où on sent bien que ça gêne aux entournures, c’est qu’à intervalles réguliers, l’institution propose des modifications de l’évaluation (on va mettre des lettres plutôt que des notes, ou des couleurs plutôt que des lettres, etc.). Donc, rien ne change.
À propos d’ennui, Un hamster à l’école propose un concept politique original, celui d’une « paresse impersonnelle », qui vaut pour les élèves mais aussi pour toute la société…
L’institution nous façonne comme nous la nourrissons de notre négligence, de notre angoisse, de nos empêchements respectifs… Si bien que l’abstention… enfin, ce qu’on appelle plus couramment l’absentéisme, est vu en effet comme une paresse personnelle, une chose qui n’a pas trop d’excuse ou pas d’excuse du tout, un bon coup de pied au cul et ça repartirait… Les justifications sont convenues (maladie avérée ou feinte, par exemple). Mais passé un certain seuil et au-delà d’un certain chiffre, sans doute conviendrait-il de se poser des questions… Pourquoi manquait-il ce matin 10 élèves sur une classe de 30 dans un établissement de centre-ville bien sous tous rapports (le « mien ») ? la Covid ? la neige ? Allons allons… Qu’est-ce que cette baisse générale de « motivation », comme on dit ? Je me souviens de l’interview d’une curatrice LVMH, il y a quelques années… Tout était nickel… La seule faille, qu’elle évoqua comme en passant et sans y croire, mais on sentait que c’était l’horreur en perspective, LA chose inimaginable… que les gens ne viennent pas, tout compte fait, qu’ils ne se déplacent plus… Nuit debout a mis le doigt dessus, par exemple : bah non, finalement, on ne participe plus… C’est fini… D’où la reprise en main quasi immédiate par les pseudo initiatives « citoyennes », grands « débats », et divers subterfuges.
Mais on est très contrariants, parce que maintenant que nombre d’événements pseudo participatifs sont annulés pour cause sanitaire et que des œuvres superflues n’ont pas vu le jour, on trouve que ça manque, tout creux qu’on les trouvait…
Faut faire la différence entre les gros bazars hypocrites à la LVMH et autres biennales d’art contemporain « citoyennistes », qui entendent nous apprendre à vivre et à parler plus propre, et les initiatives plus petites… Oui, le cinéma me manque, les expos me manquent, le travail des artistes me manque, et même le théâtre, où en général je me fais chier… qu’est-ce que je donnerais pas pour pouvoir me faire à nouveau chier au théâtre, aujourd’hui… Qu’est-ce que vous pensez, les copains ? Qu’est-ce que vous voyez, les amis ? On n’écrit pas seul.e ; on ne vit pas seul.e.
Pourquoi avez-vous choisi de présenter Un hamster à l’école, qui est une sorte d’essai, en vers ? Sur le plan poétique, vous avez déjà évoqué cette dialectique du « savant » et du « populaire » à propos du Chaosmogonie (2010) du poète italien Nanni Balestrini, livre composé de citations de Bacon, Cage ou Godard, dont vous avez préfacé la traduction aux éditions La Tempête…
Ouh, malheureux, ne dites surtout pas qu’il s’agit de vers !… Une prose coupée, tout au plus, et même coupée et cassée ensuite par la mise en page (ce qui est très bien). Il y a eu longtemps une première version sans coupes mais, comment dire, ce flux ou courant sympathique ne me semblait pas rendre justice aux embarras et contradictions diverses qu’évoque le texte. Le fait de passer à la ligne non arbitrairement mais chaque fois (ou presque) avec un mot de classe grammaticale différente permet le saut aussi bien après les nobilités ordinaires (noms ou verbes) qu’après le petit personnel (pronoms, adverbes, conjonctions, prépositions, etc.), ce qui a l’avantage de péter la syntaxe de temps à autre. Une vraie mesure de gauche, en somme. Oui, on a des preuves que la démocratie niche parfois dans la poésie, à défaut d’être ailleurs. C’est le cas dans le travail de Nanni Balestrini, membre du Gruppo ’63, collectif de poètes sans porte-parole et sans manifeste puis membre fondateur de Potere Operaio – il revient, avec Primo Moroni, sur les années de l’autonomie dans un gros livre de montage (tracts, textes et documents divers) absolument génial, La horde d’or, traduit récemment en français.
La rencontre de l’avant-garde et du roman populaire est rare, il faut le dire, mais elle a donné des œuvres magnifiques, celle de Balestrini (dans Nous voulons tout, par exemple, il coupe et monte le témoignage d’un ouvrier du sud de l’Italie parti travailler à Milan, c’est simple et savant à la fois) ou celle de Jules Vallès, communard et adepte du jeu de mots et des fantaisies graphiques… un ancêtre à coup sûr de Dada autant que du Canard enchaîné. Je suis en train de lire un roman poétique, La tour, d’Hélène Bessette, où tout est dit sur la société de consommation et le capitalisme à la fin des années 50, une version terriblement cruelle du livre de Perec sorti six ans plus tard, en 1965, Les choses… La tour est un chef d’œuvre, il faut avoir le cœur bien accroché pour le lire jusqu’au bout, mais ça en vaut la peine. Queneau, qui éditait Bessette chez Gallimard à l’époque, lui avait demandé de « lisser » le texte (versifié et rimé à la diable, et le diable en l’occurrence s’habillait en Stein, Gertrud), mais Bessette n’a ni pacifié le poème ni atténué la charge ; tout y est prêt pour aujourd’hui et pour le pire – la soif inextinguible de chiffres et de célébrité… l’argent, valeur sublime… J’essaye d’écrire une préface pour la réédition de ce livre au Nouvel Attila… Je me suis mise à écrire des préfaces… des préfaces pour tous ces livres géniaux que je n’ai pas écrits…