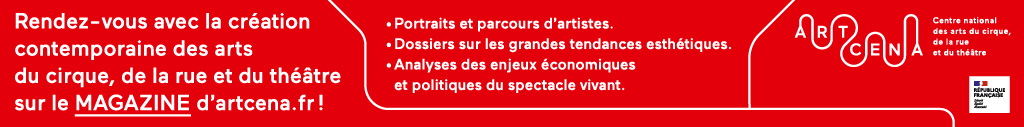E. Chiappone-Piriou et C. Libert : « Superstudio considérait l’architecture comme une manière autonome de penser le monde »
Alors que les portes des musées et des institutions culturelles françaises restent closes et que l’horizon est toujours incertain, la Belgique a rouvert ses expositions au public. Situé dans la commune d’Ixelles à Bruxelles, le CIVA (Centre international pour la ville, l’architecture et le paysage) présente l’exposition « Superstudio Migrazioni », véritable voyage entre architecture, design, art et anthropologie, au cœur de l’œuvre prolifique du fameux collectif d’avant-garde Superstudio. Créé au milieu des années 1960 à Florence par Adolfo Natalini et Cristiano Toraldo di Francia, disparus successivement au cours des deux dernières années, Superstudio est rejoint par d’autres complices pendant une décennie particulièrement productive. Sa dissolution au tournant des années 1980 n’a pas empêché le collectif de marquer durablement l’imaginaire architectural et artistique de plusieurs générations, avec ses images à la puissance narrative exceptionnelle, son mobilier quadrillé et ses projets à la fois radicaux, ambigus et prospectifs qui portent des noms comme Monument continu, Supersurface ou les Actes fondamentaux, dans lesquels l’éducation, la cérémonie et l’amour côtoient la vie et la mort. « Sur le fait que le monde soit rond et qu’il tourne, il semble qu’il n’y ait pas matière à discuter. Ce dont il faut encore discuter, par contre, c’est la manière de vivre dessus ». Emmanuelle Chiappone-Piriou et Cédric Libert, commissaires de l’exposition reviennent pour AOC sur les histoires plurielles de ce collectif hors-du-commun, « oublié dans les tiroirs de l’histoire » pendant près de vingt-cinq ans et dont la production architecturale a englobé « les choses, le corps, la Terre ». OR
En 1966, à l’occasion d’une exposition, Adolfo Natalini écrit un manifeste à partir de l’emploi du superlatif qui a donné son nom à Superstudio : « La super-architecture est l’architecture de la super-production, de la super-consommation, de la super-induction à la consommation, d