Kate Brown : « Nous n’avons tiré aucune leçon de Tchernobyl »
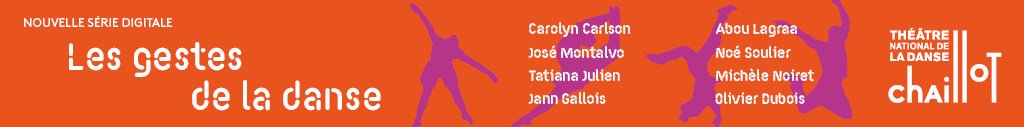
Dans sa version originale, le nouvel ouvrage de Kate Brown, Tchernobyl par la preuve : vivre avec le désastre et après (paru en mars aux éditions Actes Sud), s’intitule Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future (W. W. Norton & Company, 2019), un manuel et un guide donc pour survivre dans un monde marqué par la catastrophe nucléaire. C’est l’apport essentiel de Kate Brown, professeure au MIT, connue pour son travail en histoire environnementale comparée, et pour ses études des réactions de différentes communautés humaines aux effets transformateurs de l’industrie et des technologies : montrer que nous subissons tous sur la planète l’effet des retombées radioactives de plus d’un demi-siècle de choix nucléaires. Après dix ans d’enquête sur le terrain, entre l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie, dans plus de 25 fonds d’archives, cette russophone a pu montrer que, contrairement à ce que le pouvoir soviétique mais aussi les instances internationales comme l’ONU ont cherché à faire croire, les conséquences de l’accident du 26 avril 1986 ne sont absolument pas circonscrites à la « zone d’exclusion » qui entoure l’ancienne centrale nucléaire. Or, le débat fait rage sur l’effet à long terme d’une exposition dite à des « faibles doses » de radioactivité. Cela touche en effet au sujet sensible de la dangerosité des choix politiques qui ont été faits en matière civile comme militaire, de l’énergie aux essais nucléaires, dont Kate Brown remet en cause la sacro-sainte distinction. RB
De quoi Tchernobyl est-il le symptôme ? Pourquoi est-il si important d’y revenir, 35 ans après la catastrophe ?
Le désastre de Tchernobyl est important car c’est un indicateur à l’échelle mondiale, en tant que pire accident nucléaire que l’humanité ait connu, au cours duquel X personnes sont mortes. Ce nombre X a été instrumentalisé, politisé jusqu’à devenir un argument à la fois des partisans et des détracteurs de l’énergie nucléaire. Si vous partez sur la base des 33 à 54 victimes et les 2 006 décès à long terme avancés par l’ONU [1], vous pouvez en conclure que, comme plus de gens meurent dans les mines de charbon ou en installant des panneaux solaires sur les toits, l’énergie nucléaire est tout ce qu’il y a de plus sûre, et que nous pouvons accepter les risques qui l’accompagnent. À l’inverse, lorsque d’autres avancent le chiffre de 93 000 à 200 000 morts – ce sont les projections de Greenpeace –, alors les risques sont inacceptables et l’énergie nucléaire devrait être abandonnée progressivement. Tchernobyl est donc une sorte de point d’appui, bien plus par exemple que Three Mile Island, la centrale située en Pennsylvanie (États-Unis) où un accident nucléaire est survenu en 1979. Cet événement plus petit et beaucoup plus limité dans son ampleur, qui n’a pas fait de victimes humaines directes, a pourtant conduit les États-Unis à cesser toute construction de centrales nucléaires. Même Fukushima, plus récent, ne tient pas ce rôle emblématique bien que les rejets nucléaires pourraient s’avérer aussi importants que ceux de Tchernobyl. Le bilan de cette catastrophe est toujours en cours, car les fuites de la centrale japonaise continuent à ce jour.
Vous avez pu consulter des archives qui n’avaient jusque-là jamais été exploitées. À quel type de matériel avez-vous pu avoir accès et qu’avez-vous trouvé ?
Pour vous répondre, il faut revenir un peu en arrière. Je me suis lancé dans ce projet alors que j’écrivais un livre intitulé Plutopia, qui traite de l’histoire comparée des deux premières villes du monde à produire du plutonium : la ville américaine de Hanford, dans l’État de Washington, et la ville soviétique de Mayak (ou Plant Mayak) en Sibérie [2]. En travaillant sur ce livre, je ne m’intéressais pas à la santé ou aux effets des radiations, mais à la sécurité nucléaire. Cependant, les agriculteurs vivant en aval de ces deux lieux ne cessaient de me parler de leurs problèmes de santé. Ceux-ci étaient minimisés par les scientifiques, qui se moquaient des agriculteurs, en les accusant d’être stupides et « radiophobes », d’exagérer en attribuant tous leurs problèmes de santé aux radiations.
Après avoir terminé Plutopia, je me suis dit que cette histoire devait être racontée et que Tchernobyl pourrait être un bon point de départ pour enquêter de par l’ampleur de cet accident, avec un rejet de radiations de l’ordre de 50 à 200 millions de curies, et d’autre part parce que le site était public, dirigé par une puissance civile. J’espérais donc trouver plus d’informations que si cela avait été un site militaire. Je me suis d’abord rendu aux archives de Kiev, en Ukraine, et j’ai demandé les dossiers du ministère de la Santé sur Tchernobyl. L’archiviste m’a d’abord répondu que je ne trouverais rien car le sujet avait été occulté par l’Union soviétique. J’ai insisté et il se trouve que nous avons exhumé une énorme collection de documents étiquetés en ukrainien : « Les conséquences médicales de la catastrophe de Tchernobyl ». J’ai commencé à lire ces gros volumes reliés et j’ai rapidement réalisé qu’il s’agissait d’une véritable mine d’or. En fait, l’archiviste n’avait pas essayé de me mentir. C’est juste que personne n’avait jamais demandé ces documents auparavant… le personnel des archives ne savait donc même pas qu’ils existaient.
Mais en supposant qu’ils n’existaient pas ou en supposant que l’on ne trouverait rien parce que c’était la période soviétique ?
Peut-être que les gens ont cru les archivistes sur parole, peut-être que la question n’était pas intéressante à l’époque, parce que tout le monde était satisfait des rapports de l’ONU qui sont sortis dans les années 2000 et qui minimisaient les conséquences médicales de l’accident… Je ne sais pas pourquoi. Lorsque j’ai examiné ces rapports à Kiev, j’ai vu qu’ils étaient très étroitement axés non seulement sur les personnes qui recevaient des rayons gamma dans l’environnement ambiant, mais aussi sur les personnes qui mangeaient et buvaient cette radioactivité dans leurs aliments et leurs sources d’eau. C’est pourquoi je me suis dirigée vers les documents du ministère de l’Agriculture. Ce qui est pratique avec les gouvernements communistes, c’est que tout est centralisé : toutes les entreprises qui produisent de la nourriture sont enregistrées auprès du ministère de l’Agriculture, car elles appartiennent toutes à l’État. Là-bas, j’ai trouvé des tonnes de preuves qui montraient que les aliments radioactifs se retrouvaient tout au long de la chaîne alimentaire. J’ai tout de suite pensé que j’avais intérêt à ne pas me tromper si je voulais dévoiler cela, contre le récit communément admis. Après avoir travaillé sur les sources nationales, je suis donc descendue à l’échelle de l’oblast (communauté territoriale) de Kiev, dans lequel se situe le site de Tchernobyl et, de là, aux archives locales, celles des raïons (districts). Je suis ensuite partie en Biélorussie puis en Russie poursuivre mes recherches dans les archives fédérales soviétiques.
Au final, j’ai travaillé dans vingt-sept départements des archives. Je l’ai fait parce que je savais que, lorsque je publierai un livre sur ce sujet dans des pays partisans du nucléaire, comme la France, de nombreuses personnes haut placées et très diplômées viendraient remettre en question mon travail. J’ai donc croisé les données provenant des hôpitaux locaux et j’ai suivi la trace des rapports au fur et à mesure qu’ils remontaient la chaîne de commandement. Je me suis rendu compte que les médecins locaux ne savaient pas qu’ils vivaient dans un territoire radioactif – et ils ne le sauraient pas avant 1989, à la publication des rapports dans le cadre de la glasnost, la politique de transparence initiée par Mikhaïl Gorbatchev. Jusque-là, les responsables leur avaient assuré qu’ils avaient contenu les radiations à l’intérieur de la zone de Tchernobyl – ils avaient mis une clôture autour de la zone et c’était tout. La vie continuait. Cependant, parce que les données de santé locales avaient été dûment enregistrées – toujours dans le cadre de la politique communiste –, ces médecins ont pu les consulter et en faire une sorte d’épidémiologie de tous les jours. C’est à ce moment-là qu’ils ont découvert des taux croissants de maladies dans cinq catégories principales concernant la fertilité des femmes et la néonatalité : plus d’enfants présentant des malformations congénitales ; plus de fausses couches ; une mortalité infantile très élevée durant les deux premières semaines de vie ; des problèmes du système immunitaire, des troubles de l’appareil digestif, de l’appareil respiratoire, du système endocrinien ou de la circulation sanguine.
Il y avait donc une conscience locale de la gravité des conséquences sanitaires malgré les discours officiels ?
Les responsables locaux, inquiets, commençaient à voir grimper la fréquence des maladies que je viens de citer, et ne sachant pas ce qui se passait, ils ont rédigé des rapports en 1988. Lorsque ceux-ci ont été transmis à l’échelon supérieur, le chef de l’oblast a eu des décisions difficiles à prendre, car les résidents de l’URSS étaient soumis à la propagande selon laquelle leur nation était de plus en plus heureuse et en meilleure santé chaque jour, chaque année. La communication de mauvaises nouvelles étant fortement déconseillée, les responsables de la santé publique ont décidé de « faire le ménage », c’est-à-dire d’enjoliver les résultats des dossiers avant de les remettre à l’échelon supérieur. Même chose au niveau gouvernemental : les fonctionnaires du ministère de la Santé de l’Ukraine ont fait en sorte que les dossiers soient modérés avant de les envoyer à Moscou. Certaines personnes ont toutefois commencé à s’inquiéter et à soulever des questions : il s’agissait de contrôleurs des radiations, d’inspecteurs de la santé publique au niveau local, de personnes chargées de surveiller l’eau potable et les réservoirs etc. La trace de ces controverses se retrouvent dans les archives, certaines personnes affirmant que tout allait bien, d’autres disant qu’elles commençaient à s’inquiéter. J’ai donné plus de poids à ces dernières parce qu’il était politiquement déconseillé de tirer l’alarme. Les preuves sont à nouveau dans les archives des raïons : ces personnes, ces lanceurs d’alerte, étaient réprimandées au travail, certaines étaient rétrogradées, d’autres licenciées après s’être plaintes, et d’autres encore étaient éliminées sur ordre de Moscou.
Tout s’est précipité en 1989 lorsque les cartes de radiation ont été publiées. Les médecins ont soudain réalisé que, depuis trois ans, ils vivaient dans une terre tout aussi contaminée que celle située juste à côté de la centrale de Tchernobyl, et que, à cette lumière, leurs données de santé n’étaient absolument pas étonnantes. C’est là que le chaos s’est installé. Les ministères de la Santé de Biélorussie puis d’Ukraine ont déclaré officiellement l’existence d’une catastrophe de santé publique. Ils ont entrepris deux choses : premièrement, il a fallu déplacer deux cent mille personnes supplémentaires – c’est-à-dire en plus des cent vingt mille personnes déplacées juste après l’accident – des zones hautement contaminées qui l’étaient tout autant que celle de Tchernobyl. Deuxièmement, ils ont planifié une étude sanitaire à long terme similaire à celles réalisées à Hiroshima et à Nagasaki sur les survivants des bombardements, mais en tenant compte du fait que les habitants n’avaient pas seulement été exposés à une large et courte dose de rayons (comme dans le cas des bombes atomiques), mais aussi à des doses chroniques de radiation sur une longue période.
Votre livre est très précis et honnête, ce qui vous amène à reconnaître qu’il est parfois difficile de relier ces maladies à la radioactivité lorsqu’il s’agit de faibles doses. C’est, comme le montre Naomi Oreske dans Les Marchands de doute, la difficulté lorsqu’on travaille sur un sujet où s’opposent deux régimes de preuves scientifiques [3]. Qu’est-ce qui vous fait croire qu’une petite quantité de radioactivité est plus dangereuse qu’on ne le pense ?
Parce que ceux qui prétendent le contraire négligent le fait que les expositions puissent être éloignées du point de contamination dans le temps et dans l’espace. Il faut tenir compte de la météo qu’il faisait à l’époque, de la nature et des lieux des cultures alimentaires et du déplacement de ces aliments d’un lieu à l’autre par les humains. Dans les endroits qu’ils savaient hautement radioactifs, les fonctionnaires payaient les agriculteurs pour qu’ils ne produisent pas de nourriture et qu’ils achètent des aliments « propres » dans les magasins. Mais ces fermiers ont pris l’argent, et sont allés vendre leur propre production sur les marchés un peu plus loin ! La nourriture contaminée était donc consommée par les acheteurs dans un autre lieu. Voilà les effets de la dislocation dans l’espace et la dislocation dans le temps : les gens mangent des aliments contaminés et mettent du temps à développer une maladie – il faut entre 12 et 25 ans pour qu’un cancer apparaisse – sans compter les effets aléatoires. Les malformations congénitales peuvent survenir ou non avec le même degré d’exposition, cela dépend de facteurs individuels. Mais je suis convaincue qu’il y a suffisamment de preuves dans ces archives pour qu’une véritable étude épidémiologique puisse être réalisée, au-delà de ma seule évaluation. L’analyse de ces documents serait très précieuse, car aujourd’hui nous n’avons toujours que peu d’informations sur les conséquences du nucléaire.
Cinq années se sont écoulées après le bombardement de Hiroshima avant que les études de la Commission des victimes de la bombe atomique ne commencent. Jusqu’à la catastrophe de Tchernobyl, il n’existait donc pas de dossiers sur les suites d’un événement nucléaire aussi important durant les cinq années qui l’ont suivi. Mais ici, les Soviétiques ont constitué une base de données sur les aliments contaminés, sur l’effet des radiations sur le corps humain et sur les problèmes de santé à long terme. Toutes ces informations sont là pour être corrélées – et c’est ce que j’ai fait avec le concours de mes deux assistants de recherche. Nous avons constaté une augmentation de la fréquence des maladies. Prenons l’exemple des enfants : en 1986, 80 % des enfants d’un raïon étaient considérés comme sains, tandis que 10 à 20 % souffraient d’une ou de plusieurs maladies chroniques. En 1989, les chiffres s’inversent : 80 % ont une maladie chronique et seulement 10 à 20 % sont considérés comme sains. Les enfants, en effet, sont plus vulnérables aux radiations. Leur corps est en pleine croissance et leurs cellules se reproduisent rapidement.
Diriez-vous que c’est une erreur de considérer Tchernobyl comme une catastrophe uniquement soviétique ? Vous montrez dans votre livre l’implication de l’ONU et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Comment ces organisations internationales et les puissances nucléaires ont-elles été impliquées dans les suites de la catastrophe ?
En 1989, alors que les responsables soviétiques publiaient les premières cartes de radiation, les populations locales ont fait le rapprochement avec les problèmes de santé allant croissant. Elles sont descendues dans la rue et ont commencé à protester en Union soviétique. Le gouvernement soviétique a compris qu’il avait besoin d’aide et s’est tourné vers les agences de l’ONU pour obtenir la confirmation de leurs déclarations, selon lesquelles tout allait bien. Ils ont demandé à l’OMS de procéder à une évaluation indépendante avec des experts étrangers. Des mots magiques : les experts étrangers seraient objectifs. L’OMS a envoyé trois hommes, dont le Français Pierre Pellerin [4]. Ces trois physiciens, ayant tous des liens avec l’industrie nucléaire, ont voyagé sur les territoires de Tchernobyl pendant dix jours durant lesquels ils ont parlé à des citadins et des villageois et se sont entretenus avec des médecins biélorusses. Au terme de ces dix jours, ils ont publié une déclaration dans laquelle ils ont proclamé n’avoir constaté aucun problème local de santé. Ils ne voyaient aucune raison de s’inquiéter. Ils ont déclaré que le seuil de dose de rayonnement à vie que les Soviétiques avaient établi pouvait être facilement doublé ou triplé, et que les scientifiques biélorusses devaient être réprimandés pour leur incompétence.
Mais personne ne les a crus. Même les responsables soviétiques étaient mécontents – comment ces hommes pouvaient-ils conclure quoi que ce soit après seulement dix jours de discussion avec les villageois ? L’URSS s’est alors tournée vers l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour demander la même chose : une évaluation indépendante avec des experts étrangers. L’AIEA a accepté sans hésiter, mais elle a prévenu qu’elle était un lobby atomique dont le travail consiste, en somme, à promouvoir les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans le monde. Il a donc été décidé de créer une organisation factice appelée le Projet international sur Tchernobyl sous la direction d’Abel González, mais en réalité dirigée par l’AIEA. Ils ont également fait appel à du personnel d’autres programmes inter-agences, notamment des fonctionnaires de l’OMS, pour siéger au conseil d’administration. González et les scientifiques qu’il a nommés ont mis 18 mois avant de rendre leurs conclusions. Le programme a annoncé parfois avoir envoyé 100 scientifiques, parfois 200. Ce qui s’est réellement passé, c’est que toute la communauté scientifique était alors très curieuse de la situation à Tchernobyl, et des scientifiques étrangers de toutes disciplines étaient très enthousiastes à l’idée de partir en voyage d’étude là-bas. Chaque groupe partait deux semaines et revenait deux semaines plus tard, et puis d’autres personnes y allaient pour deux autres semaines. Les Soviétiques l’ont remarqué : à chaque fois, un groupe de personnes différent posait les mêmes questions que le précédent. Au bout de 18 mois, l’AIEA a déclaré que, bien qu’elle ait observé de nombreux problèmes de santé dans ces régions, elle ne pouvait pas affirmer que ceux-ci puissent être clairement reliés aux contaminants de Tchernobyl car, par rapport aux données de Hiroshima, les doses étaient trop faibles. L’agence en a déduit que les gens souffraient simplement de problèmes psychologiques dus au stress car ils s’inquiétaient constamment des radiations – alors qu’il n’y avait selon elle pas de raison le faire. En ce qui concerne le cancer de la thyroïde chez les enfants, les experts ont affirmé qu’il s’agissait de rumeurs, qui se sont avérées être de nature anecdotique.
Comment comprendre de telles conclusions ?
Ce qui s’était réellement passé en coulisses, c’est que quelques médecins ukrainiens avaient remis à Fred Mettler, le chef de la délégation, 20 biopsies d’enfants qui avaient eu un cancer de la thyroïde. Avant la catastrophe nucléaire, la proportion d’enfants atteints d’un cancer de la thyroïde était d’un sur un million. Tout d’un coup, une région comptant environ 200 000 enfants a vu 20 cas se développer – un pour 10 000, ce qui est le niveau d’une épidémie. Mettler a été témoin de cela mais il n’y a pas cru, c’était impossible compte tenu de ce qu’on savait. C’était trop, et trop tôt. Le groupe a emmené les échantillons au Nouveau-Mexique pour les analyser dans leur laboratoire. Même chose en Biélorussie : environ 30 enfants avaient un cancer de la thyroïde avant Tchernobyl ; en 1990, on décompte 100 cas à Minsk. C’était donc bien plus que des « rumeurs anecdotiques ». L’AIEA a refusé toute reconnaissance des effets de Tchernobyl sur la santé jusqu’en 1996, date à laquelle elle a été forcée d’admettre l’existence d’une épidémie. À cette époque, 4000 cas de cancer de la thyroïde pédiatriques avaient été découverts. Aujourd’hui, on en décompte environ 18 000. Ce cancer de l’enfant – dont la littérature médicale garantissait sa facilité de traitement – a été le seul effet sur la santé reconnu par les agences de l’ONU. Je ne sais pas si vous connaissez des enfants qui ont eu un cancer de la thyroïde. Ce n’est pas une belle chose à voir. Alors pourquoi l’ONU a-t-elle réagi ainsi ?
Tout d’abord, l’AIEA, dont la mission est de promouvoir le nucléaire, craignait pour l’avenir de cette énergie. Tchernobyl était devenu un sujet qui effrayait le monde entier. Le ministère américain de l’énergie, qui gère les affaires nucléaires, a organisé une conférence de spécialistes en radioprotection à Washington, D.C., un an après Tchernobyl, en 1987. Au cours de celle-ci, un fonctionnaire du ministère a déclaré à ces scientifiques que la plus grande menace pour l’énergie nucléaire et son avenir n’était pas un autre accident comme Tchernobyl ou Three Mile Island, mais les poursuites judiciaires qui pourraient en découler. Ce qui se passait à l’époque, alors que la Guerre Froide touchait à sa fin, était que les archives étaient en train d’être déclassifiées et que des gens dans le monde entier apprenaient qu’ils avaient été exposés à des radiations lors de la production ou des essais d’armes nucléaires. Les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni – les grandes puissances de l’ONU, qui sont également les grandes puissances nucléaires mondiales – se sont soudainement retrouvées confrontées à l’éventualité de devoir payer des milliards de dollars en dommages et intérêts pour avoir exposé des millions de personnes à leurs expérimentations atomiques. Ainsi, si l’on pouvait prétendre que Tchernobyl, le pire accident nucléaire de l’histoire de l’humanité, n’avait fait que 33 morts, c’était une façon de tuer dans l’œuf ces poursuites. C’est exactement ce qui s’est passé. Je pense que c’est pour cela que Tchernobyl est un scandale bien plus grand que qu’on ne le dit. Ce n’était pas seulement une opération d’occultation soviétique, mais bien une initiative internationale. Et c’est pourquoi c’est si important pour nous aujourd’hui de nous pencher encore sur cette catastrophe.
Ce qui est en jeu, c’est donc autant l’événement, la catastrophe de Tchernobyl après la fusion du cœur du réacteur 4, que le récit qui en est fait ?
Oui, un accident, c’est une narration, un récit qui a un début, un milieu et une fin. En voyageant dans la zone de Tchernobyl, j’ai découvert que les environs de la centrale présentaient déjà un taux élevé de radioactivité 10 ans avant même le début des travaux de construction. Mon hypothèse, c’est qu’elle provenait d’essais nucléaires – soit les Soviétiques ont testé de petites armes atomiques dans les marais, soit il s’agissait des retombées des activités nucléaires mondiales qui ont saturé l’environnement avant Tchernobyl. J’ai aussi constaté que les grands incendies de forêt de 2017 ont réactivé la radioactivité qui était jusqu’alors enfouie dans la litière de feuilles qui recouvre le sol, donnant ainsi naissance à un nouvel événement nucléaire. Ce que les Soviétiques ont essayé de faire, puis ce que les agences des Nations unies ont essayé de faire, c’était de clore définitivement le chapitre de Tchernobyl, et de faire comme si le vrai problème était de penser la prochaine catastrophe. Mais je pense qu’il est bien plus pertinent de considérer ces événements nucléaires comme des moment d’accélération sur une frise chronologique des expositions aux radiations, qui a commencé avec Trinity, le premier essai d’arme nucléaire par les États-Unis en juillet 1945, et qui se poursuit jusqu’à ce jour.
Vous dites que la zone d’exclusion autour de Tchernobyl est le meilleur endroit pour étudier les limites de la résistance humaine à l’Anthropocène. Qu’entendez-vous par là ?
J’ai choisi de nommer ce livre en anglais Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future : c’est un manuel de survie pour deux raisons. Tout d’abord, en référence aux archives soviétiques dans lesquelles se trouvent toutes sortes de manuels d’instructions pour gérer une situation très nouvelle dans l’histoire de l’humanité, à savoir : comment vivre dans un environnement radioactif ? Il existe un manuel pour les conditionneurs de viande (comment traiter la viande radioactive), un manuel pour les travailleurs de la laine, un manuel pour les agriculteurs, pour les transformateurs de produits alimentaires etc. L’autre raison est que, lorsque je réfléchissais à notre avenir dans l’Anthropocène, je me suis demandé : comment pouvons-nous parvenir à penser la survie aujourd’hui ? Comment acquérir les compétences nécessaires pour survivre dans un monde hautement contaminé ? J’ai remarqué que cette région située entre la Biélorussie et l’Ukraine a été l’épicentre de la plupart des grands conflits du XXe siècle. La guerre des tranchées s’est déroulée ici même pendant la première guerre mondiale – on peut encore trouver des crânes et des médailles des soldats et des fils barbelés enfouis dans la terre. Des guerres civiles ont été menées dans ces territoires – la guerre civile russe et la guerre soviétique polonaise. C’est la région où l’Holocauste a commencé, avant que les Allemands n’aient développé les processus industriels employés à Auschwitz, où les nazis ont exterminé toute la population juive lors de la « Shoah par balles ». Le massacre de Babi Yar et le camp de concentration de Syrets ne sont pas très loin de l’emplacement de la centrale.
Les Soviétiques ont ainsi décidé de faire de cette région meurtrie un symbole du progrès en implantant sur le site ce genre de programmes de développement d’après-guerre que nous connaissons si bien partout dans le monde. Ils ont asséché de grandes parties du marécage à des fins d’agriculture, où beaucoup de pesticides et d’engrais artificiels ont été utilisés. Une autre partie du marais asséché a été consacrée à la centrale de Tchernobyl – une technologie fantastique qui devait envoyer toutes sortes d’énergies électriques à des communautés qui n’en avaient pas encore ! Ce site a été un lieu de destruction et de guerre, mais aussi un lieu de désir et d’efforts, une sorte de refoulement de la destruction passée grâce aux progrès qui rendront le monde meilleur grâce à ces grands projets de développement modernistes.
Et c’est là que nous en arrivons à cette question de l’Anthropocène, parce que se pose aujourd’hui la question de la place de la technologie nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. C’est une énergie produite sans émission de CO2 qui peut apparaitre comme une solution, ou en tout cas une partie de la solution. Que répondez-vous à ceux qui considèrent le nucléaire comme la technologie la plus sûre pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Le réchauffement climatique est un aspect très important de l’Anthropocène, mais ce n’est qu’un élément parmi d’autres. Nous devons examiner l’ensemble des moyens qui nous permettent de maintenir un environnement sain. L’énergie nucléaire pourrait être une technologie formidable si nous savions quoi faire des déchets et si nous décidions, en tant que société humaine, d’abandonner les territoires après les accidents – et de ne pas continuer de telle façon que certaines personnes soient exposées et sacrifiées, tandis que d’autres vivent de cette énergie. De plus, je reste perplexe quant à son efficacité économique. Les réacteurs nucléaires sont très chers, et cette énergie est beaucoup plus chère que celle fournie par les éoliennes ou les panneaux solaires. Par ailleurs, nous devons disposer de sources d’énergie propres et sans carbone tout de suite. Aujourd’hui, la mise en place d’une centrale nucléaire aux États-Unis se prévoit sur 20 ans – en réalité, cela prend beaucoup plus de temps. En comparaison, vous pouvez installer des panneaux solaires sur le toit d’un bâtiment en une seule journée. Enfin, il existe aujourd’hui environ 400 réacteurs dans le monde. Si nous devions privilégier uniquement l’énergie nucléaire, il nous faudrait passer à un total de plus ou moins 2000. C’est loin d’être le cas. C’est pourquoi, en termes de temps, d’argent et d’énergie produite, se concentrer sur l’énergie nucléaire serait à mon avis faire fausse route.
Ce « manuel », cela signifie-t-il aussi que nous ne sommes pas prêts pour la prochaine catastrophe ? 10 ans après Fukushima, il semble que le même schéma de déni et de non-dit se répète…
Oui, je pense que c’est ce que Fukushima nous montre : nous n’avons tiré aucune leçon de Tchernobyl. Avant Fukushima, les ingénieurs et les météorologues avaient averti que le prochain tsunami d’importance serait plus grand que le mur qui avait été construit devant la centrale de Fukushima. TEPCO, l’entreprise gestionnaire de la centrale, a balayé ces conseils du revers de la main, et après la catastrophe la multinationale a mis deux mois pour admettre que trois réacteurs avaient fondu, pas trois jours, deux mois ! Exactement comme les Soviétiques, ils ont multiplié par 20 la dose minimale d’exposition aux radiations acceptable pour les civils, étant dans l’incapacité d’appliquer les réglementations sanitaires après la catastrophe. Ils ont testé les aliments et déclaré qu’ils pouvaient être consommés. Lorsque des cas de cancers de la thyroïde sont apparus chez les enfants, le gouvernement japonais a annoncé qu’il allait cesser de tester et de surveiller la thyroïde des enfants. Le même schéma se reproduit. L’argument facile, longtemps mobilisé, qui renvoyait Tchernobyl aux spécificités de la situation soviétique, au socialisme, ou même à la paresse supposée des slaves, tout cela ne tenait pas vraiment debout mais s’est définitivement écroulé quand le Japon, une démocratie qui étaient censé être si compétente sur le plan technique, a subi et géré un accident nucléaire de cette façon.
C’est pourquoi vous dites que l’énergie nucléaire a quelque chose de fondamentalement politique ?
Mon livre se termine par le sujet des essais nucléaires, car je ne pense pas que l’énergie nucléaire civile puisse être dissociée de l’histoire de la fabrication des armes nucléaires. La seule raison pour laquelle les Américains se sont d’abord intéressés à la promotion de l’énergie nucléaire, c’est parce qu’ils étaient accusés par les Soviétiques, pendant la guerre froide, de détenir l’atome, d’être la seule puissance à avoir lancé des armes nucléaires sur un autre pays. Le programme « Des Atomes pour la paix » d’Eisenhower en 1953 était une façon de résoudre ce problème : il s’agissait de distribuer des isotopes radioactifs et des réacteurs nucléaires à l’étranger, pour pouvoir mieux les promouvoir aux États-Unis. Cela a ouvert, bien sûr, la voie à la prolifération nucléaire. C’est ainsi que d’autres pays ont obtenu eux-mêmes des armes atomiques. Le réacteur de Tchernobyl produisait de l’électricité, mais il avait aussi la capacité de fabriquer une charge de plutonium pour les bombes nucléaires. La distinction faite traditionnellement entre nucléaire militaire et nucléaire civil ne tient pas à mon avis. Si vous comparez la quantité relative de radiations libérées par Tchernobyl avec les rejets durables des essais nucléaires qui circulent dans l’hémisphère Nord, ces derniers sont d’un ordre de grandeur supérieur. Ainsi, il faut comparer les 45 millions de curies d’iode radioactif de Tchernobyl avec les 20 milliards de curies d’iode radioactif provenant uniquement de deux années d’essais soviéto-américains dans les années 1960. Ces événements sont tous très liés.
La confiance dans la science est une question fondamentale aujourd’hui. Après ce que vous venez de dire, après avoir lu votre livre, pourquoi devrions-nous encore croire une science qui est si déterminée par la contingence et les circonstances politiques ? Ne craignez-vous pas de susciter plus de doutes que de confiance ?
Naomi Oreskes, que nous avons déjà citée, a récemment publié un livre intitulé Why Trust Science?. Elle y insiste sur le fait que la science est avant tout un processus, le produit de contestations permanentes : les scientifiques sont toujours en train de se battre entre eux, ils examinent le travail des autres, le remettent en question et, ce faisant, ils construisent étape par étape ce qui se rapproche le plus possible de la vérité à un moment donné. Ce processus nécessite une science indépendante, et non une science parrainée et contrôlée ou dictée par une industrie, une entreprise ou un État. Ce n’est absolument pas le cas de la science nucléaire, surtout lorsqu’il s’agit de radioprotection : la plupart des physiciens de santé employés dans le monde travaillent pour des industries nucléaires ou pour des gouvernements. En outre, les agences nucléaires financent elles-mêmes une grande partie de la science. Dans mon cas, mes recherches ne sont financées que par des sources ordinaires comme les Fondation Carnegie ou Guggenheim, qui soutiennent les chercheurs. Ce n’est pas le cas en général de mes détracteurs, qui sont généralement ce que j’appellerais des scientifiques de l’industrie. C’est fondamental lorsque nous traitons de ces sujets scientifiques controversés : suivre l’argent. Lorsque la recherche est vraiment indépendante, alors je pense que nous pouvons lui faire confiance.
