Judith Lou Lévy : « Des dérives menacent l’existence même du cinéma »
Alors que le milieu est secoué par les crises et connaît une période de mutation, des professionnels du secteur réunis en collectif appellent de leurs vœux à des états généraux du cinéma à l’occasion d’une journée de mobilisation le 6 octobre prochain à l’Institut du monde arabe. Le cinéma, à la fois art et industrie, a connu bien des soubresauts, et la crainte de sa disparition paraît intrinsèque à son histoire, tant sur un plan ontologique, lui qui par nature enregistre le vivant comme trace tout en témoignant de la mort au travail, qu’à un niveau objectif avec désormais le triomphe des plateformes, le tournant néolibéral de la culture, ou encore la fermeture des salles.
Pourtant, il serait naïf de croire que parce qu’il a survécu jusque-là le cinéma n’est pas véritablement en danger. Pour Judith Lou Lévy, partie prenante de ce collectif et productrice indépendante dont les films Atlantique de Mati Diop en 2019 et Le Genou d’Ahed de Nadav Lapid en 2021 ont été respectivement récompensés par le Grand Prix et le Prix du Jury au Festival de Cannes, la survie du cinéma tient à un sursaut de la part de gens qui le font et à l’engagement des pouvoirs publics censés le soutenir. Pourtant, les stratégies mises en place par ces derniers semblent aller dans une tout autre direction. Pour continuer à produire des œuvres puissantes et audacieuses et pour défendre une tradition historique qui est aussi une fierté nationale, une mobilisation et des choix politiques forts comme la France a pu le faire par le passé sont nécessaires. Tout comme les films permettent des résurrections à l’envi, il faut croire au renouveau du milieu du cinéma. Alors, sauve qui peut (la vie) ? YS.
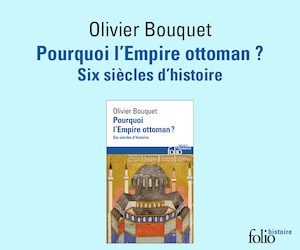
Quelles sont la genèse et les ambitions de cette interpellation des pouvoirs publics à travers l’appel à des états généraux du cinéma le 6 octobre prochain ?
Au départ, il y a la publication d’une tribune dans Le Monde au mois de mai dernier, à l’initiative d’un petit groupe qui n’était pas un col
