Joel Penney : « Le journalisme culturel poursuit une mission d’intérêt public »
«Guerres culturelles » : l’expression popularisée par James Davison Hunter dans les années 1990 n’a jamais véritablement trouvé d’étude empirique à la hauteur de son ambition théorique — expliquer comment les questions morales fracturent la société américaine. Il y a eu des portes ouvertes, des intuitions qui ont nourri la sociologie politique, la sociologie des pratiques, et, aujourd’hui, cette sociologie dite computationnelle, capable d’appliquer aux espaces numériques tout un tas de métriques. Avec Pop Culture, Politics, and the News, stimulant ouvrage fraîchement paru aux presses universitaires d’Oxford, Joel Penney, professeur associé à la School of Communication and Media de l’université d’État de Montclair, vient de proposer de quoi reformuler le problème pour peut-être un jour lever ce vieux lièvre.
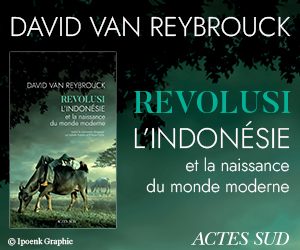
Adoptant une approche par les mondes de l’art que ne renierait pas Howard S. Becker, le livre restitue les dynamiques complexes qui traversent le journalisme culturel américain. Critiques, journalistes polyvalents, plumes à louer : les entretiens que Penney mène pointent la précarité grandissante d’une profession qui occupe aujourd’hui des interstices de plus en plus étriqués entre le journalisme politique, les marchés de la publicité et du marketing.
À l’approche interactionniste s’ajoute une élégante démonstration tissée de sociologie culturelle. Ainsi, les déséquilibres dans l’entertainment journalism s’expliquent-ils par les frontières symboliques derrière lesquelles campe un journalisme politique nanti de prestige ; ainsi, l’actualité culturelle et les cadrages empruntés pour la couvrir distinguent-ils très clairement le journalisme progressiste du journalisme conservateur ; ainsi, les « communautés interprétatives » se disputent-elles sur cette idée que tout art serait intrinsèquement politique.
Plus qu’un état des lieux de l’écosystème médiatique américain et de son volet le plus mal-aimé, Penney, par le prisme du journalisme culturel, déplie le problème de la polarisation de l’espace public — plutôt qu’une Amérique bipartisane, c’est mille Amériques qu’on trouve dans une seule : l’Amérique de Trump, l’Amérique de Disney, celle de Clint Eastwood, de Hunter S. Thompson, de Saturday Night Live… BT
Votre livre étudie les journalistes culturels, les critiques, tout un petit monde qui écrit sur la culture américaine, et notamment le cinéma, ses célébrités, son faste… Quelles sont les grandes caractéristiques sociales de ce groupe relativement disparate, et quelle est son histoire ?
Mon étude ne s’étend pas vraiment au-delà du périmètre du journalisme culturel américain, même si son influence déborde sur le monde entier. Ce journalisme doit beaucoup à l’essor des industries des médias de masse au début du XXe siècle : il y eut du journalisme culturel dès qu’il y eut une culture de masse. L’histoire que je trace remonte donc à l’ère du cinéma muet, qui produisait des films extrêmement populaires, discutés et débattus dans la presse auparavant. Néanmoins, je me concentre spécifiquement sur l’engagement politique des journalistes culturels, qui s’est comme affermi au cours du XXe siècle. Même si le journalisme culturel vit depuis que la culture de masse existe, la politisation de ce journalisme est concomitante de la montée en puissance de la contre-culture des années 1960, de l’irruption de nouveaux discours progressistes sur l’ethnicité, l’orientation sexuelle, l’identité de genre.
Les travaux bien connus de Ronald Inglehart, que vous mentionnez, montrent comment progressivement, dans la seconde moitié du XXe siècle, on se définit dans les sociétés occidentales de moins en moins par la classe sociale à laquelle on appartient, et de plus en plus par rapport à des échelles de valeurs ou par rapport à des repères identitaires et culturels précis.
En réalité, ce changement politique, qui aboutit à une certaine fusion des identités politiques et culturelles, couve depuis longtemps aux États-Unis comme ailleurs. La seconde vague du féminisme, celle qui politise l’intimité et le domaine privé, de même que les mouvements pour reconnaître leurs droits aux homosexuels fraient la voie aux revendications identitaires et culturelles. Plus la politique questionne les formes culturelles d’identification, plus les divertissements, les films, les émissions de télévision, emboîtent le pas et s’emparent de ces questions.
Plus précisément, il existe évidemment des politiques identitaires avant les années 1960 – la politique raciale a été très chaudement couverte, largement débattue et discutée au début du siècle. Mon livre discute par exemple de la couverture médiatique de The Birth of a Nation, le film muet de D. W. Griffith qui était, en 1915, le premier long métrage majeur. Le film provoque une sorte de réaction massive dans la presse afro-américaine, qui était une institution plutôt bien établie à ce moment-là. Des articles paraissent, plaidant pour bloquer la diffusion d’un film dressant un portrait élogieux du Ku Klux Klan, et promouvant une idéologie raciste. Les journaux blancs de l’époque défendent le film, certains regrettant même qu’il fût si charitable envers la communauté afro-américaine !
Ce qui se joue dans l’histoire que je raconte, ce n’est donc pas l’apparition dans la seconde moitié du XXe siècle d’une forme partisane de journalisme culturel, mais plutôt de la lente gestation d’une conscience politique, au nom de laquelle la critique de matériaux culturels se fait progressivement. Il y a des périodes où l’actualité politique se saisit de l’industrie du divertissement, pensez au maccarthysme par exemple et à la purge contre les communistes supposés d’Hollywood, mais là n’est pas la question principale. Ce qui compte davantage pour moi, c’est cette conscience politique qui devient de plus en plus prégnante, en dehors des points chauds d’actualité, et qui se coule dans le journalisme culturel de sorte que les articles associés abordent de plus en plus de questions politiques, ou que la couverture de l’actualité des célébrités mime celle du personnel politique. On doit souligner la standardisation progressive de cette forme hybride.
Un autre moment clé dans l’histoire que vous racontez se situe dans le dernier quart du XXe siècle où l’épidémie de SIDA se formule de plus en plus comme un problème public. Comment ce syndrome sévissant beaucoup dans les milieux artistiques a-t-il contribué à la politisation du journalisme culturel ?
Certains de mes enquêtés ont connu les années noires, entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, où la crise du sida marquait son apogée. J’ai retrouvé dans nos conversations des éléments assez connus, notamment le rôle joué par le décès de l’acteur Rock Hudson, qui suscite, peut-être pour la première fois dans l’Histoire, une couverture bienveillante des minorités sexuelles dans les médias. La presse, sinon à agiter des paniques morales, ne se préoccupait pas des minorités gays. Les journalistes qui couvraient le monde du divertissement, un monde frappé de plein fouet par le SIDA et beaucoup plus que d’autres secteurs, connaissaient des malades – pas uniquement Rock Hudson, mais beaucoup d’autres – de sorte que l’engagement prit un caractère d’évidence : parler du SIDA devenait newsworthy, les médias s’intéressaient à la brutalité de l’administration Reagan dans la prise en charge des malades. Le journalisme culturel pouvait aussi entreprendre un plaidoyer, il n’avait plus seulement à délivrer ses chroniques, à raconter les bruits de couloirs de Hollywood mais pouvait tout autant prendre position sur des questions touchant à la santé publique.
Le livre relate une anecdote éclairante à ce sujet : dans les années 1990, tout journaliste qui se fendait d’un article lié à la communauté gay, annonçant le coming-out d’une célébrité par exemple, allait immédiatement au-devant d’une affluence de courriers et de tribunes adressés au journal. On trouvait clairement deux types de lettres : celles qui approuvaient totalement ces articles, faisaient valoir leur caractère d’utilité publique, et celles qui condamnaient en bloc l’arrivée de ces questions dans les lignes éditoriales. Face à l’homophobie décomplexée, et à une époque où le statut public qu’il fallait donner aux minorités nourrissait encore de grandes controverses, les newsrooms, les conférences de rédaction, Hollywood et l’industrie du divertissement touchaient l’épicentre de la question gay, dans ses aspects sociaux, politiques et sanitaires.
Vous commencez votre ouvrage en expliquant que le journalisme culturel est demeuré longtemps le parent pauvre de la sociologie des médias. Comment peut-on expliquer que les sociologues et les sciences sociales en général se soient relativement peu intéressés à cet objet d’étude ?
Les cultural studies ou les journalism studies travaillent sur le journalisme culturel depuis bien plus longtemps que la sociologie ou les sciences politiques, elles ne rejettent pas cet objet d’étude du côté des sujets moins légitimes, moins heuristiques ou moins dignes d’intérêt. Cette hiérarchie qui a longtemps prévalu entre les formes journalistiques et l’intérêt différencié qu’il y aurait à les étudier doit à un écart de prestige entre deux formes de politiques : la grande politique, celle des concepts, et la petite politique spectacle du monde de la culture. Généralement, la fonction des médias dans l’espace public est rapportée à l’acception la plus noble de la politique : les médias suivent l’élaboration de la politique par les gouvernants. Bien sûr que ceci doit s’étudier et retenir l’attention des principaux domaines des sciences sociales, mais une telle restriction de la politique aux affaires publiques s’interdit une dimension d’étude.
Cette idée que les médias forment un quatrième pouvoir détourne les sciences sociales du journalisme culturel, qui privilégient l’analyse des médias à travers leur implication dans le champ politique. À l’encontre de cette idée, mon livre soutient que le journalisme culturel doit être compris comme poursuivant aussi une mission d’intérêt public, comme c’est normalement le cas des médias dans leur ensemble ; et à certains égards, cette compréhension a déjà percolé dans les industries culturelles elles-mêmes. Dans les écoles de journalisme sévit une vision complètement surannée des news, qui les circonscrit à la couverture des affaires publiques. Les journaux panachent leurs éditions d’articles lifestyle pour se maintenir à flot ou honorer leurs obligations éditoriales. Ce ne sont pas que des raisons fallacieuses : le journalisme lifestyle poursuit aussi largement des objectifs commerciaux, il symbolise le mercantilisme qui grève les médias.
En Europe, il me semble qu’il existe beaucoup de bonnes recherches sur le journalisme culturel dans les pays nordiques par exemple, en Suède ou en Norvège, où la culture a partie liée avec des structures de financement publiques. Cela favorise un autre regard sur l’art, entendu d’emblée comme un bien public, un certain domaine d’exercice du politique, qui n’a pas tout à fait d’équivalent aux États-Unis, où des logiques commerciales traversent le monde du divertissement de part en part. Ces frontières symboliques puissantes maintiennent ainsi les sciences sociales loin du divertissement commercial, qui passe pour une sorte de force corruptrice dans les médias, qui menace la mission sérieuse du journalisme politique. Ce point de vue me semble en tout cas particulièrement prononcé aux États-Unis, où le segment du secteur culturel à but non lucratif se trouve réduit à la portion congrue.
Vous empruntez un concept à cheval entre la sociologie culturelle et l’interactionnisme, celui de « communauté interprétative », pour expliquer comment, chez les journalistes culturels de gauche, l’idée partagée que tout est politique permet de créer du collectif, tandis qu’à droite, l’idée inverse prévaut. Comment ces questionnements sur la nature intrinsèquement politique du divertissement contribuent-ils à organiser le monde du journalisme culturel ?
Les journalistes de droite et de gauche forment des communautés interprétatives, dans des termes qui diffèrent, voire qui s’opposent franchement. Chacun des deux camps développe un ensemble de compréhensions, d’hypothèses, quant au rôle que joue l’art dans la société. Il me semble que la meilleure façon de comprendre le processus par lequel les journalistes forment des communautés interprétatives – et d’aller vers une sociologie compréhensive des journalistes en tant que type particulier de communauté d’interprétation – consiste à examiner leur travail de tous les jours, ce sur quoi mes entretiens insistent. Tous ces journalistes n’ont pas forcément suivi un cursus d’études culturelles où il serait question de Stuart Hall ou d’Antonio Gramsci, mais les théories se trouvent mises en pratique, au-delà des concepts, dans les comportements des journalistes, dans leurs débats quotidiens sur les images, les façons de représenter – les politics of representations.
Gramsci, ce continuateur de Marx qui considère la superstructure dans ses propres effets de pouvoir, au-delà de l’infrastructure, identifie dans les contenus culturels une forme actualisée de l’idéologie dominante, ce qui sert aussi à justifier le caractère subversif de la culture contre-hégémonique. Ces points innervent les journalistes ; ceux qui n’y ont pas été exposé directement l’y ont été indirectement, par l’intermédiaire de professeurs, de collègues ou de militants qui ont lu Hall et Gramsci. J’ai trouvé un intérêt fort à conduire mon étude au moment où j’ai compris combien ce genre de critique idéologique des médias de divertissement ou de la représentation politique, des traditions qui m’étaient familières en tant qu’universitaire, teintait aussi les discours dans la presse culturelle, au sens où les arguments, les idées que vous pourriez trouver dans des cours d’études supérieures en études culturelles innervaient aujourd’hui d’autres espaces périphériques, et les espaces de presse y compris.
Je ne parle pas seulement de la presse de gauche : à droite, vous trouverez également des journalistes pour s’en prendre au « marxisme culturel ». Andrew Breitbart, cette figure séminale de l’alt-right contemporaine, a lu Herbert Marcuse et a écrit à son sujet : celui-ci devient une espèce d’émissaire européen, dont les textes corrompent l’Amérique en sublimant les revendications identitaires en une propagande marxiste. La circulation des références, et leurs déformations éventuelles dans le passage d’une arène à l’autre présente beaucoup d’intérêt pour la recherche.
L’extrême droite se positionne dans le champ médiatique en réaction à l’hégémonie culturelle qu’exerceraient les idéaux progressistes plébiscités à Hollywood. Comment les journalistes, blogueurs ou militants d’extrême droite, en se faisant passer pour des résistants à la doxa, construisent-ils ces communautés qui se targuent de représenter la seule subversion véritable ?
La rhétorique dominante à droite aujourd’hui s’en prend à l’hégémonie qu’exerceraient les élites hollywoodiennes, avant-garde des combats du parti démocrate, contre lesquels la droite s’inscrit en faux. Les années 1960 et 1970 marquent l’irruption brutale dans le champ politique de ces politiques identitaires progressistes, que les années 1990 viennent consacrer : pour le grand public, ces idées atteignent un statut hégémonique à cette période ; « politiquement correct » devient dès lors une sorte d’anathème et les débats font rage autour des dangers du multiculturalisme, cette antienne que le « wokisme » ou la cancel culture ne viennent que répéter aujourd’hui. Rappelez-vous comment, il y a quelques mois, l’annonce du choix d’une actrice noire pour jouer La Petite Sirène a soulevé une bronca… Dans les années 1990, Disney avait choisi une actrice noire pour une adaptation télévisée de Cendrillon, déclenchant l’ire de la même droite conservatrice, des commentateurs de la National Review qui trouvaient déjà Hollywood engoncé dans le politiquement correct. Hollywood a progressivement souscrit à cet esprit si propre aux années 1960, entendant les critiques que les études culturelles avaient formulées dans les années 1970, et les prenant définitivement au sérieux à la toute fin du siècle.
C’était l’époque d’Autant en emporte le vent ?
Oui, et même après. Dans les années 1950, le monde d’Hollywood penchait vraiment à droite, le code de production cinématographique à l’époque proscrivait toute aventure sur des terrains controversés. Au plan culturel, le cinéma demeurait très sensible à l’influence des groupes religieux et, de facto, extraordinairement conservateur quant aux questions culturelles. Cela remet en perspective le discours de cette extrême droite actuelle, qui n’est pas purement rhétorique, qui répond à un changement dans l’ordre des valeurs qui prévalent dans les industries culturelles depuis plusieurs décennies, un changement qui s’est approfondi au cours des dix dernières années, dès lors qu’Hollywood s’est senti solidaire des mouvement MeToo et Black Lives Matter. L’émoi que suscita la mort de George Floyd conduisit les dirigeants d’Hollywood à des déclarations publiques, où il était question de la représentation des Afro-Américains dans le cinéma, de réduire la stigmatisation, de réfléchir à la différence. Et je pense que beaucoup de ces revirements doivent aux pressions des critiques et des journalistes culturels, à leur effort pour pointer ce qui ne pouvait pas se faire. Les producteurs, maintenant, se doutent bien d’avance ce qu’ils encourent, les critiques auxquelles ils prêtent le flanc si, par exemple, ils font de Scarlett Johansson un personnage d’origine asiatique, ce qui avait fait débat à l’époque de l’adaptation de Ghost in the Shell. Bien sûr, les producteurs savent que la transgression de certaines normes peut coûter beaucoup à leur film, à sa rentabilité. Mais ce cynisme n’explique pas tout : les producteurs souscrivent désormais à ces valeurs.
Vous apportez quelques nuances toutefois, en montrant que toute la droite américaine ne nourrit pas forcément une détestation des idéaux progressistes, et qu’un mince terrain de débat demeure imaginable. Ceci surprend d’autant plus qu’on parle d’un espace public américain de plus en plus polarisé.
Il ne faut pas trop insister non plus. Certes, il existe un dialogue possible, qui procède d’un certain esprit démocratique, qui vise à restaurer la bonne santé de l’espace public, sur des sujets qui méritent effectivement le débat entre la gauche et la droite : quelles lignes de démarcation distinguent les arts, le divertissement, la politique ? Est-ce qu’on ne risque pas de perdre le contrôle sur la cancel culture ? Ces questions pleinement légitimes délimitent un front possible entre la gauche et la droite, et rendent possibles la discussion, notamment sur les représentations des minorités, un sujet dont se saisissent également les journalistes conservateurs, se piquant parfois de certains rappels : si la diversité compte autant que l’entend le camp progressiste, alors pourquoi ne pas davantage représenter certains groupes religieux dans les fictions américaines ? Et quid des zones américaines rurales, relativement invisibles dans le cinéma américain d’aujourd’hui ?
Néanmoins, l’alerte que je sonne dans le livre touche aux modèles commerciaux sur lesquels repose l’écosystème médiatique américain, un modèle qui segmente les publics, qui écarte les débats transversaux, qui polarise l’espace public notamment en radicalisant les positions tenues par les droites : la droite modérée semble disparaître aux États-Unis. Je n’ai pas beaucoup d’espoir de voir émerger un nouveau discours de centre droit capable de se positionner sur les questions évoquées ci-dessus, capable d’entretenir le débat dans le respect commun de certaines valeurs fondamentales et de l’adversaire. Au contraire, la position qui tend à devenir majoritaire à droite sur le front culturel fait passer Hollywood pour une gigantesque entreprise de pédopornographie, responsable de l’assassinat de nouveau-nés – et ce récit n’est pas limité aux sites conspirationnistes de la périphérie de l’espace public américain : il domine les médias d’information de droite aujourd’hui. Disney s’est trouvé visé par une panique morale tout récemment, par un tombereau de commentaires, de soupçons, qui propageaient la rumeur selon laquelle le studio inclut des personnages gays et lesbiens dans ses dessins animés pour sexualiser les enfants, de sorte qu’il soit plus simple ensuite pour des démocrates malveillants de les agresser, de les molester… Voilà le discours qui domine à droite actuellement.
Du côté du business model et du fonctionnement économique de la presse, qui a considérablement changé depuis la numérisation des médias, vous soulignez le paradoxe propre aux contenus culturels : même les contenus de piètre qualité génèrent en moyenne davantage de clics que beaucoup d’autres articles, un aspect que surveillent les médias pour toucher des revenus publicitaires. Pourtant, le secteur du journalisme culturel traverse une grave crise, marquée par des licenciements en grand nombre. Comment expliquer ce paradoxe et comment le mode de financement de la plupart des médias américains désorganise-t-il le secteur du journalisme culturel ?
On en revient à cette hiérarchie symbolique entre les genres et les formats. Dans les cercles académiques en études journalistique et dans l’esprit des managers du secteur de l’information, il existe cet axiome de base que les affaires publiques sont le cœur du métier de journaliste et que la couverture de l’actualité culturelle occupe une part résiduelle, qu’elle permet surtout de vendre du contenu. Si les médias forment un quatrième pouvoir, c’est aussi parce qu’ils assument la responsabilité d’une certaine curation de l’espace public. Le journalisme culturel, dans ce contexte, a une valeur gadget, c’est une bonne chose d’en faire pour le résultat net des entreprises de presse mais elles ne comptent pas dessus pour gagner un prix Pulitzer.
L’autre versant, c’est que les contenus culturels génèrent du clic à bas prix : il suffit d’un article pour parler de la représentation des sexes ou de l’ethnicité dans le dernier épisode de Game of Thrones pour focaliser l’attention du public. Pour écrire un tel article, les entreprises de presse peuvent compter sur un vivier très fourni de journalistes freelance, de pigistes occasionnels qui occupent un autre emploi, et qui, pour une rémunération vraiment minime, peuvent écrire sur la pop culture. Pas besoin d’approfondir le texte, puisqu’un article, même superficiel et écrit sur le vif, remplira parfaitement les attentes de l’entreprise : générer des clics. Dans la situation d’étranglement financier qui touche le secteur des médias, quelles sont les priorités ? Les licenciements ne touchent pas prioritairement les journalistes politiques qui couvrent Washington, surtout au moment où la démocratie semble en péril. Alors on sacrifie les critiques et le journalisme culturel ; la rédaction de ces contenus s’externalise ou est prise en charge par des journalistes polyvalents.
Et il y a le risque d’un mélange des formats, ou d’une couverture trop « pop » de l’actualité. Notamment, vous pointez du doigt la possibilité qu’il devienne de plus en plus difficile aux jeunes lecteurs de bien faire la différence entre le sérieux et le frivole dans l’engagement politique, pouvant conduire à une distanciation des sujets politiques vis-à-vis des questions qui comptent vraiment. Un des moyens pour se prémunir contre ce risque serait de professionnaliser à nouveau le métier de critique, de le revaloriser symboliquement, pour mieux marquer les différents registres dans les formats médiatiques
Bien sûr que la culture pop, l’actualité culturelle est justiciable d’un traitement politique, et bien sûr qu’elle soulève des questions structurelles. Les longs articles dans The Atlantic au sujet de J. K. Rowling ont étudié avec finesse ce que pouvait être la transphobie, par exemple. Pour les jeunes lecteurs, il paraît indéniable que le journalisme culturel de qualité peut entretenir des ponts avec la politique et avec des questionnements sociaux pour, quelque part, amener un public nouveau à s’intéresser à la politique. Le procès de Johnny Depp, très récemment, a donné lieu à pléthore d’articles pièges à clics, à des titres racoleurs qui dévoilaient des textes sans aucun contenu, sans profondeur, qui capitalisaient sur la notoriété de l’acteur pour attirer une audience. Inversement, il y a eu des plumes capables d’analyser ce que la saga disait du traitement potentiellement injuste des femmes dans le système judiciaire, mais ces articles restaient marginaux.
Tout repose sur l’expertise des journalistes culturels, d’autant plus rare que l’expression publique et la critique se sont démocratisés, sur des sites comme Rotten Tomatoes, par exemple, qui encouragent tout un chacun à publier son avis. Sans vouloir paraître snob, il faut réaffirmer que l’analyse culturelle, la critique requiert de l’exercice et une expertise : certains journalistes passent des années à développer leur compréhension de ce qui se passe dans les coulisses de Hollywood et comment cela se branche sur un discours sociopolitique plus substantiel.
NDLR : Joel Penney a publié Pop Culture, Politics, and the News (Oxford University Press) en septembre 2022.
