Julien Gosselin : « Dans mes spectacles, à la fin, il ne reste que la littérature »
Le théâtre de Julien Gosselin est tout sauf littéraire. Et pourtant il doit tant à la littérature. C’est précisément ce qui fait la force, et la singularité dans le paysage contemporain du spectacle vivant de ce jeune metteur en scène qui fut d’emblée impressionnant – et le demeure. À reparcourir la liste des auteurs qu’il a choisi d’adapter à la scène, de Houellebecq à Bernhard en passant par DeLillo et Bolaño, on devient très curieux de sa ou de ses bibliothèque(s). De là l’envie évidente de lui proposer de participer à notre grand jeu littéraire, celui qui consiste à demander à une personne de choisir les dix livres qu’elle emporterait sur une île déserte. Et de venir nous dire pourquoi en public, à la Fondation Ricard. SB
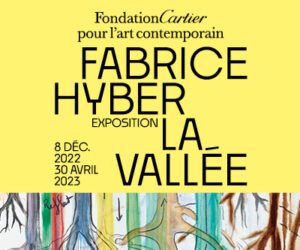
La plupart de tes spectacles, si ce n’est tous, entretiennent un lien très étroit à la littérature, et plus spécifiquement encore au roman. Peut-on dire que tes mises en scènes sont d’abord et avant tout des lectures ?
Je ne sais pas comment les autres metteurs en scène se débrouillent mais lorsque je lis et qu’un auteur me touche, j’ai envie que les gens entendent la manière dont il s’inscrit dans mon cerveau au moment même de la lecture. Un livre ne vient jamais seul, il n’existe pas par lui-même, il existe parce qu’on le lit à un moment de sa vie, il existe parce qu’on le lit dans une certaine lumière, à une certaine heure de la journée. D’ailleurs, il arrive qu’on essaye dix fois d’entrer dans un livre sans y parvenir et qu’à un moment cela devient possible. C’est cela que j’aimerais que les spectateurs ressentent. Cela peut paraître un peu narcissique. Mais c’est un geste pur et, d’une certaine manière, une forme de disparition à travers le don de la littérature qu’opèrent ainsi les acteurs. Il me semble que, pour faire exister ce geste de l’auteur vers le spectateur, le théâtre a besoin d’adjuvants. Par exemple de la musique. Il se trouve que j’écoute de la musique quasi exclusivement en lisant. L’adjonction de musique dan
