Yan Chernyak : « La société russe semble désormais inexistante en tant qu’entité »
À l’heure où la question de savoir ce que pensent les Russes de l’invasion de l’Ukraine reste une énigme, voici un regard à la fois distancié et de l’intérieur : celui d’un intellectuel, qui a passé trente ans à Moscou avant d’émigrer en France pour raisons politiques et de renoncer à sa citoyenneté russe. Dès l’été 2022, en marge d’un projet de collecte d’entretiens que nous menons pour comprendre la perception de la guerre et de la montée de l’autoritarisme en Russie – « RUS-OP 2022 : les citoyens russes face à la guerre en Ukraine » –, Yan Chernyak nous a livré son analyse de ce qui se passe non pas au niveau étatique et diplomatique, mais à un niveau infra, au sein même de la société russe, au-delà des stéréotypes et des spéculations qui continuent d’être véhiculés, à défaut d’enquêtes actualisées et approfondies. En partant de sa propre expérience et des bouleversements identitaires induits par l’invasion de l’Ukraine, il donne des éléments de réponse aux grandes questions que l’on se pose sur le vécu du régime poutinien et de la guerre par les Russes ordinaires : dans quelle mesure soutiennent-ils la politique de leur gouvernement ? À quel point sont-ils réceptifs à la propagande ? Est-il pertinent de parler de retour aux pratiques soviétiques ? Quelles perspectives se dessinent pour la Russie et l’attitude de la population ? Yan Chernyak nous donne son point de vue pour décrypter les mécanismes de pensée qui traversent une société que l’on peine encore à cerner.
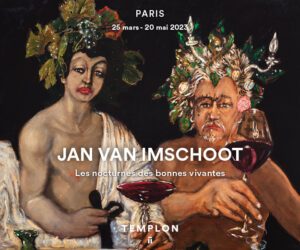
Yan Chernyak est un intellectuel né en URSS en 1973, d’une mère originaire du Donbass et d’un père moscovite. L’arrivée au pouvoir de Poutine et la ferme volonté de ne pas élever ses deux enfants dans le climat de violence généralisée qu’il ressent lui font passer le cap de l’émigration : sa famille quitte la Russie en 2004 pour s’installer à Paris. Tout en restant attaché à la culture russe, il s’efforce de s’intégrer dans son pays d’accueil et finit par obtenir la nation
