Magdi Masaraa : « Au Soudan, je suis inquiet que la situation prenne la tournure d’un génocide tel qu’au Rwanda »
Magdi Masaraa est un militant, artiste et activiste politique, ancien lauréat du programme pour les jeunes réfugiés de Sciences Po Paris. Il est né dans un village paisible du Darfour au Soudan, entouré par les membres de sa communauté. En 2003, son village est attaqué par les Janjawids, une milice soutenue par l’État soudanais. Il décide de fuir et entreprend alors un exil de plusieurs années jusqu’à son arrivée en France. ES
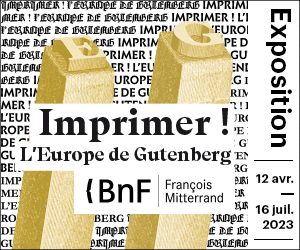
Tu viens de la région de Darfour-Occidental, dans les environs de la ville d’El-Geneina, où des affrontements violents ont de nouveau éclaté. Quelle est la situation actuelle ?
Il y a quelques jours, alors qu’un cessez-le-feu avait été déclaré, les hostilités ont repris en moins d’une heure. Ce qui me dérange, c’est que les lumières sont braquées sur les combats à Khartoum, la capitale, alors que le Darfour connait actuellement des affrontements jours et nuits. En ce moment même, il y a des attaques dans plusieurs grandes villes du Darfour dont à El-Fashir au Nord et El-Geneina à l’Ouest. Demain je suis certain que les exactions s’étendront aux villes voisines. La situation s’aggrave donc de jour en jour et pour l’instant aucune aide humanitaire n’a pu se rendre sur place.
La guerre au Darfour a changé ta vie de manière dramatique et pour toujours. Tu as été obligé de quitter ton pays à l’âge de 13 ans et tu as grandi dans plusieurs camps de réfugié.es avant d’arriver en France en 2016. Quel regard portes-tu aujourd’hui sur l’éclatement du conflit au Darfour ?
Je ne pense pas que l’on puisse utiliser le terme de guerre civile pour qualifier le conflit actuel au Soudan. Il s’agit plutôt d’une lutte pour le pouvoir entre deux hommes : « le chef d’État de facto Abdel Fattah Al-Bourhane, à la tête de l’armée régulière (les Forces armées soudanaises, FAS) et son numéro 2, le général “Hemetti”, chef d’une importante milice paramilitaire, les Janjawids rebaptisée les Forces de soutien rapide, FSR », selon l’analyse d’Amnesty International. Ces deux généraux agissent donc au nom d’intérêts qui leur sont propres, sans se soucier des conséquences sur les civils.
Depuis le 15 avril dernier, Khartoum et plusieurs autres villes du pays ont de nouveau été le théâtre de combats et d’exactions à l’encontre de la population civile, prise au piège entre ces deux factions qui se disputent le contrôle du pays. Mais il faut bien comprendre que cette escalade du conflit est la conséquence directe de la guerre qui a éclaté au Darfour en 2003, ayant fait 300 000 morts et 2 millions de personnes jetées sur les routes de l’exil. À cette époque déjà, les Janjawids, avec le soutien de l’armée régulière, ont commis les pires atrocités à l’encontre des populations non-arabes, des ethnies minoritaires dont je faisais partie. Les mêmes violences perdurent : bombardement des centres-villes, destruction des hôpitaux et des infrastructures locales, enlèvements, viols, pillages, etc. La situation devient incontrôlable et je suis inquiet qu’elle prenne la tournure d’un génocide tel que le Rwanda l’a connu en 1994.
Même si au début tu avais l’espoir de revenir dans ton village natal, c’est en voyant le conflit persister que tu a été obligé de fuir. Cet éloignement n’était pas seulement géographique car tu t’es aussi éloigné de tes rêves et de tes aspirations d’enfant. En effet, au Soudan tu voulais être médecin, pourtant lorsque tu arrives en France c’est à Sciences Po Paris que tu souhaites t’inscrire.
Dès que j’ai eu toutes les autorisations pour m’inscrire à l’école en France, j’ai choisi d’intégrer Sciences Po Paris, dans le cadre du certificat professionnel en sciences humaines et sociales pour jeunes réfugiés. C’était la première école officielle de ma vie et y entrer était particulièrement difficile car j’ai fait trois tentatives avant d’être accepté ! Le fait d’être constamment en déplacement sur la route de l’exil empêchait toute forme de scolarisation stable et classique telle que l’on pourrait l’entendre en France, mais ces camps ont été à bien des égards mes écoles. J’ai vécu dans le camp de Krinding au Darfour Ouest, le camp de Al-Salam, entre autres, au Darfour du Sud puis dans le camp de Kakuma au Kenya avant d’arriver dans celui de Farchana au Tchad et Saloume en Égypte. À treize ans, mon rêve d’être scolarisé et de devenir médecin a été bouleversé. La guerre m’a volé cette possibilité en m’éloignant de l’éducation, de la tendresse de mes parents, de la joie de mon enfance, de mes ami.es. Elle m’a imposé l’identité de « réfugié » que je porte encore aujourd’hui. Cette identité, construite de toutes pièces par les discours politico-médiatiques occidentaux, nourrit une certaine image de victimisation des personnes déplacées. Or, c’est méconnaitre le courage dont ont iels ont fait preuve pour traverser toutes ces épreuves. Les migrant.es doivent être perçu.es comme des héros et héroïnes, des résistant.es du quotidien !
Tu écris de la poésie dans ta langue maternelle, le massalit. Cette langue n’avait pas encore d’écriture jusqu’à tout récemment et toi tu as été témoin du passage de l’oralité à l’écriture. Pourrais-tu nous en parler ?
J’ai appris l’écriture du massalit au Caire, en Égypte, avec un membre du conseil académique de la langue massalit. Cette rencontre a été une véritable source d’inspiration et le point de départ de l’écriture de poésies dans ma langue maternelle et avec le concours des chanteur.ses de ma communauté. Les Massalits sont une ethnie africaine, non-arabe, basé.es historiquement dans la ville d’El-Geneina au Darfour ouest occidental. Plus de quatre millions de personnes parlent aujourd’hui le massalit dont le nom scientifique est Masarak Kana et sont réparties entre le Tchad et l’Ouest du Soudan. En 1991, la création de l’alphabet massalit a été permise à partir de la pratique orale de la langue mais celle-ci n’a pu être enseignée à l’école. En effet, dans le cadre de la campagne d’arabisation du Soudan par Omar Al-Bashir, et notamment du Darfour, l’apprentissage des langues parlées par les minorités africaines non-arabes étaient toutes interdites à l’école. L’écriture a ainsi démarré dans les camps de réfugié.es au Tchad en 2006 soit trois ans après le début du conflit, dans la diaspora soudanaise alors présente sur place.
Pourrais-tu nous en dire plus sur cette académie?
L’académie de la langue massalit, qui se trouve au Tchad, rassemble plusieurs intellectuel.les de notre communauté. Iels s’appliquent à constituer l’alphabet de la langue, à produire des études historiques, mathématiques, linguistiques et culturelles du massalit. Iels recensent aussi les prénoms qui sont couramment utilisés dans ma langue maternelle. Je ne fais pas directement partie de ce consortium d’intellectuel.les mais je suis leurs travaux à distance pour servir ensuite de médiateur auprès de la communauté massalit ici en France.
On s’est rencontré.es grâce à l’art en 2019, parce qu’à l’époque j’effectuais des recherches curatoriales en Île-de-France pour une exposition. C’est sur invitation de l’association Portes ouvertes sur l’art que j’ai pensé l’exposition From Flood to Flight ; Myths, Songs, and Other Stories qui rassemblait des artistes déjà établi.es, et des artistes exilé.es en France, pour certain.es autodidactes. Je ne voulais absolument pas séparer des artistes en fonction de leur statut social ou juridique donc j’ai procédé comme je l’ai toujours fait, à des recherches et des entretiens classiques avec les artistes pour concevoir ce projet. Je me souviens avoir eu ton contact par le biais de l’association Dessins sans papiers, un collectif qui organise des ateliers dessins dans les centres d’hébergement pour les personnes exilées. J’ai immédiatement été enchanté et impressionné par tes paysages symbolisés et les cartographies subjectives de ta région.
Mes dessins témoignent des souvenirs de ma vie avant la guerre. Au Soudan, il y a plus de cinq-cents ethnies avec des langues et cultures très variées. Dans mon village nous étions trois ethnies : les Massalits, les Dajo et les Borgo. Nous partagions notre vie et les évènements festifs comme les mariages. Il n’y avait pas de distinction entre nous et nos relations étaient marquées par un grand respect.
Cependant, mes dessins narrent aussi ce moment de basculement, lorsque mon village a été attaqué. Ce sont également des souvenirs du traumatisme laissé par les tortures, des massacres sur des personnes innocentes, des enfants, des personnes âgées…
J’étais d’ailleurs très étonné quand tu m’as choisi pour ton exposition. Je n’ai jamais appris à dessiner, je suis complètement autodidacte. Lorsque j’ai vu les autres artistes comme Katia Kameli, Abdul Saboor, ou Kubra Khademi j’étais très impressionné et je me suis senti assez intimidé. Pourquoi as-tu décidé de m’inclure dans cette exposition ?
Quand tu dessines les chemins, les villages, les montagnes ou les rivières de ton enfance, tes œuvres portent en elles un double langage, entre une carte et un paysage. J’ai compris que tu ne dessinais pas seulement ce que tu avais vu, mais que c’était plus une position de ton corps par rapport à d’autres corps, ceux des êtres humains, des animaux et par rapport à la nature qui t’entoure. Ce regard qui pénètre directement à l’intérieur de la montagne façonne une perspective inédite, un mélange entre une vue en plongée, le point de vue d’un cartographe et une ouverture sur l’invisible, pour révéler la splendeur des minéraux qui y sont cachés. J’ai également ressenti, avec le choix des couleurs si puissantes, ton attachement à la nature et à la terre. À vrai dire, je trouve cela extraordinaire que ces dessins soient le fruit de tes souvenirs, de ta mémoire vive. Cette mémoire t’a permis, dans tes œuvres, de reconstituer les éléments essentiels de ta culture et de son identité fragilisée par les années de la violence. Après toutes ces années, sais-tu ce qu’il est advenu de ton village ? Es-tu en contact avec leurs habitant.es ?
Mon village n’est plus. Tout ce qui faisait mon village a été réduit en cendres. Les arbres et les maisons ont été brulé.es, et même les animaux ont été tués. La population qui s’est installée après nous est celle qui nous a massacrée et qui nous a obligé à fuir.
Toutes ces horreurs s’inscrivent dans un conflit qui perdure depuis des décennies.
Depuis 2003, la situation oscille sans cesse entre un conflit ouvert et des tensions larvées. Ces crises consécutives ont donné lieu à vingt-deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et trois résolutions du Parlement européen. Le 4 mars 2009, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al-Bashir pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans le cadre du conflit au Darfour qui a débuté en mars 2003. Pour rappel, dès décembre 2018, un mouvement de protestation contre le régime d’Omar Al-Bashir a secoué le Nord du pays. Le 11 avril 2019, l’armée a destitué le président et a placé le pouvoir entre les mains d’un conseil militaire de transition, puis d’un conseil de souveraineté qui partageait le pouvoir entre les militaires et les civils. C’est d’ailleurs un civil, Abdallah Hamdok, un économiste aux Nations unies, qui est devenu le premier ministre. Mais la coalition entre militaires et civils, pour une soi-disant transition démocratique, n’était qu’une façade. Le pouvoir est, de fait, resté entre les mains des militaires, qui n’ont pas tardé à faire connaître leur dessein pour le Soudan et le 25 octobre 2021, ils ont officiellement repris les rênes du pays.
Alors que les massacres s’intensifient et s’étendent au Darfour, tu continues ton exil et en 2015 tu arrives en Libye…
Il faut d’abord que je précise que j’ai quitté l’Égypte pour la Libye, illégalement donc, avec trois camarades. Nous nous étions greffés à un groupe de 252 Égyptiens dans la ville de Saloume. Pour rejoindre la Libye, nous avions suivi 13 passeurs et je ne me rappelle plus exactement du nombre de kilomètres nous avons parcouru à pied mais nous avons marché toute une nuit, sans arrêts. À la frontière, il y a un évènement qui m’a beaucoup marqué. Les passeurs nous ont dit de marcher en file indienne car le sol était truffé de mines. Nous avons dû avancer les uns derrière les autres, très prudemment, en se concentrant sur les pas que faisaient la personne devant nous. Arrivés en Libye, nous avons été vendus à des trafiquants libyens. Nous avons été conduits dans une maison abandonnée avant de faire l’objet de traitements inhumains. Les trafiquants voulaient savoir si nous étions en contact avec nos familles pour qu’ils puissent leur demander une rançon, mais ils n’ont rien trouvé sur moi. Ce n’est pas la force physique qui m’a fait tenir, c’est ma force mentale. Mes ami.es avaient lancé une publication sur Facebook lorsque j’ai disparu et iels ont essayé de me joindre à plusieurs reprises, sans succès. Après des négociations très tendues, j’ai réussi à être libéré. Ce récit n’est évidemment qu’une toute petite partie de mon histoire en Libye.
Tu traverses la Méditerranée et tu arrives, après d’autres épreuves, à Calais…
« La jungle de Calais » était un endroit comme je n’en avais jamais vu auparavant. Je peux te parler de Calais en 2016, avant la grande évacuation. C’était un pays cosmopolite, il y avait toutes les nationalités qui vivaient là-bas et donc une diversité culturelle tellement dense, avec toutes les histoires possibles et inimaginables. Je voulais me rendre à Calais, mais je ne savais pas à l’époque quelle ville allait accepter ma demande d’asile. La seule information que j’avais était que c’était un camp de réfugiés, comme j’en avais déjà connu, et que je pouvais probablement y déposer ma demande d’asile. Dans mon groupe, il y avait 271 personnes et une seule cuisine. Nous nous réunissions chaque soir et chaque soir deux personnes cuisinaient pour tout ce monde. Tu pouvais passer la journée n’importe où mais le soir c’était important de se retrouver pour partager nos expériences du quotidien. Je me souviens du respect qui régnait pendant ces repas. C’était aussi une période où j’étais interprète bénévole pour France Terre d’asile, une association qui apporte un soutien aux demandeur.ses d’asile dans leurs démarches.
J’ai quitté Calais trois mois plus tard, le jour de l’évacuation. C’était un moment particulièrement émouvant de quitter cette ville-monde. J’ai pris la direction de la Normandie avec 51 autres réfugiés ; des Afghan.es, des Éthiopien.es, des Érythréen.es, des Iranien.nes. J’en garde un souvenir très fort et inoubliable.
C’est en 2020, lorsque tu es à Paris, que tu rejoins notre Initiative qui soutient des recherches et des pratiques artistiques prenant à bras le corps la question du care. À la traduction littérale, nous avons préféré une liste non exhaustive de synonymes : le care se rapporte donc au soin, à la sollicitude, à l’attention, à la responsabilité et au souci des autres. Magdi, tu es au cœur d’un certain nombre de projets et tu nous aides, avec bien d’autres membres de l’Initiative, à repenser les notions d’interdépendance et de mise en commun de l’art.
L’Initiative m’a permis de m’exprimer au-delà des lieux et des moments qui m’étaient donnés pour le faire. J’apprécie cette collaboration réciproque qui s’est établie entre tous les membres de l’Initiative, et encore plus lorsque cette collaboration déborde des cases qui sont généralement conçues pour des pratiques artistiques ou bien des pratiques sociales. Je suis fier d’être l’un des membres fondateurs de ce collectif qui ne cesse de grandir, d’élargir son réseau et qui prend soin d’entretenir, sur le long-terme, les relations qu’elle noue.
Aujourd’hui, tu es devenu un des jeunes leaders de la communauté soudanaise en France. Quel rôle souhaiterais-tu jouer pour ta communauté ?
Dès mon arrivée en France, je me suis demandé ce que je pourrais concrètement faire pour ma communauté, pour les populations noires non-arabes de mon pays qui sont restées au Darfour.
J’ai eu l’idée de créer une organisation non gouvernementale qui s’appelle DURMONGAA et dont l’objectif principal est de pourvoir à l’éducation des enfants orphelin.es et à tous les enfants du Darfour et à l’Est du Tchad qui n’ont pas les moyens d’aller à l’école. L’illettrisme est un fléau qui touche le pays depuis 2003 et les violences actuelles ne font qu’empirer la situation. Aussi, cette ONG sera à l’initiative de la distribution de matériel scolaire mais également de la nourriture et prendra en charge les frais d’inscription pour l’année scolaire des enfants. Je souhaiterais que, pendant leurs vacances, les enfants puissent également avoir les moyens d’apprendre le massalit, le français et l’anglais. Je souhaiterais me rendre à l’Est du Tchad, près de la frontière avec le Darfour pour superviser les activités sur le terrain. En effet, avec mon statut de réfugié je ne peux pas me rendre au Soudan. Je suis aussi très lié à la communauté soudanaise installée en Île-de-France et dans plusieurs autres grandes villes comme Bordeaux ou Strasbourg. Quinze mille Soudanais et Soudanaises, principalement originaires du Darfour, des monts Nuba dans le Kordofan du Sud et du Nil-Bleu se sont établi.es ici et chaque ethnie perpétue ses propres traditions. Nous espérons que la communauté internationale sortira de son silence et fera le nécessaire pour protéger les civils en danger. Ce conflit ne s’arrête pas aux portes du Soudan et risque de déstabiliser les pays voisins tels que le Tchad, le Soudan du Sud et l’Éthiopie.
Cet entretien a été réalisé avec l’aide de Marion Mille, stagiaire auprès de l’Initiative et chercheuse.
