Sean Price Williams et Nick Pinkerton : « Notre film parait surréel mais la réalité nous a rattrapés »
Cela fait longtemps que les cinéphiles ont repéré le nom de Sean Price Williams, chef opérateur, et à ce titre véritable partenaire de création de la jeune garde du cinéma new-yorkais (Josh & Benny Safdie, Alex Ross Perry, Ronald Bronstein). Chantre du tournage en pellicule et d’une image granuleuse, parfois voluptueuse dans son approche des visages, parfois plus heurtée pour restituer un chaos contemporain, Sean Price Williams passe enfin à la réalisation avec The Sweet East, sensation de la dernière Quinzaine des cinéastes.
À la faveur d’un voyage scolaire à Washington, la lycéenne Lillian prend la tangente, et telle une Alice d’aujourd’hui passe « de l’autre côté » du pays, à savoir celui remodelé par les fake-news et fantasmes malsains hérités de l’ère Trump. Son odyssée, faite de rencontres loufoques et d’explorations ahuries parmi les communautés les plus improbables et les sous-cultures les plus extrêmes, dresse un tableau de l’Amérique par ses marges déviantes. Il en ressort un inclassable film picaresque, mélange de conte et de satire qui ne s’interdit pas non plus de retrouver un certain émerveillement dans cet arpentage toujours recommencé du territoire.
Alors que plane la menace d’un come-back du Président maudit, un tel film apparaît aussi comme un coup de sonde dans la psyché de l’Amérique contemporaine. Mais en rencontrant Sean Price Williams et son fidèle complice et scénariste Nick Pinkerton, nous comprenons qu’ils préfèrent d’abord plutôt évoquer l’amusement qu’ils ont eu à fabriquer ce film, avant de livrer, au fur et à mesure de la discussion, leur sentiment quant à la fatidique échéance de novembre prochain. JL
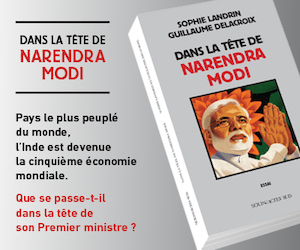
Comment le film a-t-il été reçu aux États-Unis ? Ce qu’il montre a vraiment des échos avec la situation politique actuelle.
Sean Price Williams : Le film est encore à l’affiche à New York, Los Angeles et d’autres villes, depuis trois mois. C’est ce qu’on pouvait espérer de mieux. Mais ce n’est pas le genre de film qui va créer un débat politique. Ce n’est pas un film qui se prend au sérieux. C’est même plutôt un film qui vous dit : « Hey, ne prenez pas tout au sérieux ! ». Bon, c’est peut-être une attitude un peu lâche, mais nous n’avons pas eu de grand débat politique autour du film.
Nick Pinkerton : Les retours sur le film ont été bénéfiques. Les gens qui viennent nous voir après la séance, sont enthousiastes : « C’est merveilleux, c’est le plus grand film jamais fait ! ». Quand nous rentrons chez nous, nous pensons que le film est adoré par tout le monde. Et sur Letterboxd, j’ai pu lire des évaluations à une étoile : « J’ai vu le réalisateur et le scénariste au Q&A, ils sont vraiment effrayants, je les déteste ». C’est difficile de voir comment le film est perçu.
S.P.W : Je ne vais pas lire les mauvaises critiques sur internet. Je préfère garder le souvenir des gens heureux qui viennent me voir après la séance.
Après avoir été chef opérateur pendant 25 ans, comment avez-vous passé le pas de la réalisation ?
S.P.W : J’ai toujours voulu devenir réalisateur. Je n’ai jamais voulu devenir directeur de la photographie. C’est un job que je ne comprenais pas avant, et je ne sais même pas si je comprends encore aujourd’hui tout, pendant que je le fais. Mais c’est quelque chose qui est arrivé assez vite et facilement. J’ai été heureux de tout ce travail, mais c’était toujours dans le but de réaliser.
N.P : Sean a travaillé sur beaucoup de premiers films. Il a souvent été la personne la plus expérimentée sur ces plateaux. Donc, c’était déjà lui qui « tenait » le tournage.
S.P.W : J’ai même été souvent assez proche des acteurs, même si j’étais très respectueux du lien entre le réalisateur et les acteurs. C’est comme ça que je me suis rendu prêt à passer à la direction d’acteurs. Je n‘allais demander à personne l’autorisation de le faire.
Au générique, le scénario est seulement signé de Nick Pinkerton, mais est-ce que vous avez échangé durant l’écriture ?
N.P : J’ai commencé à écrire seul les éléments de base de l’intrigue, pour aboutir à une première version. Mais une fois que le scénario est arrivé entre les mains de Sean, il a définitivement imprimé ses empreintes partout. Comme une partie du film raconte aussi le tournage d’un film indépendant, je savais qu’il allait rajouter des éléments vécus, comme l’incident avec la machine à neige, élément qu’il a rapporté du tournage de Marjorie Prime (de Michael Almereyda, 2017).
S.P.W : Le personnage joué par Jacob Elordi est inspiré de Robert Pattinson (que Sean Price Williams a côtoyé sur le tournage de Good Time de Josh et Benny Safdie en 2016). Nick s’est donc inspiré d’éléments de ma vie. Il était d’accord pour que j’apporte aussi des choses. Je n’ai pas modifié les dialogues, mais j’ai ajouté beaucoup de « blagues visuelles ».
N.P : Oui, c’est un gagman à l’ancienne ! Il a toujours des idées. À un moment, il y a des photos publiées dans un tabloïd, et c’est quelque chose qui t’es arrivé en Angleterre.
S.P.W : Il y avait une photo de moi et Krysten Ritter (mannequin et actrice, qui joue dans Listen Up Philip d’Alex Ross Perry, 2014) prise dans la rue, avec une photo : « Krysten Ritter et le mystérieux homme barbu ». Ça nous a servi d’inspiration quand Lillian devient une star du cinéma indépendant.
N.P : Même quand Sean n’était pas présent pendant l’écriture, je sentais toujours sa présence au-dessus de mon épaule. On se connait suffisamment.
S.P.W : En fait, c’est complètement documentaire !
Vous voulez dire que c’est un documentaire sur votre complicité ?
N.P : Bien sûr !
La structure du film, c’est qu’il y a un épisode dans chaque État (Washington DC, New Jersey, Delaware, Vermont) ? Cela m’a fait penser à Sufjan Stevens avec ses albums Greetings from Michigan (2003) et Illinois (2005) et qui avait alors l’ambition de réaliser 50 albums, un pour chaque État des États-Unis.
S.P.W : On me l’a déjà fait remarquer, mais je ne connais pas bien sa musique.
N.P : J’ai un attachement pour la tradition américaine des road-movies. J’ai surtout pensé à quelques films des années 80, faits après l’âge d’or du genre à la fin des années 60, début des années 70 comme Candy Mountain (Robert Frank et Rudy Wurlitzer, 1987), qui va de New York au Canada ou comme Dangereuse sous tous rapports (Jonathan Demme, 1987) qui va de New York jusqu’au centre de la Pennsylvanie. C’est un road-movie pervers et paresseux, parce qu’il ne traverse que le New Jersey. C’est très court. C’est Paris-Marseille.
S.P.W : Mais on n’a pas fait un Wim Wenders. Je viens de la côte Est, et ce sont des endroits que je connais et où j’ai vécu. C’est bien pour un premier film, car je n’avais pas à garder un ton constant. On s’autorise à s’amuser et à faire des sauts de puce, sans jamais être trop sérieux. C’est ce que j’avais en tête.
N.P : Je n’ai jamais compris ce fétichisme à vouloir tenir la même note. J’aime les mélanges et la variété.
Quand vous lisez le scénario, vous avez immédiatement des images ou des lumières qui vous viennent en tête ?
S.P.W : Je vois des endroits et des visages. Je suis très familier des lieux. Je n’ai pas d’idées préconçues. Nous n’avons pas les outils pour inventer un monde, qui sortirait de mon esprit. Nous devons avoir l’esprit pratique, avec le budget que nous avons. Nous devons imaginer un moyen agréable de montrer ce que nous voulons, mais c’est déjà là.
N.P : En 2018, nous avons fait un road trip de cinq jours tous les deux. Nous avons été sur tous les lieux du scénario, pour sentir les petites touches d’atmosphère de chacun d’eux. Par exemple, quand elle marche dans le mall à Washington DC, nous avons remarqué une longue ligne de marchands de glace, qui jouent tous un petit jingle commercial. Ça crée une cacophonie qui recouvre tout.
S.P.W : Ce ne sont que des petites choses comme ça, qui existent déjà, mais qui créent une étrangeté.
En extérieur, l’image apparaît souvent impressionniste, captant les rayons de soleil ou les reflets sur les plans d’eau. Quand vous arrivez sur un lieu de tournage, est-ce que la première chose que vous remarquez, c’est la lumière ?
S.P.W : Quand j’arrive sur un lieu, ce n’est pas d’abord la lumière que je remarque. J’ai toujours travaillé sur des films à petit budget et il faut toujours prendre en compte des choses très pratiques. La première logique, c’est de voir où on peut placer les sources sans qu’elles soient trop apparentes. Je ne me sens pas comme un peintre ou un photographe à observer toutes les variations de la lumière, même si je peux les imaginer.
Le film est tourné en pellicule, ce qui crée déjà une forme de décalage.
S.P.W : Je ne tourne plus qu’en 16 millimètres depuis 2020. J’ai mes habitudes avec le tournage en pellicule, mais le plus excitant pour moi, c’est de découvrir les images en allant au labo. J’ai besoin de cette distance entre ce qu’on voit sur le plateau et ce qu’on obtient à la fin. C’est l’inverse du numérique.
Ce qui donne l’aspect merveilleux de l’image, c’est aussi l’usage des surimpressions et des fondus. Est-ce que vous décidez de ces effets dès le début ou plus tard, au montage ?
S.P.W : J’adore superposer des images et jouer avec les fondus-enchaînés. Quand je lis un scénario, je sais où je vais les utiliser, et on a donc anticipé ces techniques dès le tournage. J’ai l’impression que beaucoup de gens de cinéma ont peur que ces effets fassent cheap, alors que c’est vraiment un outil très puissant pour rythmer le film. On devrait en voir plus souvent. Stephen Gurewitz, le monteur et moi, on plaisante souvent là-dessus en les appelant les « nouveaux outils ». En tant que cinéaste new-yorkais, je me sens sans doute plus libre d’utiliser des moyens expérimentaux, qui font vraiment partie de la culture de la côte Est depuis le début du cinéma américain. Hollywood s’est en partie établi en Californie, pour son ensoleillement constant, en toutes saisons. À l’Est, nous devons trouver des solutions plus improvisées et expérimentales pour faire face aux changements climatiques permanents. C’est ce qui nous rend fringants !
Est-ce qu’il y avait aussi une approche documentaire sur les personnages ? On voit rarement dans la fiction des suprémacistes blancs, ou des « artivistes » organisant des happenings à la fois artistiques et contestataires, toutes ces communautés soit étranges, soit effrayantes. Est-ce que vous connaissiez déjà ces communautés ou est-ce que vous les avez approchées de manière documentaire ?
S.P.W : Toutes ces sous-cultures existent, mais nous avons inventé les personnages. Nos versions sont volontairement un peu exagérées et nos personnages plus idiots qu’en réalité. Au bout du compte, on est presque bienveillants. Le style du film évoque le documentaire, avec la caméra portée et des cadrages proches des visages, mais le contenu est beaucoup plus fabriqué. Si nous avions davantage collés à la réalité, ces personnages auraient été plus menaçants et inquiétants. Les vrais suprémacistes blancs, on n’a pas envie de passer du temps avec eux.
N.P : Tous les deux, nous avons vécu dans des squats et croisé des artistes bizarres. Pour moi, c’était à Baltimore. Sean a une longue expérience des tournages dans le cinéma indépendant, d’où le moment où Lillian devient une jeune actrice. Et pour le personnage joué par Simon Rex, un universitaire alt-right, spécialiste d’Edgar Allan Poe, je connais des gens qui sont tombés dans ce « trou de ver » particulier. Par beaucoup d’aspects, on parle d’expériences vécues.
S.P.W : Il y a toujours des graines de réalité dans tous ces personnages.
N.P : Concernant « la réalité versus représentation », après avoir écrit la première version du scénario en 2017, j’ai senti que la réalité allait de plus en plus loin dans le ridicule, ce qui nous a obligés à aller encore au-delà. En 2017, je pensais que ce serait un film surréel alors que la réalité nous a rattrapés. Nous avons dû nous lancer dans une course contre la réalité.
S.P.W : Ces dernières années, la réalité est devenue si étrange. Et ça n’ira pas en s’améliorant durant les prochaines années.
Est-ce que votre film est un Magicien d’Oz de l’ère Trump ?
S.P.W : De l’ère « peut-être » Trump.
N.P : Nous n’avons jamais parlé du Magicien d’Oz entre nous. Même si c’est une de nos références, et qu’elle revient souvent quand les gens parlent du film. Après, c’est vrai qu’il y a beaucoup de fictions qui reprennent ce motif des « aventures au féminin ». Si nous nous rajoutons à ce corpus Alice au pays des merveilles / Le Magicien d’Oz, nous serons heureux !
Vers la fin, le personnage éclate d’un fou rire, comme si elle avait fumé. Peut-être que le meilleur moyen de parler de cette réalité angoissante, c’est de le considérer comme un bad trip.
S.P.W : C’est un trip, c’est sûr ! Elle choisit de faire le voyage. C’est plutôt sa vie quotidienne, sa vie avec sa famille dans un mobil-home qui est le bad trip. Cette aventure, c’est ce qui peut lui arriver de mieux. Même quand elle rentre à la fin, elle en veut encore. Elle a changé, de toute façon. Quand elle rentre à la maison, elle n’est plus la même personne.
N.P : Quand nous avons fait des débats post-projection, nous avons re-regardé plusieurs fois les cinq dernières minutes du film, et elles nous sont apparues de plus en plus tristes. Quand elle est sur le porche de sa maison en Caroline du Sud, elle fume une cigarette avec sa cousine, qui est, en réalité jouée par la sœur de l’actrice, MiMi Ryder. Elle lui dit que les gens se demandaient si elle était « partie faire du porno ». C’est toute la tristesse de la situation, qu’autour d’elle, personne ne puisse imaginer autre chose. Elle n’a pas forcément trouvé sa voie, mais elle a pu expérimenter de quoi le monde était fait.
S.P.W : Je ne vois plus ma famille très souvent. Je me souviens d’une réunion de famille vers 1999-2000, et les gens me demandaient : « Est-ce que c’est toi qui a fait ce film Blair Witch ? ». Et je leur répondais que si j’avais fait ce film, je serais devenu millionnaire. Personne n’avait l’air de comprendre l’absurdité de la question. C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que rien de ce que je pourrai faire dans ma vie n’intéresserait plus jamais ma famille. Dans le film, j’ai fait jouer une partie de ma famille, ma tante et mes cousins, et moi-même j’apparais dans le rôle de l’oncle. C’est la famille qui n’a pas grand-chose à offrir.
N.P : Nous avons réuni nos familles. Il y a la famille de Sean et la sœur de Talia Rider qui joue un personnage inspiré d’une de mes cousines. Ça devient un vrai home-movie à la fin.
S.P.W : Une grande partie des Américains vit comme ça. Déjà, en 1971, plus d’un tiers des maisons aux États-Unis étaient des mobil-homes. Ça a peut-être un peu changé, parce que maintenant, c’est plus facile de construire des « shitty homes ». Mais ça doit rester dans les mêmes proportions. C’est une part réellement triste et sans espoir de l’Amérique. Je voulais qu’on sente que ces gens n’étaient pas condamnés à vivre de cette façon, et pouvaient s’échapper vers autre chose.
N.P : Nous n’avons jamais réellement parlé de ça, mais Sean, Talia et moi avons été élevés par des mères solos.
S.P.W : Mes parents n’étaient jamais là. Quand je rentrais de l’école, il n’y avait jamais personne. J’avais l’impression de ne pas avoir de parents.
Votre film m’a fait penser à un certain cinéma des années 70, avec des héroïnes de jeunes filles comme Breezy de Clint Eastwood, ou Taking Off de Milos Forman qui trouvait une légèreté sur un sujet grave, avec un mélange de comédie et de chansons.
N.P : Oui, il y a beaucoup de films sur le sujet, si on inclut aussi Wanda de Barbara Loden ou Sans toit ni loi d’Agnès Varda. Mais ce sont des films graves.
S.P.W : Taking Off, c’est le plus fun dans le genre !
N.P : Il y a aussi la veine Go Ask Alice (L’Herbe bleue en VF), ou Hardcore de Paul Schrader, des histoires tristes où les jeunes filles s’enfuient, plongent dans la drogue ou le porno, et leurs parents désespérés partent à leur recherche.
S.P.W : Dans Taking Off, il y a une scène de bar où l’acteur Buck Henry est soûl et essaye de casser un œuf dur, c’est une des scènes les plus drôles que j’ai vues dans ma vie.
Dans les grandes ruptures de ton du film, il y a une grande scène de bataille inattendue, où toutes les armes sont utilisées : les arcs, les flèches, les haches et des pistolets et des mitraillettes. Tout à coup, on a toute l’histoire de la violence des États-Unis : des cow-boys et Indiens, jusqu’aux tueries de masse, comme Columbine.
S.P.W : Oui, d’autant plus que ça se passe sur un plateau de tournage. La réalisatrice et le producteur sont afro-américains et ils mettent en scène des Indiens. Ces personnes n’avaient pas eu l’opportunité de raconter cette histoire de l’Amérique, et ça se transforme en cartoon. Nick joue dans cette scène, et dit sa réplique fétiche : « Nous avons détruit notre prodigieux Héritage ! ».
N.P : C’est une réplique qui vient de Rossellini, L’âge de Cosme de Médicis (série de trois films tournés pour la télévision en 1972).
S.P.W : Mais ça résume tout. Nous aimons l’Amérique, mais nous sommes peut-être mal barrés.
N.P : Le personnage principal fait aussi un voyage dans le temps. Quand elle rencontre Lawrence, le professeur quinqua, elle est dans sa période victorienne, dans un environnement très straight. Après, elle croise des native Americans et vit plus proche de la terre, dans des cabanes ou des tipis. Elle voyage aussi bien dans le temps que dans l’espace.
Les transformations du personnage évoquent aussi des fantasmes masculins. Au début, c’est une teenager, puis elle rencontre son « Humbert Humbert » et devient presque une Lolita, puis elle devient une star du cinéma indépendant, puis une princesse en costume, mais enfermée dans son donjon. C’est une femme piégée par les hommes, mais qui arrive toujours à s’en sortir.
S.P.W : On ne peut pas oublier que les fantasmes masculins existent.
N.P : Oui, mais, à chaque fois, elle comprend le rôle qu’on veut lui faire prendre, et elle joue jusqu’aux limites qui lui permettront de s’échapper de ces situations. La grande différence quand elle rencontre son « Humbert Humbert », c’est qu’elle ne couche pas avec lui. Si elle reste avec lui, c’est qu’elle a déjà eu une expérience sexuelle avec son copain, ce qui ne l’a pas emballé. Elle est intéressée par l’effet qu’elle produit sur les hommes, mais elle ne les laissera rien faire. C’est elle qui pose les barrières et ne permettra jamais qu’on les franchisse.
S.P.W : On a lu que les jeunes pratiquaient de moins en moins le sexe aujourd’hui. Peut-être qu’on a anticipé ça. Notre personnage n’est pas intéressé par ça, même si elle essaye et joue avec ça.
Avez-vous pensé que quelque chose d’horrible, presque sadique, pourrait lui arriver ?
S.P.W : Si vous pensez cela, c’est à cause d’autres films que vous avez vus. De notre côté, nous n’avons jamais voulu la mettre en réel danger. On avait envie qu’elle fugue dans toute l’Amérique, loin de chez elle, et qu’elle continue à découvrir des choses.
N.P : Sa force, c’est qu’elle n’a pas conscience que quelque chose de tragique pourrait lui arriver. Elle rencontre des gens qui peuvent la contraindre, mais elle a une naïveté qui la rend presque invulnérable, et lui permet de traverser toutes ces situations, et de s’en tirer sans une égratignure.
S.P.W : Peut-être que perdre son téléphone au début, c’est ce qui lui retire sa peur. Ça l’oblige à regarder le monde, à s’amuser et à tenir l’effroi à distance.
J’avais vu le film une première fois en septembre à l’Étrange Festival et je l’ai revu il y a deux jours. Ce qui est étrange quand on regarde le film aujourd’hui, c’est qu’il y a un écho avec des révélations récentes dans le cinéma d’auteur français, après les révélations de l’actrice Judith Godrèche sur les emprises exercées par plusieurs réalisateurs. Quand Lillian est abordée dans la rue pour qu’elle passe immédiatement un casting, la réalisatrice branchée lui dit : « la bonne actrice dit toujours oui ». Cette réplique sonne étrangement.
S.P.W : Cette réplique était délibérée. Lillian comprend très vite le caractère prédateur du duo du producteur et de la réalisatrice. C’est un aspect que nous avons encore plus développé dans des scènes que nous n’avons pas gardées. Ces scènes sur ces relations de pouvoir m’intéressent évidemment, mais là on a osé faire ça avec un personnage différent d’un homme blanc de 62 ans, que nous connaissons tous.
Quel est votre sentiment sur la prochaine élection présidentielle américaine ?
S.P.W : It’s pretty bleak, man ! (C’est bien sombre !)
N.P : Eh bien, nous avons deux grandes options. Comment on peut perdre après ça ?
S.P.W : C’est quand même décevant que le job de président des États-Unis soit si peu sexy que ça n’attire personne avec un minimum de conscience de lui-même, ou de conscience du pays. C’est un sale boulot, c’est sûr. Si tu deviens Président, tu deviens automatiquement la personne la plus détestée dans le monde. Si c’est Trump, il reviendra avec un désir de vengeance contre tous ceux qui l’ont attaqué ces quatre dernières années.
N.P : L’autre option fait penser à la fin de l’URSS, un vieux dignitaire de 82 ans qui a fait toute sa carrière dans l’administration. On a finalement le choix entre deux hommes aux premiers stades de la démence. C’est très décourageant. Historiquement, nous n’avons pas toujours eu des génies à la Maison Blanche. À Washington DC, nous avons tourné tout près de la Bibliothèque de Thomas Jefferson, la plus grande d’Amérique du Nord. C’est quand même la preuve que quelques savants et penseurs ont occupé ce bureau.
S.P.W : Trump n’a qu’une étagère, avec ses propres livres.
N.P : C’est comme le gag de Quoi de neuf, Bob (film de Frank Oz, 1991), où Richard Dreyfuss, qui joue un psy dit toujours : « Hmm, il y a un très bon livre sur le sujet, je dois l’avoir ici » et sort toujours de sa bibliothèque le livre qu’il a écrit.
S.P.W : Il faudrait un âge limite pour être Président.
N.P : Après, ça peut ressembler à La Ballade de Narayama (de Shohei Imamura, 1983).
S.P.W : Où on monte en haut de la colline pour dire au revoir aux vieux Présidents. Mais bon, cela nous donnera encore plus d’histoires étranges avec lesquelles on pourra s’amuser.
N.P : Quelle est la meilleure option ? En France, vous avez aussi un cauchemar bureaucratique avec Macron. C’est quoi cette histoire que le Président et le Premier ministre ne dorment jamais ?
Oui, on se croirait dans un David Lynch : des hommes en costard-cravate qui ne dorment jamais.
N.P : À se demander ce qu’ils peuvent faire quand ils ne dorment pas.
S.P.W : Et encore plus quand ils sont réveillés !
Quand Trump avait tweeté « covfefe », ça ressemblait à un dialogue « dit à l’envers » dans Twin Peaks : The Return.
S.P.W : Oui, c’est le « backwards talking » de Lynch.
Finalement, David Lynch est devenu le cinéaste le plus réaliste pour parler de l’Amérique d’aujourd’hui.
S.P.W : Qu’est-ce qu’il va faire, Lynch maintenant ? Peut-être qu’il devrait se présenter aux élections. « David Lynch for President » c’est un bon projet.
N.P : Il y avait une grande rétrospective Bruce Conner au MoMA, il y a quelques années. Quand il était étudiant, il avait fabriqué des badges « EZ for Pres », ce qui voulait dire « Ezra Pound for President ».
S.P.W : Nous avons travaillé avec le même sound designer que David Lynch, Dean Hurley, qui est très proche de lui et il y a quelques sons directement lynchiens dans le film. Pendant le mixage, je voulais entendre une histoire sur David Lynch tous les jours.
Le film fonctionne comme un collage de genres – comédie, teen-movie, cinéma d’horreur – mais la bande-son fonctionne aussi comme un collage avec beaucoup de musiques différentes, qui vont du rock indépendant à la musique expérimentale, en passant par le jazz. Est-ce que vous choisissez vous-mêmes toutes ces musiques ?
S.P.W : Oui, la plupart. Je voulais que le film soit aussi un « noise movie ». C’est la part abrasive et agressive du film, car c’est la musique que j’aime. C’est celle qui me tient éveillée. J’ai toujours mon iPad avec moi, toujours sur shuffle. Le Voyage de Morvern Callar (de Lynne Ramsay 2002), c’est un « iPad shuffle movie » et quand il est sorti, je l’ai détesté. Mais maintenant, j’ai fait le mien. Je ne peux aller d’un point A à un point B sans écouter de la musique. C’était donc important d’avoir ça aussi dans le film. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’avoir beaucoup de musique, c’est un cache-misère. Rohmer mettait très peu de musique, par exemple. On peut penser que rajouter de la musique, c’est une béquille pour les mauvais cinéastes, mais je ne peux pas raconter cette histoire sans musique. Pour moi, c’est un cadeau d’avoir beaucoup de musique dans un film.
N.P : C’était difficile à expliquer quand nous avons commencé à faire lire le scénario, parce qu’il contenait beaucoup de dialogues. J’espère que le dialogue est bon, mais je ne pense pas qu’il soit toujours crucial. Le dialogue n’est qu’un élément de la bande-son, et même de ce « domaine du bruit ». Je suis fier de ce que j’ai écrit, mais le contenu des paroles, ce n’est pas la seule chose à prendre en compte. Ce n’est qu’une couche parmi d’autres. Il y a aussi des choses amusantes qui se passent au son.
S.P.W : Quand nous avons fait le mixage, une partie du travail était de remettre les dialogues en avant. Il y a des choses que je n’avais jamais entendues, des choses dites hors champ qu’on a remis « in ». C’était étrange de les entendre comme ça, pour la première fois. Nous avons tiré une copie 35 mm du film. Le son est un vieux système Dolby. C’est très étrange, car le dialogue est vraiment au-dessus de tout le reste maintenant. Des dialogues secondaires ont été trop clarifiés maintenant. Et c’est étrange de réentendre des dialogues différemment, suivant les cadrages. C’est presque un autre film.
Il y a deux jours, j’ai découvert Let’s Scare Jessica to Death (John B. Hancock, 1971), film d’horreur culte aux États-Unis mais peu connu en France, et j’ai été étonné de la bande-son très novatrice qui mélange le jazz et les synthétiseurs. Dans les années 70, on avait l’impression qu’il y avait une rencontre entre le cinéma de genre, voire d’exploitation et l’avant-garde musicale.
S.P.W : Oui, j’adore ce film. C’était l’un des gros succès du vidéoclub où je travaillais. On le regardait souvent, entre nous, le soir.
N.P : C’est un grand film démoniaque sur le couple, parfait pour la Saint-Valentin !
J’ai aussi découvert Minimal Man avec l’incroyable chanson de fin Showtime. C’est une incantation, entre le punk et la musique industrielle, dont le son remplit toute la salle de cinéma.
S.P.W : Oui, ça date de 1985, c’est incroyable. Ses précédents enregistrements sont encore plus rudes, avec des titres bien provocants comme Sex with God ou Sex Teacher. Sa musique n’a pas été reéditée pour être disponible en numérique. On a retrouvé une vieille K7 pour restaurer ce titre. Cette chanson, à la fin, c’est une façon de dire : « Monde, réveille-toi ! ».
The Sweet East de Sean Price Williams, écrit par Nick Pinkerton, sortie en salle prévue le 13 mars 2024
