Jordi Colomer : « Il faudrait que les urbanistes soient les habitants eux-mêmes »
On connaissait le travail de Jordi Colomer en France depuis longtemps mais surtout depuis sa grande exposition de 2008 au musée du Jeu de Paume, raison pour laquelle on attendait avec impatience une rétrospective conséquente du travail de l’artiste catalan que lui consacre enfin le MACBA, musée d’art contemporain de Barcelone, sous le commissariat de Martí Peran. Ses pièces les plus anciennes datant du début des années 1990 se déploient aux côtés des plus récentes dans une scénographie géniale sans aucune hiérarchie où l’on déambule sans frontière ou en tentant de se repérer sur un plan comme on parcourrait une ville inconnue. On connaissait ses fameux Anarkitekton (2002-2004) où un personnage portait littéralement des bâtiments à bout de bras au bout d’une perche dans Barcelone, Bucarest, Brasilia et Osaka, Crier sur les toits (2011), proposant aux citoyen·nes d’occuper les toits terrasses pour prendre la parole ou encore sa voiture surmontée d’un néon No? Future! imaginée pour la ville du Havre en 2006. Ces pièces iconiques côtoient plus de cinquante autres installations, maquettes, vidéos, performances et autres projets plus enthousiasmants les uns que les autres qui questionnent avec humour et dérision des sujets aussi profonds que le nomadisme, la périphérie, la communauté, la fiction et les limites de l’utopie. OR
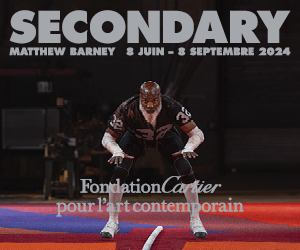
Une grande rétrospective de votre travail a lieu en ce moment au MACBA. On se souvient de votre rétrospective en France au musée du Jeu de Paume. Comment se fait-il que les institutions espagnoles aient attendu si longtemps pour vous consacrer une exposition d’envergure ?
L’exposition au Jeu de Paume date de 2008, il y a déjà longtemps, mais elle a quand même voyagé en Espagne, au musée Patio Herreriano de Valladolid. J’en avais fait une toute première à Villeurbanne, en 2005. Jean-Louis Maubant, qui en était le commissaire, m’avait parlé de mid career retrospective, comme disent les anglo-saxons, et il m’avait convaincu. En vérité, le MACB
