Pour un nouveau mode de scrutin : « le jugement majoritaire »
Avec l’avènement de la démocratie libérale, l’élection est devenue l’acte civique fondamental, où l’exercice d’un droit politique individuel contribue à forger la souveraineté collective. Les travaux d’Olivier Christin sur l’histoire du vote [1] nous démontrent que pareille évolution n’avait rien d’inéluctable, et que ce progrès n’est pas irréversible. Dans les sociétés dites primitives, la recherche de l’unanimité ou du consensus prohibait toute forme d’élection, et plus encore d’élection libre régie par la règle majoritaire. Le vote par assentiment, le tirage au sort, la convocation de l’esprit saint, ou encore l’acclamation eurent, au Moyen-âge, la part belle.
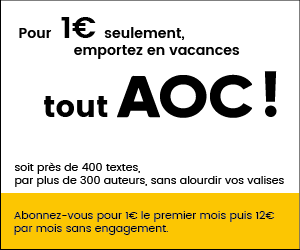
L’érudition méticuleuse d’Olivier Christin nous en apprend cependant beaucoup sur le fonctionnement de quelques « sociétés électives » à compter du Moyen-âge central (XII-XIIIème siècles), au sein de communautés comme les villes, les universitas ou encore les conclaves. Ces communautés faisaient un usage du scrutin qui n’avait rien de commun avec celui que nous connaissons aujourd’hui. Pour des raisons qui peuvent être liées aussi bien à la taille et à la composition des communautés qu’à leur philosophie politique, ces élections évoluaient loin de la règle majoritaire, perçue comme un facteur de dissension et de destruction du corps social, de la liberté d’expression des électeurs, et de l’égalité entre les voix. Ces pratiques ont néanmoins représenté un point de départ vers l’élection moderne et ce que Pierre Rosanvallon a appelé le « sacre du citoyen », qui fut enfanté par la philosophie égalitaire, rationnelle et universaliste des lumières. Le scrutin prend alors le dessus sur les autres modes de détermination de la volonté collective. Le suffrage devient universel et secret. Il obéit à la règle majoritaire, celle du « nombre » et de l’égalité entre les voix.
L’histoire du vote nous enseigne que les méthodes d’élections sont, davantage qu’une ingénierie de la décision collective, la traduction d’une phi
