Une banque pour sauver la démocratie ?
Alors que s’est ouvert en juillet à l’Assemblée nationale le débat sur la révision constitutionnelle, de nombreuses questions restent à trancher, de la limitation du cumul des mandats à la réduction du nombre de parlementaires en passant par l’introduction d’une dose de proportionnelle, pour ne citer que quelques-uns des principaux enjeux de cette réforme. Or, si certain de ces enjeux sont très fortement médiatisés, d’autres aspects semblent passer à l’arrière-plan, relégués à une position de sujets techniques, alors même qu’ils sont cruciaux pour le bon fonctionnement de nos institutions démocratiques.
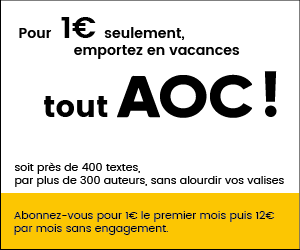
Parmi ces sujets dits « techniques » passés à la trappe de l’attention médiatique, et dans ce cas précis passés également à la trappe du débat parlementaire, on trouve la création d’une « banque de la démocratie ». Cette idée avait été portée au début du quinquennat d’Emmanuel Macron par François Bayrou, alors ministre de la Justice, puis « repoussée » lorsque ce dernier avait du démissionner. De quoi s’agissait-il ? De la mise en place d’une structure bancaire publique permettant aux candidats et aux partis de s’affranchir des financements des banques privées. Un détail me direz-vous ? Loin s’en faut, car qui dit absence de financement, dit impossibilité pour un candidat de se présenter à une élection. Autrement dit, l’accès à un financement joue comme une sorte de nouveau cens empêchant ceux qui n’obtiennent pas le graal de participer au jeu électoral.
Cela tient pour partie aux règles encadrant le financement public des campagnes électorales en France. Prenons l’exemple des élections législatives. Un candidat peut dépenser au cours de sa campagne un montant maximum de 38 000 euros, auquel il faut ajouter 0,15 euro par habitant de la circonscription dans laquelle il se présente (ainsi le montant des dépenses autorisées augmente avec la taille de la circonscription : 53 000 euros si la circonscription compte 100 000 habitants, 68 000 euros si elle en compte 200 000
