Alerte orange sur l’Europe bleue-brune : de la guerre commerciale comme planche de salut
Ecce Europa
L’Europe bleue-brune est en marche, unie jusque dans la mise en scène des tensions entre ses maîtres d’œuvre. Ceux-ci font certes grand cas de leurs désaccords sur des questions de préséance : tandis que les uns plaident à la fois pour une mutualisation de l’inhospitalité et pour le maintien des prérogatives de l’Union en matière de plafonnement des déficits, les autres n’entendent concéder leur adhésion aux contraintes budgétaires imposées par Bruxelles qu’en échange d’une pleine autonomie dans la gestion du refoulement et des déportations. Toutefois, derrière cette controverse protocolaire, les partisans du multilatéralisme et les champions des nations souveraines s’accordent d’autant mieux sur le fond que les remontrances qu’ils se plaisent à échanger les confortent auprès de leurs électorats respectifs.
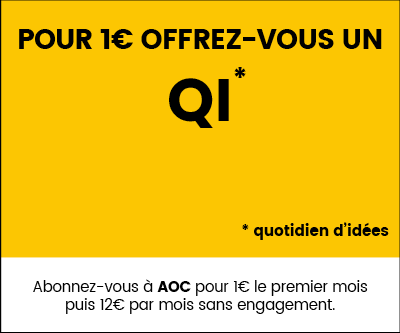
Du côté bleu, si Angela Merkel n’a plus guère le cœur à défendre son rêve allemand d’austérité accueillante [1], pour sa part, Emmanuel Macron n’hésite ni à se poser en avocat d’une société ouverte ni à morigéner les dirigeants oublieux des conséquences funestes qu’ont jadis produites les égoïsmes nationaux. Or, en dépit de sa vacuité, une pareille rhétorique suffit à rassurer les épargnants férus d’humanisme qui lui ont apporté leurs suffrages : car à leurs yeux, un chef d’État qui fustige la lèpre nationaliste ne saurait être soupçonné de la répandre pour son compte. Aussi l’autorisent-ils volontiers à appeler fermeté républicaine les exactions commises par les forces de l’ordre hexagonales – de Calais à Vintimille – et à parler d’aide au développement pour décrire l’externalisation des camps de détention d’exilés dans des zones de non droit.
Du côté brun, l’offuscation affectée n’est pas moins efficace. Le ministre de l’Intérieur italien tire notamment parti des accusations d’arrogance et de d’hypocrisie qu’il porte contre le directoire franco-allemand de l’Europe pour renforcer sa posture de représentant des peuples méprisés par les élites mondia
