L’honneur perdu d’une institution – hommage à Brigitte Lainé
C’était il y a près de vingt ans, mais rien ne semble avoir changé. Le communiqué du Service Interministériel des Archives de France et, peut-être pire encore, celui des Archives de Paris, concernant la disparition de Brigitte Lainé le 2 novembre dernier – pour ne rien dire de celui de l’Ecole des Chartes – en attestent. Le premier se borne à énumérer sèchement les états de service de Brigitte Lainé sans la moindre allusion à la sanction que lui a valu son geste civique. Le second fait mine de louer « son esprit d’indépendance et de liberté, sa conscience politique [qui] l’amènent parfois à tenir des positions lourdes de conséquences mais qu’elle assume entièrement ». Un éloge à la sincérité suspecte. Une pudibonderie administrative déplacée.
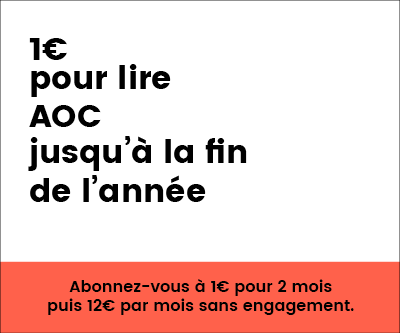
Pour quelles raisons ne pas être plus explicite sur cette « conscience politique » qui amena Brigitte Lainé à déposer en faveur de Jean-Luc Einaudi, attaqué en diffamation par Maurice Papon en 1999 ? Pourquoi passer sous silence ce scandale, à savoir que Brigitte Lainé et son collègue Philippe Grand ont été « placardisés » jusqu’à leur retraite de la façon la plus inique par leur supérieur hiérarchique, le directeur des Archives de Paris, François Gasnault ? Pourquoi omettre la couverture assurée sans faille à ce dernier, des années durant, par les deux administrations de tutelle des Archives de Paris : la Mairie de Paris, de quelque bord qu’elle fût, et les Archives de France ?
Rappelons les faits.
Jean-Luc Einaudi avait consacré un livre à la répression policière de la manifestation des Algériens qui eût lieu à Paris le 17 octobre 1961. Un massacre. Des corps jetés dans la Seine. Officiellement trois ou quatre, sept tout au plus, et encore laissait-on entendre qu’il s’agissait de règlements de compte entre les combattants algériens. En réalité, des centaines. Le grand mérite de Jean-Luc Einaudi fut de sortir de l’oubli un événement sur lequel aucun historien professionnel ne s’était jusque-là penché. Il croisa pour cela qua
