Un peuple, deux populaces
Il est des traditions politiques où l’on ne sait à quel principe se vouer lorsqu’ils entrent en tension. Égalité et liberté étaient destinées à être embrassées d’un seul regard, mais très vite c’est un strabisme qui finit par affecter durablement la vision politique moderne, née en France avec la Révolution, mais appelée à se répandre partout. À ce strabisme partagé, s’ajoute pour les juifs de France, longtemps considérés comme une entité étrangère, un « royaume dans le royaume », une vision politique ancestrale où l’on ne sait trop de qui se méfier le plus, du pouvoir potentiellement malveillant ou de la foule dangereuse – strabisme divergeant, caractéristique d’un groupe dominé, vulnérable.
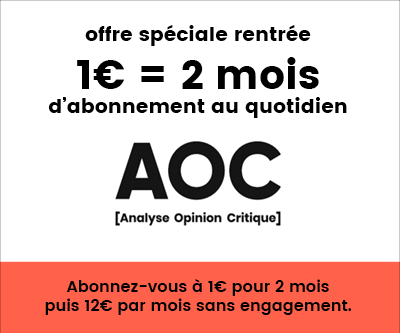
Traditionnellement, par expérience, les juifs se méfièrent de la populace, de ses violences sporadiques, et cherchaient la protection du pouvoir suprême, seule instance capable de leur garantir une sécurité relative. La nature générale du pouvoir passait pour secondaire, pourvu qu’il les protège. En émancipant les juifs complètement, la Révolution française mit abruptement fin à cette condition subordonnée et à l’incertitude structurelle qui en découlait. Dissout en tant que collectif quasi politique, devenus citoyens, les juifs, désormais appelés « israélites », pénétrèrent subitement, en tant qu’individus, dans la Nation française pour partager avec le tout du peuple la vision politique moderne. Cette dernière suppose que le peuple, source de toute souveraineté, est un sujet ordonné, rationnel, autonome, capable de se gouverner.
Si la méfiance des citoyens juifs ne s’est jamais complètement dissipée en régime démocratique, c’est que le peuple pouvait virtuellement dégénérer en populace hostile. Malgré les signes de réassurance, rien n’était irréversible, comme l’attestait la vague antisémite du dernier quart du XIXe siècle, période de républicanisme pourtant triomphant. Durkheim professa la sociologie du haut de sa chaire, science destinée à convertir les principes de 1789 e
