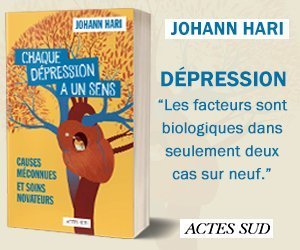Finance et société : en finir avec le syndrome de Stockholm
Dix ans après une crise financière et bancaire majeure, nos économies ne sont pas à l’abri d’une nouvelle crise systémique. Bien que les digues aient été relevées et les amortisseurs dans le système financier renforcés, la finance n’a pas fondamentalement changé.
Étonnamment, malgré la crise financière qui a mis à genoux nos économies, malgré les travaux de recherche convergents qui montrent que l’hypertrophie de la finance pèse sur la croissance alors qu’elle est censée la soutenir, malgré les liens de plus en plus évidents entre l’obésité de la sphère financière et la montée des inégalités qui minent nos sociétés, malgré l’incompatibilité entre le court-termiste de la finance contemporaine et l’impératif de financement de la transition écologique, nos gouvernants restent très perméables à l’emprise du lobby bancaire.
L’hypertrophie de la finance n’a pas reculé, les régulations financières ont avancé mais pas autant que nécessaire pour protéger le bien commun qu’est la stabilité financière, les acteurs financiers systémiques sont toujours une menace, les États donc les contribuables ne sont pas à l’abri d’avoir à remettre la main au portefeuille alors même qu’ils ne sont plus nécessairement en état de le faire…
Fraudes, scandales financiers en tout genre, salaires et bonus extravagants envahissent toujours les journaux, alimentent la défiance de la société à l’égard de la finance et nourrissent un populisme qui menace nos démocraties. Pourtant, les États, comme frappés de dissonance cognitive, se refusent à une véritable reprise en main et à promouvoir une finance vraiment au service de la société. Comment expliquer ce qui ressemble à une démission du politique face à la finance ? Nos dirigeants seraient-ils victime d’une forme revisitée du syndrome de Stockholm ?
Ce mécanisme d’ascendant psychologique annihile toute combativité des victimes, dissout leur capacité d’auto-défense et conduit à une soumission volontaire. Les économistes, rétifs à accepter d