Comment analyser l’antisémitisme aujourd’hui ?
Comprendre l’antisémitisme et expliquer sa présence dans la société actuelle nécessite au préalable d’écarter un certain nombre de fausses pistes. Un premier constat s’impose : les analogies avec les années 1930 ne sont guère pertinentes pour comprendre la situation actuelle. La démarche analogique montre toujours, de manière générale, des limites. Elle entrave même souvent l’analyse, en faisant disparaître la recherche d’explications tout comme l’historicisation nécessaire de tout phénomène.
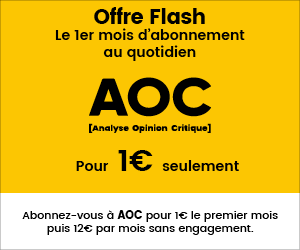
L’antisémitisme était, dans les années 1930, un sentiment largement présent dans la société française, alimenté par de solides et actifs réseaux d’extrême droite. La peur du communisme avait rallié au nationalisme une partie importante des classes moyennes. Même si le poids réel de l’antisémitisme est toujours difficile à mesurer, on dispose d’indicateurs qui montrent des différences notables : la presse de l’époque mais aussi de nombreux ouvrages étalaient dans leurs colonnes un antisémitisme nauséabond, une situation totalement impensable aujourd’hui. L’interdit est aujourd’hui d’ordre moral mais aussi juridique puisque l’arsenal législatif a été renforcé. C’est ainsi la forte présence de cet antisémitisme dans la presse d’extrême-droite des années 1930 qui a incité le gouvernement a promulguer la première loi contre le racisme, le décret-loi du 21 avril 1939, dit « loi Marchandeau ».
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprimait déjà l’injure et la diffamation n’était plus suffisante. Depuis, la législation n’a cessé de se renforcer : au début des années 1970, c’est dans un contexte d’augmentation du nombre d’actes racistes à l’égard des travailleurs étrangers en provenance des anciennes colonies, notamment d’Algérie, qu’est votée la loi Pleven (1er juillet 1972). Elle crée un délit nouveau de provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence raciales. L’arsenal législatif est complété par la loi du 13 juillet 1990, dite « loi Gayssot », qui sanctionne également la négation des crimes contre l’humanité perpétrés par le régime nazi. Concernant les actes, le droit pénal réprime le racisme ou l’antisémitisme lorsque ces sentiments motivent un passage à l’acte criminel ou délictueux. Les infractions sont alors aggravées par la circonstance de racisme ou d’antisémitisme.
Les enquêtes nous montrent que l’antisémitisme a fortement diminué en France depuis la seconde guerre mondiale. Les rapports de la CNCDH disponibles depuis les années 1990 montrent que les « juifs » sont la minorité la mieux tolérée aujourd’hui. Si les enquêtes par sondage ont des limites, d’autres indicateurs nous confirment cette tendance : la presse, tout comme la communauté politique, sont unanimes à condamner l’antisémitisme, ainsi qu’à se mobiliser contre celui-ci. Cependant, deux inquiétudes demeurent. Les stéréotypes sont encore largement présents dans l’opinion publique, des stéréotypes qui associent les juifs à l’argent, au pouvoir et aux médias. S’il convient de distinguer présence de stéréotypes et antisémitisme, les premiers n’entraînant pas automatiquement une haine ou un rejet, cette persistance doit être prise au sérieux.
Des crimes crapuleux comme celui du jeune Ilan Halimi ont été alimenté par le stéréotype qui associe le « juif » à l’argent. La seconde inquiétude réside dans l’augmentation de la violence des actes allant jusqu’à des assassinats. Leur nombre a fortement augmenté en 2018 mais encore faut-il rappeler que les fortes variations de ces dernières années. Après une année 2015 record, les actes antisémites avaient nettement reculé en 2016 (– 58 %), en 2017 la baisse s’était poursuivie (– 7 %) mais les actes violents visant les juifs avaient augmenté. Après ces deux années de baisse, les actes antisémites en France sont à nouveau en très forte hausse (+ 69 %) en 2018. Cependant, ces statistiques ne révèlent qu’une partie des actes racistes car ils sont de manière générale sous-déclarés. Ce constat s’applique à toutes les catégories.
L’analyse la plus rigoureuse des phénomènes permet d’éviter la concurrence des victimes.
Il faut rappeler que l’antisémitisme va de pair avec une attitude globale de rejet de toutes les minorités (Arabes, Africains, Roms…). Les enquêtes montrent que les individus intolérants sont souvent caractérisés par un âge élevé, l’absence d’instruction, l’insécurité économique, un positionnement politique de droite. Si des comparaisons avec le passé peuvent être pertinentes, c’est bien sur la permanence d’un antisémitisme en provenance de l’extrême-droite. Ces idéologies nationalistes, dans toute leur diversité, portent en elles-mêmes des valeurs de rejet, sinon de haine de l’ « autre ». C’est également dans les franges d’un catholicisme nationaliste que l’on peut encore retrouver l’antijudaïsme chrétien aux racines anciennes. Si la politique israélienne à l’égard des Palestiniens peut, parfois, entraîner une dérive de l’antisionisme vers l’antisémitisme, l’absence d’enquêtes nous empêche de quantifier le phénomène. Une clarification du vocabulaire s’impose afin d’éviter tout amalgame. N’est-il pas préférable de désigner par « nationalisme » ce que l’on nomme « sionisme » ? Le premier sionisme de la fin du XIXe siècle socialisant n’a, en effet, pas grand chose de commun avec la politique actuelle du gouvernement nationaliste israélien.
L’analyse la plus rigoureuse des phénomènes permet également d’éviter la concurrence des victimes et le sentiment que peuvent éprouver les autres minorités victimes de racisme et de discriminations, des victimes qui ne bénéficient pas tous d’une même mobilisation médiatique et politique. Cet impératif d’analyse rigoureuse a aussi l’avantage de pouvoir permettre la mise en œuvre de solutions appropriées. Si la haine se déchaîne sur internet, c’est bien là qu’il faut agir. Si la persistance des stéréotype est un réel problème, alors elle doit entraîner une mobilisation médiatique et politique. La lutte des stéréotypes passe par l’éducation. Si nous disposons d’études sur l’histoire et la sociologie du judaïsme qui nous permettent de les réfuter, encore faut-il que ces analyses soient présentes dans les programmes scolaires et encore faut-il qu’elles soient relayées par les médias. Là encore, pour ne pas aviver la concurrence des victimes, il s’agit d’engager une ambitieuse mobilisation non seulement contre les stéréotypes qui associent les « juifs » à l’argent, au pouvoir, aux médias mais aussi contre tous les stéréotypes, ceux qui pensent que certains « puent », sont « paresseux » par nature, ne « souhaitent pas s’intégrer », etc.
La perspective historique garde sa pertinence parce qu’elle nous permet d’analyser pourquoi à un moment donné des sociétés voient le racisme s’exacerber.
Si la perspective historique garde sa pertinence, c’est parce qu’elle nous permet d’analyser pourquoi à un moment donné des sociétés voient le racisme s’exacerber : quels contextes favorisent les phénomènes ? Quels sont les enjeux économiques, politiques, sociaux qui poussent les acteurs sociaux à activer certaines catégories, certains stéréotypes, à tenir des propos racistes ou à pratiquer des discriminations ? À travers les exemples de racisme institutionnalisé, on perçoit bien le rôle des différents acteurs de la société (les élites économiques, politiques, les intellectuels, les scientifiques, les médias, la société civile…) dans les processus de racialisation. Un groupe dominant, ou plus anciennement établi, active certaines catégories pour servir un but politique et/ou économique. C’est par exemple le cas de partis politiques d’extrême droite qui souhaitent donner une préférence à une catégorie mythique et fantasmée. On peut encore citer l’exemple des élites économiques, qui veulent soumettre des populations en esclavage. Le racisme institutionnalisé apparaît lorsque l’État participe au processus en vue de justifier une domination économique, politique (esclavage, colonisation, bouc-émissaire…) et en utilisant les moyens dont il dispose pour l’imposer : la législation, l’éducation, les institutions…
Les élites savantes jouent également un rôle : la science peut tenter de donner des fondements scientifiques à ces catégories, comme elle l’a fait au XIXe siècle ; la littérature savante et populaire les utilise, les vulgarise, les diffuse dans la société. Les catégories circulent alors dans les différents espaces intellectuels, ce qui les renforce, les légitime, et leur donne l’apparence du réel et de l’objectivité. Dans les régimes autoritaires, les médias mis au service de l’État deviennent des instruments de propagande qui imposent les catégories en les utilisant. Dans les États démocratiques, les médias sont libres mais participent au processus : en utilisant les catégories, en leur associant des stéréotypes, ils les rendent « vraies », « réelles », « objectives »… La société civile, quant à elle, peut être complice afin d’en tirer profit, « attentiste », ou bien résister. Le processus peut aboutir à des discriminations, des ségrégations, la déshumanisation, des violences d’État et aller jusqu’au génocide.
L’analyse du racisme ne peut être dissociée d’une réflexion sur la production des catégories, toute utilisation de catégories, même dans un but d’analyse, contribue à les réifier, à les rendre objectives, réelles.
Alors aujourd’hui, cherchons où se situent les responsabilités. Du côté des élites politiques, la volonté de lutter contre le racisme s’accompagne, chez bon nombre d’élus, de discours publics porteurs de stéréotypes voire même de propos racistes. Les médias, quant à eux, font circuler des stéréotypes sur les « jeunes de banlieues » ou encore sur les « Roms », quant ils ne donnent pas la parole à des « intellectuels médiatiques » qui tiennent des propos différentialistes, ethnicisants, voire racistes ?
Enfin, l’analyse du racisme ne peut être dissociée d’une réflexion sur la production des catégories. En effet, toute utilisation de catégories, même dans un but d’analyse, contribue à les réifier, à les rendre objectives, réelles. Afin de neutraliser cet effet réificateur, il est indispensable de faire prendre conscience à un large public que les catégories ont une histoire liées au contexte dans lesquelles elles sont produites. Les catégories prédominantes varient selon les sociétés : elles peuvent avoir un fondement social, culturel ou religieux ; elles varient également selon les époques. Le critère social a longtemps été le principal critère de catégorisation. L’identité de l’individu était avant tout définie par la place que l’individu occupait dans la société. La division en trois ordres, « ceux qui prient », « ceux qui combattent », « ceux qui travaillent » a, pendant tout le Moyen Âge, régi les identités. Du XIXe siècle au XXe siècle, les identités ont ensuite été structurées par les classes sociales (aristocratie/bourgeoisie/prolétariat), donnant à chacun une position, une place dans la société, une culture. Le critère religieux a aussi été clivant : protestant/catholique, juif/chrétien, sunnite/chiite, etc. Pourtant, certains antagonismes très virulents ayant donné lieu à des guerres très sanglantes comme l’opposition catholique/protestant ont aujourd’hui quasiment disparu en Europe. Ainsi, les clivages religieux fluctuent aussi selon les époques. Enfin, avec l’essor des États-nations, la nationalité et l’origine sont devenus plus récemment des éléments centraux dans la définition des identités mais ils ne le seront peut-être pas toujours…. Ainsi, si des critères de différenciation existent, ils ne sont pas toujours activés, pas forcément source d’antagonismes.
Dans le cas présent, on ne peut dissocier les analyses de l’antisémitisme d’une réflexion sur la catégorie en question. Qu’entend-on pas « juif » aujourd’hui ? Quel sens peut avoir une catégorie qui englobe des croyants dans toutes les diversités mais aussi des personnes « d’origine juive » ? Toute éducation contre le racisme doit mener en parallèle une éducation sur les dangers des expressions « communauté » tout comme une éducation au processus d’identification. Les programmes scolaires sont encore bien loin d’évoquer la construction des identités ainsi que toutes les notions aujourd’hui indispensables à la compréhension de la société actuelle : la notion de pluralité des identités, d’assignation identitaire, de retournement du stigmate, etc.
(NDLR : Carole Reynaud-Paligot vient de faire paraître avec Evelyne Heyer, On vient vraiment tous d’Afrique ?, un titre inédit de la collection Champs-Flammarion)
