Algérie, la solitude des foules
Les images de la foule du mouvement de contestation algérien du 22 février ont surpris. La méconnaissance de la jeune nation algérienne en Occident, les présupposés, les préjugés sur ce que sont ou sont supposés être les Algériens aujourd’hui alimentent une grande surprise et une méfiance. Une défiance.
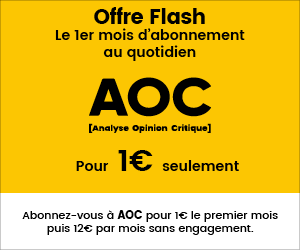
Il s’agit de comprendre comment « ce peuple islamisé, qui a tout perdu avec la guerre d’Indépendance » peut mener une révolution pacifique sans être « suspect ». Car c’est bien un sentiment de suspicion qui transparaît dans certaines analyses de la situation contestataire algérienne. Une grande prudence. Il faut toujours être prudent avec l’Algérie. On ne sait jamais. On a déjà vécu de drôles de choses. C’est un pays imprévisible, une dictature mafieuse et islamisée. Les Algériens sont imprévisibles. Ils sont violents. C’est une société violente. Elle l’a prouvé dans le passé et dernièrement avec ses islamistes. Les Algériens se sont entretués. Il y a chez eux une culture de la violence. L’indépendance a échoué, ils ne sont pas parvenus à un régime démocratique. Il n’y a pas de culture politique. Il n’y a pas de conscience politique. Il n’y a pas d’opposition. Il n’y a pas d’alternatives. C’est bloqué. Ils ne s’en sortiront pas.
Elle marche sereine, forte de millions d’yeux et de bouches, de bras et de jambes, la foule du peuple algérien. Il est peut-être difficile de se rendre compte, de saisir la diversité, la singularité de chaque individu, de chaque groupe composant cette marée humaine. Les manifestants ne pensent pas tous à l’identique. Ils ne sont pas forcément mus par les mêmes idées. Chaque slogan a sa voix. La voix est un organe spécifique qui se situe entre le corps et la pensée. Seize millions de corps et de pensées qui manifestent un jour du mois de mars 2019 à Alger. Une addition de singularités, les uns à nuls autres semblables. La foule n’est pas homogène. L’homogénéité supposée d’un peuple, africain de surcroît, renvoie à des descriptions injustes et discriminantes, des analyses d’outre-tombe. Les préjugés restent, les classifications sommaires, les conditionnements ont laissé des traces et produisent encore des conclusions de confort.
Ayant participé au début du mois de mars à une manifestation contre le cinquième mandat de Bouteflika à Londres, j’ai formé avec les Algériens de Londres la foule diverse des rues d’Alger. En France, les critiques proférées contre l’Algérie et les Algériens m’ont depuis longtemps persuadée qu’il est impossible de réduire les Algériens aux Algériens et l’Algérie à elle-même. Un slogan imprimé sur le blouson d’un manifestant du vendredi affirme justement qu’« il n’y a que deux types d’individus sur cette terre : les Algériens et ceux qui rêvent de l’être ».
La foule de millions de femmes, d’hommes et d’enfants qui défilent dans les villes algériennes dont les corps tremblent et palpitent d’émotions à l’unisson, est un « moi en équilibre », une zone d’inconfort et de turbulences, une somme de singularités non sujette à l’assignation identitaire.
Le mouvement du 22 février est une révolution en marche.
À ceux qui ont vu dans le mouvement du 22 février, « le réveil » de l’Algérie, ce qui supposerait que le pays était préalablement endormi, il va de soi que les Algériens ne peuvent être sujets à une narcose collective. La mémoire collective n’existe pas non plus. Comment peut-on communément penser qu’un peuple dort et se souvient simultanément, dans une harmonie de temps et de nombre. Est-ce anodin de considérer que pendant que les sociétés occidentales consument et consomment leur vie par les deux bouts, le peuple d’à côté est plongé dans une profonde léthargie ?
Et puis soudain, le réveil.
Le peuple algérien ne dort pas. L’Algérie française ne dormait pas, elle s’assoupissait pour s’éveiller dans un pays qui n’était pas le sien. Elle n’avait d’ailleurs pas le loisir de choisir ses heures de repos. La pause octroyée servait à penser l’Indépendance. Il aurait fallu demander aux résistants français quelle était la nature de leur sommeil pendant l’Occupation, si l’on était saisi d’hibernation avant les combats. Les Algériens ne dorment plus depuis bien longtemps. La nuit, les anciens rêvent encore de la guerre d’Indépendance. Ils rêvent de ce qu’ils n’ont pu avouer à leurs proches ou à un tiers anonyme, sur le coin d’un oreiller ou sur le bord d’un divan. Ils ont à jamais perdu le sommeil. La génération qui a suivi ne dort pas mieux. Les dizaines de milliers de victimes de la guerre terroriste, la mal nommée « guerre civile », hantent les nuits algériennes. Le pays est une contrée en perpétuelle alerte, dont les membres souffrent de crampes, d’impatiences et de tachycardie. Un pays qui veille pendant les fêtes du Ramadan, la nuit comme le jour. Un pays de garde, tel un jeune infirmier, les yeux rougis par les heures sans sommeil, enchaîné à un mourant, lui même cloué à sa chaise roulante. Un moribond qu’il faut laver et habiller sans jérémiades, et dont il aurait fallu indéfiniment, du moins jusqu’au 22 février dernier, pousser le fauteuil. Une chaise-carrosse qui depuis l’Indépendance roule sans bruit sur le silence des victimes du régime. Le peuple algérien est en alerte. Il est préparé à tout cataclysme, à toute catastrophe. Il a compris. Il sait déjà.
« Vous allez vous confronter à une génération qui vous connaît bien et que vous ne connaissez pas » peut-on lire sur la pancarte d’un groupe de jeunes à Alger. Invité à Alger en 2016, Yves Michaud, l’ancien directeur de l’école des Beaux-Arts de Paris, a semble-t-il eu le temps (record de son séjour de sept jours) d’« analyser la société algérienne ». De retour en France, il définit sur sa page Facebook la jeunesse algérienne comme une jeunesse « qui ne sait rien et qui ne fait rien ». Il convient de noter la répétition des qui et des riens. Les qui-qui et les rien-rien de monsieur Michaud. Monsieur Michaud a tant à apprendre. À la jeunesse algérienne, pense-t-il. De la jeunesse algérienne, pensons-nous.
Certains ont vu dans le mouvement du 22 février les soubresauts d’un printemps arabe « tant attendu ». Le printemps arabe de l’Algérie. L’adjectif arabe hérisse beaucoup d’Algériens qui à juste titre ne le sont pas. Le mouvement du 22 février est une révolution en marche. Les Algériens évoquent bien un changement constitutionnel et l’avènement d’une assemblée constituante, qui donnerait naissance à une deuxième République. L’option socialiste de développement, choisie par le gouvernement algérien aux lendemains de l’indépendance, et ses théories de non-alignement ont forgé une culture et une conscience politiques qui se sont transmises de génération en génération.
Les slogans des jeunes révolutionnaires du 22 février défient les ingérences étrangères, qu’elles soient françaises, turques ou qataries. L’adhésion aux thèses socialistes de développement, leur application, leur réussite, leur échec et leur inévitable abandon, a certes exclu le peuple algérien du champ politique. L’absence de légitimité, la corruption et le népotisme du régime ont cependant forgé un citoyen algérien éminemment critique, contribué à construire son altérité politique et sa maturité. On le retrouve dans la foule des trottoirs, ce corps citoyen, campé sur ses membres et rajeuni d’une jeunesse qui sait tout. Sont évoquées les premières manifestations de l’Indépendance.
La production critique, la prise en compte de l’altérité sociale et politique sont aussi au cœur des pratiques artistiques algériennes. La scène artistique contemporaine s’est forgée dans l’acier qui a manqué dans la construction des centres d’art. Les artistes algériens de la nouvelle génération déroulent un récit, un fil d’Ariane qui enjambe les murs, les ministères et les palais, les tombeaux des justes et des renégats. La dernière œuvre de l’artiste Lydia Ourahmane, née en 1992 à Saida, intitulée En l’absence de nos mères, prend pour départ la vente d’une chaîne en or. L’artiste achète un collier à un jeune harraga et contribue au vœu de son départ pour l’Europe. L’or est fondu et transformé en couronne dentaire. Cette dent en or, issue de la vente du collier maternel du jeune homme, ornera la bouche de l’artiste et sera exposée.
Précédemment, Lydia Ourahmane avait évoqué la révolution. Elle avait suspendu à Oran, entre deux arbres, un néon portant l’inscription Too late for ambition et filmé sa destruction à coups de pierre par un groupe de jeunes du quartier. Une autre de ses œuvres documentera la façon dont elle parviendra à sortir du pays des dizaines de barils de pétrole vides et à les faire exposer en Angleterre. Le corps-nation inspire les nouvelles pratiques artistiques algériennes. Oussama Tabti, né en 1988 à Alger, conçoit en 2017 une œuvre qu’il intitule Shapes et qu’il dédie aux chibanis, ancienne génération oubliée de travailleurs algériens en France. L’artiste sonde la mémoire de ces hommes — silhouettes discrètes et abandonnées, et expose leurs vêtements. Dans son œuvre Tête d’arabe, il aborde une réflexion sur la représentation de « l’Arabe » dans le portrait du courant orientaliste (Étienne Dinet) et dans la couverture médiatique des évènements du printemps arabe.
Dans son film Atlal, le jeune réalisateur Djamel Kerkar a filmé le silence des champs de ruines, l’absence des victimes et les crimes impunis de la décennie noire. Défaite et frustration de la jeunesse. Un corps manqué et manquant.
Le mouvement du 22 février est une révolution, c’est un mouvement des corps. Un corps à corps, qui doit réjouir Frantz Fanon qui, le premier, avait analysé la chair rigide et meurtrie du sujet colonial. Un corps en mouvement. Un corps-révolution à l’image du corps-poème de Jean Sénac, assassiné à Alger, un jour d’été 1973. Qui a donc voulu abattre le corps de Sénac ? Du poète algérien, on ne peut tuer que la dépouille. Son œuvre est portée dans les cortèges d’Alger, d’Oran et de Constantine. Sa poésie est sur les lèvres du peuple. Maurice Audin, Larbi Ben M’hidi, Abane Ramdane, marchent aux côtés du peuple algérien et soutiennent son désir.
