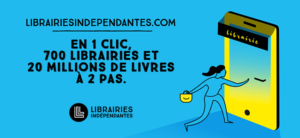Réinventer le référendum
Pour la première fois depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui l’avait instauré, une coalition de députés a activé la procédure de « référendum d’initiative partagée » pour contester la privatisation des aéroports de Paris. Si elle est validée par le conseil constitutionnel et reçoit la signature de 4 millions d’électeurs, les français pourront être consultés en dépit du vote de leurs parlementaires sur une question qui ressort de la loi.
L’accueil réservé à ce premier « RIP », mélange de crainte et d’enthousiasme, donne à voir toute l’ambivalence avec laquelle nous percevons le référendum, outil emblématique inventé par la Révolution et marqué par l’usage plébiscitaire qui en fut fait sous l’empire napoléonien et la cinquième république. Les accusations d’antiparlementarisme ne sont jamais bien loin, et les relents antipopulaires, non plus. Disons le tout net : l’usage du référendum n’est pas sans risque pour la démocratie, et on aurait tort de le réifier. Pour autant, déclenché à bon escient et sous des formes rénovées, il peut aussi être un outil de fabrication du consensus et de progrès pour la démocratie.
La question se pose avec une acuité particulière. Les gilets jaunes ont fait du renouveau démocratique une dimension fondamentale de leurs revendications. Face à des institutions représentatives à bout de souffle, la demande est celle d’une refondation d’ampleur, impliquant activement les citoyens dans la vie de la cité. Au-delà des institutions de la cinquième république, les gilets jaunes en sont venus à contester le principe même de la représentation politique, qui prévaut depuis la Révolution française. Plus question d’être consultés tous les cinq ans et passifs le reste du temps, le mouvement demande à ce que les citoyens puissent participer plus « directement » à l’élaboration des lois et au contrôle du gouvernement.
Finalement, que disent les gilets jaunes sur la représentation ? Qu’elle est viciée, d’une part, lorsque, par la magie du