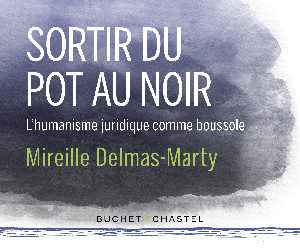L’Europe, cadre nécessaire de la transition écologique
Les prochaines élections européennes fixeront la posture de la plus grande puissance économique mondiale et de son demi-milliard d’habitants face à la double crise écologique qui menace l’humanité : la crise énergie-climat et la crise alimentation-santé. Cela dans une conjoncture économique où la crise du néo-libéralisme est loin d’être résolue[1]. L’impatience gronde chez les bas salaires, chez les chômeurs, dans la jeunesse. Et la question se pose, qui alimente les nationalismes : les pays d’Europe ne s’en sortiraient-ils pas mieux chacun pour soi ? L’écologie ne recommande-t-elle pas la résilience d’organismes plus petits mais agiles ? « Small is beautiful » disait-on…
Pourtant, l’Union européenne fut longtemps à la tête de la lutte pour un environnement sain et pour la justice écologique. Leader sur le plan intérieur d’abord : la règlementation environnementale européenne fut toujours en avance sur celle de la plupart de ses pays membres. Leader mondial ensuite : de la conférence de Rio en 1992 à celle de Copenhague (2008), les propositions volontaristes de l’Union à la table des négociations internationales ont permis d’arracher des engagements englobant une grande partie du monde, qu’il s’agisse du climat ou de la biodiversité́.
Ces temps semblent révolus, et Copenhague marqua le coup d’arrêt. Entrainée, comme le monde entier, par la vague libérale, l’Union est entravée par des traités accordant un droit de veto (de droit ou de fait) aux pays les plus « réticents » face aux politiques écologistes et solidaires. Elle a progressivement réduit son ambition au plus mauvais moment. Est-ce l’entrée des pays de l’Europe centrale et orientale, et les compromis paralysants qu’il fallut leur concéder à Nice ? Est-ce le rejet par plusieurs pays du Traité Constitutionnel Européen (2005), qui donnait plus de poids à la représentation directe des peuples, le Parlement européen ? Est-ce tout simplement la tendance au libéralisme dans les opinions publiques, pa