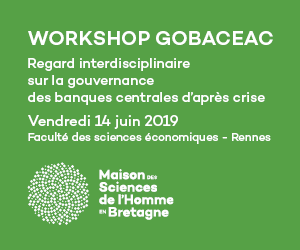Quand la haine gagne l’espace public
La haine a gagné l’espace public. En principe, la haine est une affaire privée. De temps en temps, quelqu’un ne nous « revient » pas, ce qui signifie qu’il nous « revient » trop car sa présence dans nos pensées devient aussi obsessive qu’en cas d’amour. Nous n’en sommes pas spécialement fiers en général et savons que cela nous renvoie à des expériences anciennes qu’il nous appartient d’élucider et d’accepter pour les dépasser. La haine héritée, souvent politique, est aussi affaire privée. Comment aimer les bourreaux de ses parents ? Chacun s’en arrange.
Mais quand une telle expression de la haine parvient dans l’espace public, l’affect laisse place au discours, au combat proprement politique, c’est-à-dire langagier. La haine, elle, ne dicte aucun discours, mais elle attaque le langage et nous laisse démunis devant des invectives, des cris, des insultes qui transforment tout désaccord en affrontement. La haine est « anti-sociale ». Pourtant, dans l’actualité, l’espace public est devenu le nouveau territoire de la haine.
La haine avait déjà explosé au regard de tous, à la télévision, le 3 mai 2017 lors du débat opposant les deux candidats finalistes de l’élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuelle Macron. Il s’agissait, alors, semble-t-il, de l’opposition d’une radicalité populiste au langage de la raison. C’était déjà sidérant, mais encore limité à la sphère politique. Depuis cet automne, on a vu la haine s’emparer de toute la société. La haine s’est exprimée sans aucun refoulement chez certains Gilets jaunes, haine antisémite (agression verbale d’Alain Finkielkraut, « quenelles » de Dieudonné etc.), haine des élites, des « riches », des « nantis » – pas toujours accompagnée d’une dénonciation des inégalités sociales –, haine contre la personne du chef de l’État, tour à tour guillotiné, décapité, ou promené de en cercueil.
Le président de la République avait sans aucun doute contribué à allumer l’incendie, non seulement, à court terme, en augmen