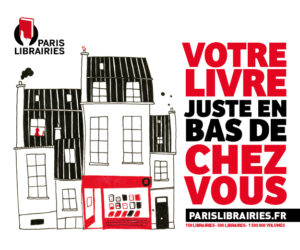Rappel de la forêt et logique du scandale
La rentrée et ses controverses politiques nous ont-elles fait oublier la forêt ? Parmi les phénomènes renforcés par le réchauffement climatique, les ouragans ont-ils remplacé les incendies ? Oui et non… Mais bien qu’une réponse de Normand ne soit pas ici hors-sujet, nous essaierons plutôt de montrer que ce qui arrive à la forêt n’est pas un événement comme un autre ; que c’est un scandale, et pas un scandale comme les autres, parce qu’il n’apparaît pas et ne s’oublie pas de la même manière.
Cela ne fait pas des incendies ou de la déforestation une réalité première ou exceptionnelle, mais un élément de la logique du scandale, laquelle différencie celui-ci des autres événements et implique aussi ses différenciations internes. Pour qu’il y ait scandale, il faut qu’une transgression dissimulée se manifeste au grand jour (qu’une limite ait été franchie, que ce passage devienne un événement), mais les transgressions sont différentes, et ces différences s’articulent. D’où la possibilité de formuler plus précisément nos questions : quel rapport entretient ce mot de la Bible grecque, skandalon, ce rocher qui fait obstacle et qu’on ne passe qu’en trébuchant, et cet autre scandale qu’est la coupe et l’exploitation des arbres ? Quel lien entretiennent les scandales moraux, politiques et écologiques ? Et en quoi notre relation avec la forêt nous éclaire-t-elle sur ce qu’est un scandale écologique ?
La déforestation grecque, juive et romaine
Commençons par notre relation avec la forêt, en la replongeant dans l’histoire comme dans un chapitre de l’Ulysse de Joyce, où un quartier louche de Dublin est encore une île forestière de la Méditerranée : plus précisément Eéa, où les animaux sauvages se comportent comme des animaux domestiques, parce que ce sont des hommes transformés en bêtes et élevés par Circé. Jusqu’en Irlande s’exerce ce « charme » méditerranéen devant lequel s’est effacée, déjà des siècles avant Jésus-Christ, la forêt primaire, laissant place à cette forêt