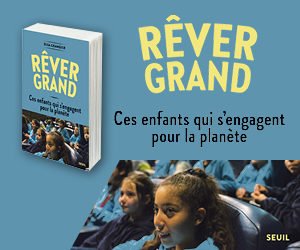« Nous sommes en guerre ! »
Nous sommes en guerre. C’est par ces mots que le Président de la République nous fait entrer dans une temporalité nouvelle, celle de la conflictualité, où est mise en jeu l’existence de la Nation parce que son corps social est menacé directement par un virus et indirectement par les effets des mesures nécessaires à son endiguement.
L’épidémie et la guerre chevauchent ensemble, dans le livre de l’Apocalypse, sur un cheval pâle et un cheval roux qui reprend les chevauchées provenant de la huitième vision du prophète Zacharie. Les chevaux portent la colère de Dieu et le châtiment sur les royaumes mais aussi la promesse d’une forme de renouveau. Dans l’imaginaire plus contemporain, le lien entre épidémie et guerre est naturel : les deux emportent avec eux un imaginaire d’envahissement du territoire et de la destruction de la population. Avec la fin de la population sur un territoire, on trouve la possibilité de la fin de la vie politique et sociale normale.
Des juristes rigoureux pourraient faire remarquer que la déclaration de guerre relève du Parlement et qu’il ne s’agit donc que d’une expression pour faire comprendre l’ampleur autant que l’irréversibilité de la situation. Les historiens des questions militaires disaient de même que la déclaration de François Hollande en réponse aux attentats de Charlie Hebdo avait ouvert la voie à un engagement dans un temps de conflit aux conséquences mal maîtrisées. D’ailleurs, la mobilisation du terme de guerre par les élus, les derniers présidents de la République en tête, signifie aussi qu’il faut, d’une manière plus courageuse autant que plus collective, intégrer cette absence de maîtrise sur les événements à une échelle encore rarement vue. Longtemps, il n’y avait eu que la guerre, maintenant le spectre des événements aux effets semblables s’est élargi.
Nous sommes confrontés à une prise de conscience de l’importance des services publics.
La présence de la guerre au cœur de la politique doit nous interroger et ce à