Le commun à l’épreuve du virus
Au sortir d’une crise sanitaire majeure, qui pourrait un jour rebondir et qui continue de frapper d’autres continents, l’éloge des communs pourrait presque apparaître comme une platitude, tant il a semblé évident que le commun, au travers notamment de services publics puissants et de la solidarité sociale, était une nécessité vitale.
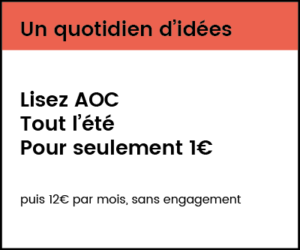
Délaissé depuis un demi siècle au profit d’un capitalisme de plus en plus glouton et intrusif, le commun est donc revenu à l’honneur, quoique sous des formes souvent ambigües, justifiant par exemple un confinement drastique de toute la population pour endiguer l’épidémie et éviter l’engorgement des hôpitaux, ou encore la rupture des contacts physiques directs au profit d’une communication à distance entièrement dépendante des réseaux numériques. Nous avons ainsi vécu trois mois de restrictions inédites des libertés publiques, avec une police omniprésente dans la rue et sur les médias, et dans la communication officielle un déferlement de maternalisme politique faisant de la philosophie du care une méthode d’infantilisation de la population adulte, sommée, pour son bien, de se plier à des consignes aussi tatillonnes que changeantes et contradictoires.
Dans une période qui devrait être celle de la mise en œuvre de la prophétie présidentielle du 16 mars : « Le jour d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour aux jours d’avant… », il n’est donc pas inutile de revenir sur les raisons profondes qui justifient le retour aux communs que je propose dans un essai paru quelques jours avant le début du confinement.
Restaurer la part du commun
Mon point de départ est que l’abandon ces dernières décennies par la plupart des gouvernements, y compris sociaux-démocrates, de la part du commun, c’est-à-dire les biens qui devraient être soustraits à l’appropriation et l’exploitation privée, n’est pas l’effet d’un mouvement naturel et inexorable de l’économie, mais d’un tournant idéologique qui a visé très clairement à triompher des plans ke
