Un désir de peine de mort ?
Les médias ont récemment repris en chœur le résultat du sondage « Fractures françaises » du Monde, de la Fondation Jean Jaurès et de l’Institut Montaigne, révélant que 55% des Français étaient favorables à la peine de mort. L’information arrive de nulle part, et ne renvoie à rien de connu, tant le débat sur la peine capitale est clos depuis quarante ans. Qu’a donc bien pu mesurer ce sondage ? Et surtout qu’aurait-il pu montrer d’autre ?
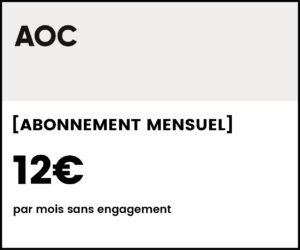
S’il y a bien un apport des sciences sociales, c’est d’avoir démontré que les sondages révèlent surtout l’imaginaire de ceux qui les font. Clairement, la peine de mort fait partie des grandes questions qui ont agité la société française pendant des siècles, mais force est de constater que ce n’est plus le cas. Si épisodiquement le rétablissement du châtiment suprême est brandi comme un chiffon rouge par quelques élus d’extrême droite, le nombre de dépôts de propositions de loi en ce sens a été négligeable, et aucune n’avait de chance d’aboutir, faute notamment d’une majorité politique ou d’une « majorité d’idées » au Parlement.
Depuis l’abolition de 1981, le débat sur la peine de mort s’est en fait déplacé vers les pays qui la pratiquent encore, en particulier les États-Unis, ainsi que les régimes qui y recourent massivement, souvent pour liquider des opposants politiques, au terme de procès expéditifs, quand il y en a (Arabie Saoudite, Chine, Iran). À l’ONU, l’idée d’une abolition universelle revient fréquemment, pour essayer de peser sur l’agenda politique des pays dits « rétentionnistes », et la France y fait entendre sa voix. Mais dans l’Hexagone, les débats sociétaux de ces dernières années n’avaient pas la peine de mort pour objet, et elle ne surgit pas non plus spontanément dans les discussions quotidiennes.
Sous tous ces aspects, la question du sondage apparaît donc « hors-sol », et surtout très imprudente, qui laisse penser que la dispute est toujours brûlante. Qui prend surtout le risque de laisser croire que puisque le dé
