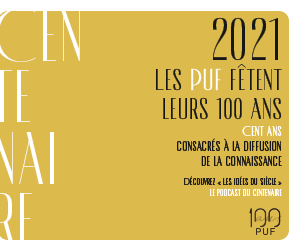Trump ou le refus masculiniste du deuil
On pourrait considérer comme une chose mineure le fait que Trump ne soit capable ni de rencontrer Biden ni de reconnaître qu’il a perdu l’élection. Or ce refus de reconnaître la défaite ne fait-il par partie intégrante du processus de destruction mis en œuvre par Trump, que d’aucuns pourraient appeler une échappatoire ? Pourquoi perdre est-il si pénible ? Cette question, en ces temps difficiles, revêt au moins deux acceptions.
Nous sommes tellement nombreux à avoir perdu quelqu’un à cause du Covid-19, à craindre la mort, celle des autres et la nôtre. Tous nous vivons dans un climat de maladie et de mort, que nous ayons ou non un nom pour cette atmosphère si particulière. La mort et la maladie sont littéralement dans l’air. Et pourtant, nommer ou appréhender ces pertes n’est pas aisé. Mais la réticence de Trump à exprimer toute forme de deuil public trouve, elle, sa source dans le refus masculiniste du deuil, qu’elle contribue à renforcer, lequel est étroitement lié à la fierté nationaliste, voire à la suprématie blanche.
Les trumpistes tendent à ne pas pleurer ouvertement les décès dus à la pandémie. Ils ont systématiquement réfuté les chiffres, les estimant exagérés (« fake news! »), et défié la menace de mort à coups de rassemblements et de maraudes sans masques dans l’espace public, dont le point culminant a été le triste spectacle de voyous en peaux de bêtes envahissant le Capitole des États-Unis. Trump n’a jamais reconnu les pertes subies par les États-Unis, et n’a jamais témoigné la moindre envie ou quelque aptitude à présenter ses condoléances. Et les rares fois où il a effectivement mentionné ces pertes, ce n’était que pour dire qu’elles n’étaient pas si terribles, que la courbe s’aplatissait, que la pandémie serait de courte durée, que ce n’était pas de sa faute, que c’était de la faute de la Chine. Ce dont les gens ont besoin, a-t-il affirmé, c’est de retourner au travail parce qu’ils « meurent » chez eux, ce qui, dans sa bouche, veut dire qu&rs