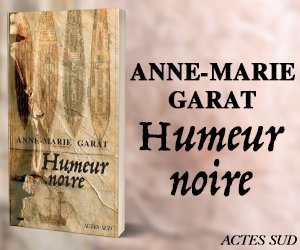La santé publique francophone : une aveuglante absence de diversité
Alors que la pandémie de Covid-19 fait rage en France (comme ailleurs), quelle ne fut pas notre surprise, pour ne pas dire notre déception, en découvrant les organisateurs d’une agence de communication et les panélistes d’un débat fin novembre 2020 portant sur le thème d’une future réforme de la santé publique en France. En effet, intitulé les « contrepoints de la santé », laissant donc croire, comme annoncé par ses initiateurs à une volonté de « renouveler le débat… pour favoriser l’adaptation de chacun aux mutations annoncées », cet échange d’une heure en direct sur Youtube a confirmé l’absence de diversité, l’entre-soi et la reproduction à l’œuvre dans la santé publique française. Olympe de Gouges et Bourdieu doivent rire jaune !
Les mutations de la société française ne semblent pas avoir percé le « plafond de béton » de la santé publique. Les quatre personnes que l’on voyait débattre, deux journalistes et les responsables de deux grandes organisations de santé publique française, sont des hommes, en fin de carrière, blancs. La santé publique est représentée par deux médecins hospitalo-universitaires. La pandémie de Covid-19 n’est-elle finalement qu’un nouvel épisode de l’histoire de notre époque marquée par cette absence de diversité (de genre, d’origine, d’âge, de discipline, etc.) ? Plusieurs analyses à l’échelle mondiale ont déjà mis au jour la mise à l’écart des femmes, de la société civile ou de l’interdisciplinarité dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et notamment dans les sphères de décision et autres conseils scientifiques.
Dans l’univers de la santé publique francophone au sein duquel nous nous situons, nous pensons que cette absence de diversité est non seulement flagrante mais surtout historique et structurelle. En effet, l’absence de diversité est une situation largement connue, mais dissimulée et jamais considérée comme un problème à résoudre. C’est un secret de polichinelle. Pour cette analyse, notre point de vue s’inscrit dans